AVERTISSEMENT
Il y a 140 ans, Louis
Pierre Mouillard publiait ce livre. Il était professeur de dessin, avait des
talents d’écriture, était un fin observateur des oiseaux et un expérimentateur
des premières machines volantes depuis 1856.
Certes toutes les
lois de la physique ne sont pas encore bien assimilées, comme le déplacement du centre de gravité
d’une feuille de carton sous l’influence de son mouvement, ou comme
l’élévation des oiseaux en spirale sans battre des ailes, grâce
à « l'inégalité de longueur de la partie de la course faite avec le
vent, comparée à celle qui est faite contre lui ». Ou le vent qui ne se déplace que par rafales
successives, ce qui génère de la portance. Phénomène qui a été démontré
mathématiquement à l’époque, et qui est bien réel, mais dont l’ordre de
grandeur n’a aucune commune mesure avec les ascendances utilisées par nos
oiseaux. Seuls les albatros sont capables d’exploiter autour du pôle sud le vol
dynamique dans le gradient de vent près de la surface de l’océan, mais cette
vérification expérimentale de la théorie est récente. La rafale a été le
fantasme de l’aviation pendant de nombreuses décennies donnant même son nom à
plusieurs avions.
Pourtant à cette époque on commence à parler des courants ascendants, mais
il faudra attendre le milieu des années 1920, une aviation qui a connu un essor
formidable depuis 10 ans avec une industrie florissante qui a drainé les
meilleurs cerveaux de son époque, pour qu’enfin on comprenne les mouvements
convectifs de l’atmosphère et que l’on commence à exploiter les ascendances en
planeur.
Grâce à ce livre il va partager sa passion et inspirer de
futurs précurseurs comme Chanute avec qui il va correspondre par-dessus
l’Atlantique.
Il est aussi un inventeur et va breveter une machine volante
qui inclut entre autres un système de gauchissement des ailes qui s’avèrera
dans le futur, essentiel pour le contrôle du vol.
L’objectif de la
retranscription de ce livre sous forme numérique est de le rendre accessible
dans toutes les langues. Il m’a fallu faire le choix de garder certaines
expressions ou certains mots caractéristiques du Français de l’époque, et d’en
moderniser d’autres, afin que les traducteurs automatiques en donnent une
version compréhensible dans tous les langages.
Jean-Yves Clément, novembre 2022, à Fayence (haut lieu du vol
à voile en France).
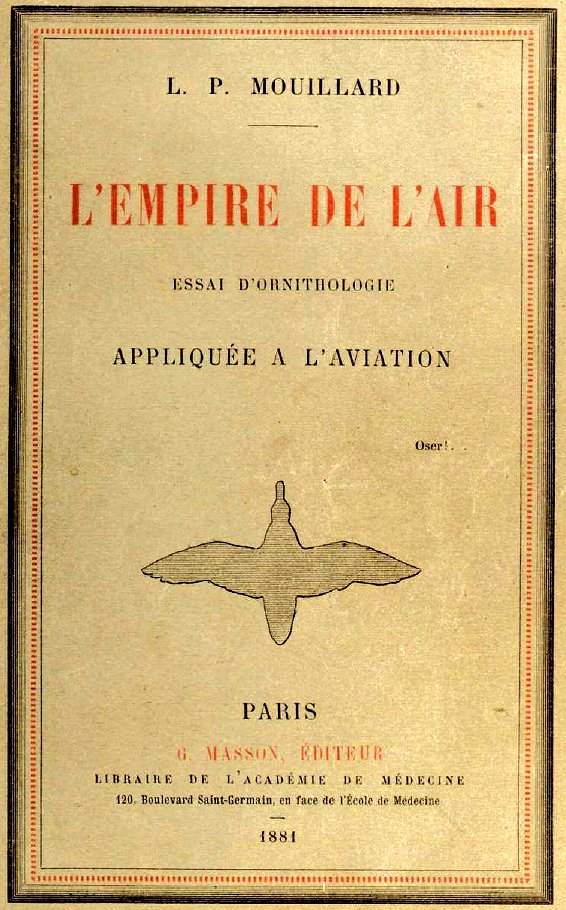
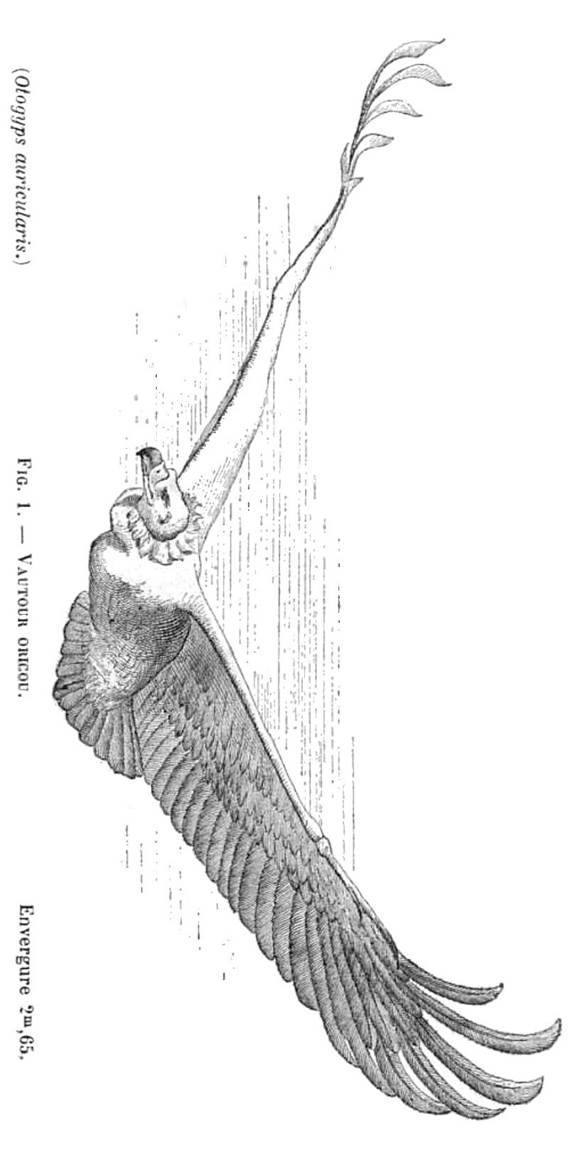
(Otogyps
auricularis.) FIG. 1. VAUTOUR ORICOU Envergure 2,65m.
L. P. MOUILLARD
__________________
L'EMPIRE
DE L'AIR
ESSAI D'ORNITHOLOGIE
APPLIQUÉE
A L'AVIATION
Oser!..
________________________________
PARIS
G.
MASSON, EDITEUR
LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
120. Boulevard Saint-Germain, en
face de l'Ecole de Médecine
1881
________________________
3181-81.- CORBEIL. Typ. et stér.
Crété
OSER
!...
Cette étude
date de loin, j'avais quinze ans quand le hasard voulut qu'un oiseau produisit
devant moi une évolution qui fut pour moi une révélation.
Depuis lors je n'ai plus douté, et je n'ai poussé plus loin cette étude
que pour pouvoir persuader ceux qui n'ont pas vu.
PRÉFACE
S'il est une pensée tyrannique, c'est
assurément celle de ce mode de locomotion. Une fois entrée dans une
intelligence, elle s'en empare en maîtresse ; c'est alors une obsession
continuelle, une espèce de cauchemar auquel il est presque impossible de se
soustraire. Si on joint à cela le discrédit jeté sur cette étude, on comprend
facilement le sort malheureux des pauvres chercheurs qui sont hantés par ce
problème.
Beaucoup d'entre eux, soit par fierté soit
par timidité, se sont renfermés en eux-mêmes, et ont été complètement paralysés
dans leurs expériences par le secret qu'ils devaient garder. On était si vite
et si cavalièrement traité de rêveur, même de fou, qu'il y avait urgence, sous
peine de discrédit complet, de cacher à tous ce vice de l'intelligence.
Il faut cependant reconnaître que depuis une
dizaine d'années cette persécution a beaucoup diminué. Nous ne sommes plus
exactement classés avec les chercheurs de la quadrature du cercle ou du
mouvement perpétuel ; il y a progrès, surtout depuis que les Chasles, Janssen,
Quatrefages, et autres pinacles de la science ont osé affirmer qu'ils croyaient
à la résolution de ce problème. Nous ne risquons plus aujourd'hui d'être
envoyés à Bicêtre, mais malgré cela la masse nous regarde encore comme des
cerveaux mal équilibrés.
L'esprit humain, entraîné par cette marche
en avant des illustrations scientifiques, est donc entré en mouvement. — Deux
routes se sont présentées à lui, l'une belle, large, agréable, bordée de fleurs
; mais qui ne mène à rien de sérieux :
c'est la voie du plus léger que l'air. —
L'autre, au contraire, est un sentier ardu, hérissé de difficultés, mais qui
aboutit : c'est l'étude par le plus lourd que l'air. — La généralité s'est
lancée dans la route facile à suivre, et contemple de là les malheureux engagés
dans les fondrières, sans se douter qu'elle-même sera obligée de revenir sur
ses pas et de s'y engager à son tour si elle veut arriver.
Humanité aveugle ! mais ouvre donc les yeux,
tu verras de par l'atmosphère des milliards d'oiseaux et des trillions
d'insectes. Tous ces êtres tourbillonnent gaiement dans les airs sans être
attachés au moindre flotteur ; beaucoup d'entre eux y circulent même sans
fatigue pendant de longues heures : et après une démonstration, donnée par la
source de toute science, tu seras bien obligé de reconnaître que là est la
ligne à suivre.
C'est donc par le plus lourd que l'air que
nous allons aborder cette étude : c'est par les cornes que nous saisirons le
monstre. Nous aurons pour guide et pour soutien ce maître puissant qui
n'engendre que des prodiges : je veux dire la Nature.
Elle a complètement négligé l'ordre d'idées
du plus léger que l'air, et toutes ses œuvres se sont adressées au plus lourd.
Avec un pareil mentor on ne peut errer.
Il y a deux manières d'étudier cette question
; une qu'on pourrait nommer de cabinet, et l'autre qui se fait au grand air.
La première agit avec les mathématiques ;
elle les lie à quelques rares observations défectueuses ou inutilisables, et,
s'appuyant sur ces bases fragiles, en exprime à grand renfort d'équations tout
ce qu'elles peuvent produire, et même trop souvent ce qu'elles n'ont jamais
pensé.
Les mathématiques sont certainement une
excellente chose, mais elles sont moins indispensables qu'on ne le supposé
généralement pour la compréhension de ce problème difficile.
Cela tient à ce que les bases des opérations
sont toujours erronées.
Rien n'est plus simple en effet que de dire :
étant donné que, nous savons tous que V, que R, que P égale ; et en route, on
intègre à perte de vue, et on arrive à un résultat..... qui ne s'accorde pas
avec l'observation.
Quand on part d'une donnée fausse, on arrive
tout de même, mais pas au but. — Même en calculant juste, il est certain que,
pour les 99/100" des intelligences, y compris même celle du calculateur,
ces chiffres et ces formules ne vaudront pas une explication bien limpide, ou
encore mieux, une expérience concluante.
Les mathématiques sont donc un moyen
intéressant de recherche, mais non un moyen de persuasion : nous n'y aurons
recours qu'à la forcée, parce que nous sommes intimement persuadés de ne jamais
rencontrer quelqu'un capable de hasarder son existence sur le dire d'une
formule.
Le Caire, 24 avril
1881.
HISTORIQUE
Rien n'est nouveau sous le soleil ; pour la
question qui nous occupe comme pour beaucoup d'autres ce proverbe est vrai.
L'antiquité commence par nous présenter dans
Icare le problème tout simplement résolu. Qu'y a-t-il d'impossible à cela ?
avec de l'observation et du bon sens on peut y arriver : Icare avait peut-être
ces deux dons.
Louis Figuier dans ses Années scientifiques,
Fulgence Marion dans son ouvrage Les ballons et les voyages aériens,
etc., etc., traitent de la question historique d'une manière très complète :
nous y renvoyons le lecteur que la question intéresse. Nous remarquerons
seulement qu'il ressort de tous ces faits que ce n'est nullement une question
neuve que nous abordons, et que l'expérience du saltimbanque ne demandait qu'à
être poussée pour amener un résultat, sinon complet, du moins très intéressant.
Plus tard, les ballons sont venus jeter leur
énorme masse au travers de la question ; on n'a plus regardé qu'eux pendant
quatre-vingts ans. Ils ont eu pour effet de fourvoyer les idées dans des
spéculations sans issue, et les chercheurs sont allés tous, les uns après les
autres, s'enferrer contre l'impossible.
Cependant la généralité des attentifs fut
intéressée par ces immenses appareils, soi-disant dirigeables : elle les
accepta tellement que les questions d'argent eurent du succès. Mais quant à la
question du plus lourd que l'air, il faut le reconnaître, elle y fut
souverainement rebelle : on fera monter l'humanité en ballon sans trop la
prier, mais quant à la faire s'embarquer sur un appareil quelconque qui ne sera
pas un flotteur, il n'y faut pas penser, au moins de longtemps. Le vélocipède
n'est pas sérieusement admis ; on ne peut nier qu'il n'y ait une répulsion de
la masse contre lui : cet équilibre stable par son instabilité la déroute
complètement. Elle comprend le ballon, mais n'admettra que difficilement
l'aéroplane.
BALLONS
Certainement que de s'élever dans les airs
est une belle chose, mais est-ce ce que nous cherchons ? Au premier abord il
semble exister un lien entre la direction et l'ascension, et cependant un
demi-siècle de réflexion a fait voir qu'il y a entre ces deux ordres d'idées un
abîme profond : elles sont aux antipodes l'une de l'autre ; en opposition
précise.
Les espérances des ballonniers sont
assurément bien diminuées, mais ne sont pas mortes cependant ; ils les basent
généralement sur cette donnée, que les surfaces croissent comme les carrés et
les volumes comme les cubes. C'est exact, mais les difficultés comment
croissent-elles ? mais la force du vent comment croît-elle ? cent mètres carrés
de surface en une seule voile font bien autrement de force que cent carrés de 1
mètre de côté.
En chambre, par un temps très calme, ils
pourront avoir quelques résultats ; mais par une modeste brise il n'y faut plus
penser ; par un grand vent c'est la fuite et la perdition si on essaye de
résister.
Ils parlent d'appareils
géants pour arriver à bénéficier des différences qui s'établissent entre les
cubes et les surfaces. Cela devient tellement monstrueux que nous abandonnons
l'analyse.
Cependant, pour pousser à bout cette étude,
nous admettrons qu'on puisse arriver à les charger d'une machine assez forte,
par rapport à son poids, pour pouvoir vaincre la résistance de l'air : mais où
trouver une enveloppe capable de supporter une telle pression. — Au reste, la
fin du ballon captif a été une démonstration irréfutable de l'inanité de ce genre
de conception. Il a éclaté malgré son millimètre d'épaisseur de parois, et cela
en plein Paris ; abrité par le Louvre, et au repos. Qu'aurait-ce donc été s'il
se fût trouvé là-haut dans les airs, et qu'il eut voulu remonter le courant ?
Cet accident semble avoir jugé la question.
Quand on sera parvenu à emmagasiner
l'hydrogène d'une manière portative, on aura, non pas trouvé la solution du
problème, mais trouvé le moyen de faire des ascensions très longues, au gré des
vents, mais cependant pleines d'intérêt à cause de leur durée.
En somme, pour le moment, les ballons ne
servent qu'à fourvoyer les chercheurs ; plus tard ils auront leur utilité comme
embarcadères, comme ascenseurs : les services qu'ils rendront alors seront même
très grands.
La faiblesse de l'enveloppe sera toujours
leur écueil. En quoi construire un ballon capable de résister à un vent de
seulement 10 mètres à la seconde ? Nous avons vu que les étoffes de la plus
grande ténacité ne sont pas suffisantes. — Voyons dans les métaux si nous ne
trouverions pas mieux ? Un ballon qu'on construirait en feuilles d'aluminium
serait obligé d'arriver au cube de 4000 mètres cubes pour pouvoir posséder une
force ascensionnelle de 1000 kilogrammes ; force nécessaire pour pouvoir
s'enlever lui-même et un moteur à vapeur en aluminium, avec générateur
Herreschoff, d'une force de 10 chevaux soit 400 kilogrammes ; plus son lest et
son combustible.
Maintenant quelle sera la force de
résistance de cette enveloppe métallique ? Le ballon sera-t-il plus solide que
ceux faits en soie grège, comme on pourrait les faire en y mettant le prix ? —
Là est la question. — C'est très douteux, et assez dangereux à expérimenter.
On trouve mieux que cela dans l'ordre d'idées
exposé dans cette étude.
Si on joint à un ballon un aéroplane immense,
il est possible d'entrevoir la direction, non pas absolue, mais souvent très
active, obtenue non seulement par la chute, mais encore par l'ascension.
C'est seulement un jalon que nous plaçons
là, pour indiquer que cette demi-solution est trouvée.
ÉTUDE
SUR L'AVIATION
PAR
LE
PLUS LOURD QUE L'AIR
Nous avons déjà dit que la nature
presciente, impeccable, toujours savante au-delà de ce que peut nous expliquer
l'étude la plus attentive, nous indique cette voie.
Ne cherchons pas à être plus fort qu'elle,
laissons-nous aller tout simplement où elle nous mène : nous y arriverons
facilement, sans nous fatiguer le cerveau de ce casse-tête chinois, à l'ordre
du jour, qui se nomme l'X à outrance, et qui se loge aujourd'hui partout.
En regardant seulement autour de nous comment
opère la gente ailée, en réfléchissant à ce que nous aurons vu, et surtout en
nous efforçant de bien le comprendre, nous sommes sûrs d'être dans le chemin
qui mène à la réussite.
DE L'OBSERVATION
L'observation pour être réellement fructueuse doit posséder plusieurs
qualités.
Il faut d'abord bien voir, puis bien analyser, et ensuite appliquer
cette étude à de bons modèles.
Pour bien voir, il faut non seulement avoir de bons yeux, savoir tenir
au point, dans le champ de sa lunette, un oiseau en plein vol, mais encore
savoir voir.
Ainsi, quand quelqu'un, peu habitué à ce genre d'étude, entend affirmer,
d'une manière péremptoire, que le point noir qu'on aperçoit à peine est un mâle
de faucon crécerelle, il croit avoir affaire à un rêveur éveillé, et cependant
rien n'est moins vrai.
Étant donné le point noir, pour celui qui a l'habitude de ce genre
d'observation, une crécerelle est facile à distinguer à sa marche, soit en planant
soit en ramant : sa longue queue est un indice sûr : il n'y a pas moyen de la
confondre avec un corbeau, une buse, un milan, ni même avec une autre variété
de faucon. — Maintenant, quant au fait de préciser le sexe, rien n'est plus
facile. On n'a qu'à observer quelques instants, le mâle se décèle par sa
pétulance et la brièveté de ses battements, par l'énergie de ses mouvements :
la femelle est plus souple et moins ardente pour dévorer l'espace.
Pour le percnoptère, rien n'est plus simple. De très loin on le
distingue dans un vol de milans, avec lesquels il se tient souvent, à une
petite particularité de son vol : c'est une inconstance remarquable dans la
fixité de la direction ; au peu de largeur de ses ailes et à leur position très
rectiligne, car ils ne font des angles, ne prennent des ris que par des vents
très forts. Quant au mâle, sa distinction de la femelle se fait à perte de vue,
par la couleur : il est blanc, elle est brun foncé.
Les gyps se reconnaissent à la tenue du vol, à l'ampleur des
ronds, à la lenteur du mouvement.
Les arrians, otogyps, se font remarquer par l'exagération de toutes ces
qualités et par un plumage plus foncé.
Quant au gypaète, sa queue longue, large et ronde, le fait distinguer
très facilement d'excessivement loin : il n'y a pas d'oiseau de ce système de
construction dans les grands voiliers.
Voici donc, dans sa simplicité, l'explication de ce fait qui étonne
beaucoup. — Pour pouvoir arriver à bien préciser l'oiseau qu'on étudie au vol,
il faut absolument avoir beaucoup vu. Quand un aigle est parti à 50 mètres de
vous, en le suivant des yeux, ses évolutions se gravent dans la mémoire, et
plus tard, lorsqu'on rencontre le même rythme, il n'est plus besoin de regarder
aux pattes pour pouvoir distinguer si l'oiseau en vue est un aigle ou un
vautour.
Généralement on peut se fier à ses yeux : ils trompent rarement, surtout
quand le même spectacle se reproduit plusieurs fois.
Cependant il est des cas dont on doit se méfier : c'est d'abord une
diminution dans l'appréciation de la grosseur, qui s'accentue, devient plus
difficile à estimer à mesure que l'éloignement augmente ; puis une augmentation
de la grosseur dans certains cas ; entre autres, quand on est soi-même animé
d'une vitesse dans un sens, et que l'oiseau en a une en sens contraire.
La première de ces affirmations semble tout d'abord une naïveté,
cependant elle n'est que très exacte et assez curieuse pour être exposée. La
différence qu'il y a entre deux surfaces, l'une étant 0,25m2 et l'autre
1m2, est parfaitement perçue par l'œil à 100 mètres de distance :
notre vue analyse avec exactitude ce rapport et nous en donne parfaitement
conscience. A 500 mètres, la différence s'atténue sensiblement ; et, à 1000
mètres, tout élément de comparaison est détruit par la distance : la surface 4
est exactement égale il la surface 1. Cet effet est tellement fort, qu'a cet
éloignement, l'intelligence est obligée de venir secourir la vue qui ne peut
plus juger l'étendue de ces surfaces qui varient cependant du simple au
quadruple. Elle est obligée de venir lui dire : ces deux points, quoique de
même grosseur apparente, ne doivent pas l'être en réalité, car leurs mouvements
différents indiquent des masses différentes, auxquelles doivent correspondre
des surfaces environ proportionnelles.
Ainsi, à grande distance, on confond, avec les meilleurs yeux, le milan
qui a 0,28m2 de surface, avec le grand vautour qui a 1m2
et plus.
Quant à la seconde cause d'erreur, elle est plus difficile à expliquer.
Le mirage y est sûrement pour quelque chose.
On peut lui attribuer quelques-unes de ces grosses fautes de vue qu'on
commet quelquefois, surtout dans les pays chauds. Ainsi, nous nous sommes
surpris à confondre, dans le désert libyque, un vautour avec un chameau de
forte taille ; et même, une fois, en pleine France, à voir un corbeau sous le
volume d'un aigle.
A quoi attribuer ces aberrations de l'œil ? A la vitesse dont on est
soi-même animé, probablement, car le mirage est plus actif quand on est en
mouvement que quand on est immobile.
Il faut ensuite se mettre dans de bonnes conditions pour bien voir. Nous
avons eu, en Algérie, un couple de sylvies qui étaient d'une familiarité
charmante. Les demoiselles pille-mouches, comme nous les nommions, venaient chasser
à un mètre des gens, et nichaient dans un trou du plafond d'une chambre
habitée. Cette hardiesse permettait de très bien les étudier. — Ce que ces
oiseaux dépensaient de force dans une chasse de cinq minutes est étonnant. —
Ils sont organisés pour pouvoir attraper les insectes, au vol, et généralement
il y a de grandes difficultés à ces poursuites. Les mouches dont nos oiseaux se
nourrissaient faisaient, en fuyant, des crochets insensés : les sylvies les
suivaient avec succès ; et au bout de quelques secondes on entendait ce petit
coup de bec énergique, indiquant la réussite de la chasse.
La proximité dans l'étude est grandement à rechercher. Il nous a été
permis d'étudier de très près plusieurs oiseaux : la corneille, le faucon
crécerelle, le pèlerin, le milan, le néophron percnoptère, les pélicans, les
grands vautours, etc.
De la corneille et du milan nous n'ajouterons rien à ce que nous en
disons à leur article ; au Caire, il est facile de toucher ce dernier au vol en
s'y prenant avec adresse.
Mais un
spectacle émouvant (le mot n'a rien de trop énergique), c'est de voir un grand
perchoir du Mokatan, où on peut se placer de manière à voir les gyps fulvus
à cinq mètres, en plein vol.
Inutile de songer à décrire ce spectacle ! Quand ces énormes oiseaux
passent aussi près de vous, on entend un frémissement étonnant ; ces
vigoureuses rémiges vibrent comme des languettes ; elles sont retournées par
les quinze livres qu'elles supportent, au point de former un quart de cercle.
Les gros vautours sont là quelquefois par centaines ; les percnoptères
ne se comptent plus, ils font garniture, les milans se faufilent dans le tas et
vont chercher une petite place ; et le grand corbeau (corvus eorax)
croasse, irrité de voir son domaine envahi. — Les coups de bec sont nombreux.
Il faut une longueur de cou réglementaire entre chaque animal ; sans cela, un
vautour lance au large son voisin, plus petit que lui. — Entre gros, ils n'ont
guère plus d'amabilité : on les entend alors pousser leur espèce de cri qui
ressemble à un sifflement, et le plus faible pique une tête, prend le large, et
va recommencer ses études d'abordage, qui sont toujours longues et grandement
étudiées.
Une de leurs manœuvres qui étonne toujours est la descente. Les gyps
arrivent au-dessus du perchoir à la hauteur moyenne de leur vol, c'est-à-dire à
5 ou 600 mètres au moins. Arrivés à destination, ils tournent quelques minutes
pour étudier les lieux, puis se décident à s'abaisser. L'aigle fond souvent
comme un corps grave qui tombe : cela lui est possible, il est si puissant ; il
peut maîtriser une vitesse de cinquante mètres à la seconde. Mais le grand
vautour n'a pas cette force de pectoraux. Il se laisse tomber
perpendiculairement aussi, mais les ailes à peine repliées. Au reste, ces
chutes sont quelquefois énormes ; nous en avons vu qui apparaissaient au zénith
étant déjà en descente : ce qui fait au moins trois kilomètres. S'ils
permettaient à l'accélération de se produire, ils ne pourraient plus maîtriser
leur vitesse, seraient désemparés, et n'auraient plus la force de changer de
direction.
Après avoir bien vu, il s'agit de bien analyser.
Ce second point est plus difficile que le premier ; et cela, parce que
les idées préconçues influencent l'entendement.
Tout le monde s'en est mêlé pour fourvoyer les intelligences. Que de
faussetés ont été élaborées par de grands noms, et depuis admises comme article
de foi. Il convient d'analyser soi-même les faits qu'on observe, sans passion,
sans idée arrêtée d'avance, et surtout ne pas se lancer dans la poésie.
Exemple : Qui ne connaît ce vieux cliché de l'aigle fixant le soleil ?
Dans quel but s'abîmer un organe aussi nécessaire, et qui est aussi délicat
chez l'oiseau que chez l'homme ? De ce que l'aigle a une troisième paupière,
vieux souvenir de son origine de reptile, on en a déduit qu'il devait s'en
servir pour tempérer les rayons de l'astre du jour, à la façon des verres noirs
qu'on met aux télescopes pour pouvoir étudier le soleil.
A quoi sert cette membrane ? Nous n'en savons rien au juste : tout ne
sert pas dans la nature, malgré ce qu'on en a dit. Ce qu'il y a de positif,
c'est que cette membrane, appliquée sur l'œil, est parfaitement opaque ; elle
ne tempère pas, elle obstrue complètement ; et cela, la membrane collée sur
l'œil, comme elle l'est dans l'oiseau, chaude, vivante, et n'ayant pas encore
eu le temps de changer d'état.
Puis, nous pouvons assurer n'avoir jamais vu fixer le soleil à un aigle
superbe que nous avons gardé de nombreuses années. Ce qui a pu faire naître
cette idée, c'est probablement la pose curieuse qu'ils prennent lorsqu'ils font
sécher leurs plumes après s'être baignés. En les regardant attentivement, on
remarque qu'ils ne fixent rien, mais qu'ils sont dans une espèce d'extase causée
par le réchauffement. Au reste beaucoup d'oiseaux en font autant, les corbeaux,
les vautours, etc.
Buffon est le père et le maître de ce genre d'observations faites avec
des lunettes prismatiques. Depuis, son école a été suivie, et on en a énoncé de
bien curieuses.
Prenons entre mille quelques-unes de ces assertions erronées.
L'observateur humoristique, le charmant peintre des animaux, Toussenel,
attribue le ronflement que produit un faucon, qui du haut des airs plonge sur
sa proie, à la dilatation de l'air dans les organes de l'oiseau. Une balle, un
boulet ronflent aussi : ne serait-il pas plus simple d'attribuer les mêmes
effets aux mêmes causes. Puis, nous ferons remarquer que ce phénomène produit
par un oiseau beaucoup plus gros amène une explication complémentaire. Si, au
lieu d'écouter tomber un épervier, on écoute le bruit produit par le grand
aigle, le bruit change, se perçoit mieux, l'oreille s'explique sa nature, et
comprend qu'il est composé pour une bonne part du flassaiement violent des
pennes des ailes les unes contre les autres ; leur élasticité leur faisant
faire l'office de languette.
Dans un grand article sur le vol des oiseaux, M. Quatrefages a dû faire
des erreurs d'observation. Nous citons cette relation, quoique déjà assez ancienne
(1), pour montrer ce que l'analyse peut permettre d'assurer.
Parlant d'une tourmente en Biscaye, il dit avoir vu des aigles de mer,
aux couleurs roussâtres, etc..., volant dans ces grands courants d'air. Il doit
s'être glissé une erreur, probablement dans la spécification de l'oiseau, car,
si la tempête était forte, les pygargues et les balbuzards étaient perchés,
ainsi que tous les voiliers, dont aucun ne peut tenir le large par les grands
vents. Il avait assurément d'autres oiseaux sous les yeux.
Si cet éminent savant avait pu voir le spectacle qu'il nous fut permis
d'étudier, il serait persuadé de cette vérité : Sur la côte d'Algérie, au bord
de la mer, par un siroco effroyable, un grand aigle bouleversé par le vent
était entraîné au large. La malheureuse bête était-elle roulée,
(1) Bulletin de la
Société d'acclimatation, Décembre 1869.
mise sens dessus dessous ! Ses
ailes étaient littéralement fermées. Au moindre développement de surface,
c'étaient des bonds prodigieux dans l'espace : cent mètres de hauteur étaient
franchis en cinq secondes. Il y eut là une lutte d'un quart d'heure, émouvante
au suprême degré. Que de mouvements, que de détours, quelle activité déployait
ce puissant animal dans cette lutte contre la tempête ; et pendant ce temps les
procellarias et les goélands, tout à fait à leur aise, complètement dans leur
élément, chassaient sur les vagues en fureur avec une aisance indescriptible.
Ce
qui démontre que tous les oiseaux n'ont pas les mêmes aptitudes dans le vol,
que l'aigle n'est pas organisé pour se mouvoir dans les courants d'air trop
rapides, et que cette vitesse de l'air est parfaitement acceptée par d'autres
familles de volateurs.
Il faut observer juste aujourd'hui.
Les envergures immenses, les poids monstrueux ne sont plus acceptables.
— Il faut la mesure exacte et le poids précis d'un animal, à l'état de nature,
et en parfaite santé.
On trouvera certainement dans les jardins zoologiques des animaux
engraissés par la stabulation et une nourriture exagérée, qui offriront des
poids excessifs, assurément doubles de ceux qu'ils ont à l'état de nature : ces
poids doivent être rejetés.
Ce sont des moyennes qu'il faut. Ainsi nous sommes fier de pouvoir
offrir le poids moyen d'une hécatombe de 8 gyps fulvus, qui est de 7240
grammes.
Quant aux mesures de l'oricou, nous regrettons vivement de ne pouvoir
offrir une forte moyenne, car c'est pour nous l'oiseau le plus intéressant que
nous puissions rencontrer dans l’ancien continent.
Il est surtout indispensable que l'observateur soit assez ornithologue
pour pouvoir préciser l'oiseau qu'il a devant les yeux, non seulement lorsqu'il
est sur la table de dissection, mais encore au loin, au repos, et surtout au
vol.
Ce savoir ne s'acquiert ni dans les livres ni dans les cabinets
d'histoire naturelle : il faut pour l'obtenir étudier beaucoup le grand livre
de la nature, se rendre compte des mouvements, opérations, évolutions des
oiseaux : savoir toutes leurs manœuvres, et surtout les comprendre ; sans cela
jamais on n'arrivera. Si on ne comprend pas ce que fait l'oiseau dans telle
position donnée, comment veut-on pouvoir l'imiter ?
On doit se poser constamment des problèmes que l'on voit se réaliser une
fois ou l'autre.
Ainsi, je me persuadai à priori qu'un fin voilier pouvait par une bonne
brise s'élever d'un point directement en l'air, et avancer malgré cela contre
le vent. — J'étais persuadé que le fait était possible. — J'attendis des années
avant de voir se produire cette évolution. Enfin, un jour, en Afrique, deux
aigles en amour me donnèrent ce spectacle. L'un d'eux s'élança du sommet d'un
frêne où ils étaient perchés, s'abaissa au vent de deux ou trois mètres, fut
relevé par une rafale et s'éleva ainsi, directement, lentement, à une centaine
de mètres en l'air, ayant gagné au vent au moins cinquante mètres ; et cela,
sans un seul battement.
De pareilles démonstrations ne se voient pas tous les jours, il faut les
chercher avec persistance ; il faut avoir le feu sacré de cette étude, il faut
y être attiré par un je ne sais quoi qui fait que certaines évolutions vous
font battre le cœur.
On doit désirer voir beaucoup, et faire ce qu'il faut pour bien voir ;
recueillir les faits, se les expliquer si on peut, et on le peut ordinairement
avec de l'intelligence et du bon sens. Cependant il y a certaines évolutions
dont on ne peut trouver la raison d'être, témoin la suivante : 23 mai 1876.
Vu des milans planer et rester presque immobiles dans l'air. Il fait un
vent du Nord faible. Ils sont tous très haut, ont la même allure, le bec au
vent, avançant et montant, faisant à certains moments, tous ensemble, un rond
ou deux : c'est probablement une zone d'air rapide qui passe. — Ce que ces
oiseaux font aujourd'hui, avec un vent qui n'a rien de particulier, ils peuvent
le faire dans d'autres moments, cependant ils ne le font pas. — Quelle est la
cause de ce changement dans leurs habitudes ? — Éducation des enfants finie :
ce qui est exact à cette époque. Quoi dire ? En tous cas il y a quelque chose
de particulier, car à 7 heures 1/2 du matin ils ont appétit ordinairement, et
aujourd'hui il n'y paraît guère. —Peut-être un temps électrique particulier. —
En somme ils font ce matin des tours de force, des démonstrations très
intéressantes, par un vent du nord, très moyen, frais pour le Caire, 21°, et un
temps très beau.
Il est rare qu'on ne trouve le pourquoi d'une manœuvre ; puis, ce qu'on
ne comprend pas la première fois est expliqué par une autre observation faite
dans des conditions meilleures.
En tous cas, pour apprendre, il faut avoir l'amour de cette étude.
Je me souviendrai toute ma vie du premier vol de gyps fulvus que
je vis. J'en fus tellement impressionné que de la journée je ne pus penser à
autre chose. Au reste il y avait de quoi, c'était la mise en pratique de mes
idées théoriques sur le vol. — Depuis, j'ai vu bien des milliers de vautours,
j'ai bouleversé beaucoup de ces énormes troupeaux d'oiseaux ; malgré cela je
n'en puis voir passer un dans l'atmosphère sans l'accompagner des yeux jusqu'à
l'horizon.
L'observation demande enfin un bon choix de modèles.
Les observateurs français les choisissent forcément mal : ils étudient
les rameurs excessifs tels que les pigeons, les chauves-souris, voire même les
insectes.
Quel profit tirer d'un modèle qui n'est pas imitable en grand ? — Il est
impossible de reproduire mécaniquement sur de grandes proportions un insecte,
un moineau, ni même un pigeon : en quelle matière construire un appareil
capable de supporter des battements aussi énergiques que ceux que produit le
moineau par exemple ? L'acier n'est pas assez nerveux par rapport à son poids.
Ensuite, pourquoi étudier ces animaux ? cette puissance, ils l'ont, ils
s'en servent, mais elle ne leur a pas été donnée par la nature seulement pour
voler, mais bien pour chasser, pour fuir ou pour lutter. — Puis, ne serait-il
pas plus rationnel de s'adresser aux modèles faciles à reproduire qu'aux
difficultés ? Imiter la nature dans ses tours de force est déjà très beau, mais
vouloir la surpasser semble peu logique : car c'est vouloir la surpasser que de
chercher à faire des appareils rameurs de cent kilogrammes, quand, elle, ne
peut guère dépasser deux kilogrammes.
Le bon sens indique que quand on n'est pas fort il faut chercher à
reproduire ce qui demande le moins de force. — Quels sont les oiseaux qui,
quoique franchissant de grandes distances, le font avec le moins d'efforts ?...
ce sont les grands voiliers.
Mais, objectera-t-on, ces oiseaux ont au contraire une force musculaire
énorme ; les aigles, les vautours, sont construits pour pouvoir en dépenser
beaucoup : cette puissance leur est donc indispensable ?
— Oui, certainement, ils ne peuvent même pas s'en passer pour soutenir
la lutte pour l'existence : mais, entre vivre de la vie de l'oiseau, vie de
combat, de peur, de chasse, et vivre de la vie de l'homme, qui, lui, ne craint
rien, le problème n'est pas le même ; c'est la lutte permanente comparée à la
sécurité absolue.
Que craint l'homme ? Rien, l'orage et son semblable : en temps de paix
ce dernier est négligeable ; quant à l'orage, rien ne le force à l'affronter.
Pour l'oiseau, c'est tout différent ; il peut être obligé, à chaque
instant, de prendre l'air, et rondement ; il lui faut donc une puissance énorme
pour pouvoir fuir à toute vitesse par des temps impossibles.
Au reste, cette puissance est proportionnelle aux besoins.
Comparons deux grands oiseaux voiliers, l'aigle et le vautour ; la
différence de genre de vie amène la différence de facultés. — Ils n'ont qu'un
ennemi tous les deux : c'est l'homme ; seulement, l'un vit de proies vivantes,
et l'autre de cadavres. — Pour exister, le premier est obligé de chasser, de
combattre un animal, qui, s'il ne se défend pas, développe en place toutes les
facultés pour fuir. Aussi son vol est-il puissant à l'extrême : il bat l'air
comme un rameur, ses exercices sont variés ; c'est le faiseur de tours de
force.
Le vautour au contraire ne craint pas grand’chose, tout au plus un coup
de fusil de quelque curieux, quand il s'en rencontre dans son pays ; et cette
catégorie d'hommes a toujours un costume insolite, qui éveille de loin son
attention. Il n'a, en résumé, besoin pour vivre que de pouvoir distinguer de très
loin un animal mort. Aussi que sait-il faire ? Monter très haut, pour de là
voir très loin, s'y maintenir sans fatigue, descendre lentement après avoir
bien étudié les lieux et s'être assuré qu'il peut se poser sans danger, qu'il
ne sera pas surpris, et surtout obligé de repartir précipitamment. — Aussi son
vol s'en ressent : pas de dépense de force, c'est le roi des flâneurs, toujours
à la voile ; ses grandes ailes ne battent que pour se dérouiller. Il fera dix
kilomètres pour réussir à se poser sans choc, dix lieues pour avancer d'une ;
il a le temps, et a juré de ne jamais battre. — Au reste, rien n'est beau comme
l'allure de cet énorme oiseau ; on ne peut en voir passer un sans s'arrêter et
contempler cette majesté dans le mouvement. Ce sont d'immenses cercles
parcourus lentement, sans ressauts ni arrêts ; puis, quand il prend le vol
rectiligne, c'est avec une fixité imposante qu’il se meut, il ne louvoie pas ni
à gauche ni à droite, ni en haut ni en bas : il pénètre.
C'est le modèle par excellence de l'étude qui nous occupe : la cigogne,
à côté de lui, est une fauvette, le milan un papillon, et le faucon une plume.
Celui qui a vu cinq minutes un oricou au grand vol, et qui n'a pas
reconnu la possibilité de la direction aérienne, est au moins... mal organisé
pour l'analyse.
ESSAI
D'ORNITHOLOGIE
AU POINT DE VUE DU
VOL
Il nous faut faire ici un petit cours d'ornithologie, cours ayant trait
à une question vitale des oiseaux : le vol ; question presque complètement
oubliée dans les traités.
Le vol est la propriété par excellence de l'oiseau : passons une revue
rapide des êtres qui peuvent se mouvoir dans les airs.
La première classe, en commençant par les plus infimes, est l'insecte. —
Tous, moins les papillons paon de jour et deux ou trois autres grands
lépidoptères, qui ont des instants où leur vol est un glissement, sont des
rameurs. Leurs ailes sont des plans élastiques, qui agissent sur l'air par la
différence d'élasticité qu'il y a chez elles entre leur exhaussement et leur
abaissement.
Le docteur Marey a donné des descriptions et des tracés graphiques du
vol des insectes excessivement intéressants : c'est le dessin du mouvement
reproduit d'une manière exacte : il n'y a rien à désirer au-delà.
Les reptiles n'ont de nos jours à nous offrir qu'un petit lézard des
Indes, le draco volans, qui est un glisseur. Le plus grand espace qu'il
puisse franchir se borne à quelques mètres ; c'est d'une branche à l'autre
qu'il s'élance.
Les temps géologiques nous offrent des spécimens infiniment plus
intéressants. A l'époque du lias, la nature créa une famille de reptiles dont
la vie devait se passer dans les airs. Les ptérodactyles durent, pour pouvoir
vivre, avoir la faculté de se mouvoir et de stationner dans les gaz, tout comme
les oiseaux de nos jours.
La classe des poissons est, comme on peut s'y attendre, très pauvre en
êtres pouvant voler ; une douzaine d'espèces peuvent s'élancer, se soutenir
quelques mètres à force de battements, et tout se borne là.
En mer, par les beaux jours de la fin de l'été, il arrive quelquefois
que le navire traverse des parages garnis de poissons volants.
Celui qu'on rencontre le plus communément dans la Méditerranée est un
véritable volateur ; il s'élance de l'eau avec une force de projection qui
pourrait l'élever, d'après une estimation basée sur des journées entières
d'observation, à environ deux mètres de hauteur ; mais, pas avec plus de force
que cela. Arrivé au sommet de ce saut, ses nageoires, dont il se sert comme un
rameur, et qui reproduisent tout à fait le vol de la sauterelle du désert, le
soutiennent et le transportent ordinairement, droit contre le vent, à des
distances qui varient entre quelques pas et 200 mètres. L'espace moyen qu'il
parcourt est d'environ 75 mètres ; puis il retombe dans l'eau, probablement
gêné par la dessiccation de ses membranes et de ses branchies. Il semble plus
redouter le dessèchement que la fatigue, car on voit souvent ces poissons,
après s'être simplement mouillés dans une vague, repartir avec un élancé
assurément très faible, et fournir une seconde et quelquefois une troisième
carrière semblable à la première. Dans la mer Rouge et dans la mer des Indes on
rencontre quelquefois des poissons volants de la grosseur d'un merlan
ordinaire. Ils sont aussi rameurs, mais déjà se produisent de courts instants,
de deux ou trois secondes, où les battements cessent, et où le glissement se
produit.
Les mammifères possèdent toute une grande famille qui jouit de cette
faculté à un degré très grand, comparable, sous beaucoup de rapports, aux
oiseaux les mieux doués : ce sont les chéiroptères, presque tous rameurs ; les
grosses espèces ont seules quelques demi-voiliers. — Les galéopithèques et les
écureuils volants sont deux classes d'animaux qui sont à l'enfance de l'art du
vol ; elles se servent plutôt du parachute que des ailes. Leur étude offrirait,
malgré cela, un très grand intérêt.
Il faut, malgré ces exceptions, reconnaître que l'ensemble des
mammifères est organisé pour rester sur la terre. Aux oiseaux le royaume de
l'air : chez eux les exceptions sont ceux qui ne peuvent utiliser ce mode de
locomotion ; quelques palmipèdes et quelques struthions comprennent seuls cette
classe de déshérités de la nature.
Le vol est bien certainement la plus belle manière de se mouvoir que la
nature ait donnée à ses créatures. — Tous les oiseaux n'en jouissent pas
également ; cependant, on ne peut nier que toujours un animal a un vol
approprié à ses besoins. Au reste, le contraire supprimerait l'existence, ou au
moins l'entraverait.
Quel est l'oiseau le mieux doué ?
Question souvent posée, et sur la solution de laquelle on est rarement
d'accord.
Est-ce l'aigle au vol majestueux ? — Il est beau certainement ce roi des
airs, mais une humble colombe le dépasse au vol comme un lévrier dépasse un
mâtin.
Est-ce la frégate à l'immense envergure ? Non assurément, la frégate est
incapable de s'envoler dans beaucoup de circonstances.
Sont-ce les grands vautours ? Non plus ; il faut trop d'espace à leurs
vastes ailes pour que leur vol puisse réunir toutes les qualités qu'exige la
primauté. Un condor ne peut pas s'élever rapidement, sans vitesse acquise,
comme un passereau.
Serait-ce notre charmante hirondelle, si vive, si preste, si agile ? Pas
d’avantage ; elle a le défaut de sa taille qui est celui de ne pas pouvoir
résister à un coup de vent. Son peu de masse la gêne énormément dans tous les
grands courants d'air.
Ce sont les passereaux qui priment pour le vol. Vitesse, promptitude,
difficultés, tout est résolu par eux. Cependant ces oiseaux, en un an, ne fout
pas le trajet que les oiseaux de mer franchissent en un mois.
Après ces remarques, il est facile de conclure, et de dire avec raison
que tout oiseau vole parfaitement bien suivant ses besoins.
Nous prendrons donc le moineau comme type de la perfection du vol. Comme
vitesse, il est capable de poursuivre avec succès un pigeon ; comme puissance,
il peut monter perpendiculairement à une grande hauteur. Comme grand parcours,
il est à la hauteur de la généralité des autres oiseaux, car il a aussi ses
migrations périodiques.
Ce choix, au premier abord, peut paraître curieux : cependant, on
remarquera que les grandes difficultés du vol sont résolues par les petits
oiseaux. — Les fauvettes, sylvies, oiseaux-mouches, colibris, font des tours de
force constants. On peut même à ce propos poser comme loi d'ornithologie que : La
force proportionnelle est en raison de la petitesse.
On n'observe généralement pas cette puissance ; cependant, remarquons
l'élasticité métallique des muscles d'une fauvette qui tourbillonne aux hasards
d'une chasse à la mouche : remarquons ces battements précipités, produisant une
vibration presque harmonique. Un condor dont les pectoraux pourraient produire
de tels battements aurait besoin d'ailes d'acier, et produirait un bruit
comparable il celui du tonnerre.
ÉTUDE DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR DE L'OISEAU
Les ailes et la queue sont employées par les oiseaux pour se soutenir
dans l'air.
Les ailes, organes principaux de la sustention, sont composées
d'humérus, de radius et de cubitus, de carpes et de métacarpes, plus ou moins
soudés, auxquels sont adaptées des plumes.
De la longueur de ces bras, et de la longueur de ces plumes, dépendent
les différentes propriétés du vol.
VARIÉTÉS DE FORMES
D'AILES
Les ornithologistes ont divisé les
différentes formes d'ailes en deux groupes : ailes aiguës et ailes obtuses ;
puis chacune de ces divisions en sur-aiguës, aiguës, et sub-aiguës ;
sur-obtuses, obtuses et sub-obtuses.
Ce mode de classement, tout excellent qu'il est, n'est cependant pas
suffisant ; il faut, pour pouvoir expliquer avec fruit les nombreux faits que
présente l'observation, préciser infiniment plus que ne le font ces divisions
par trop génériques : il faut tenir compte de la surface de l'aile par rapport
l'oiseau, de la longueur de l'aile par rapport à sa largeur et par rapport à la
masse ; enfin d'une foule de circonstances qui font qu'il faut une étude
particulière du vol de chaque famille pour en avoir une idée satisfaisante.
Il résulte de l'étude de toutes ces conditions, étude dont on trouvera
un essai plus loin, qu'on peut établir une série de grandes divisions qui
peuvent se condenser dans les observations suivantes.
On peut affirmer :
Qu'un oiseau qui a des ailes longues et larges est fait pour planer :
qualité qui croît-avec la masse.
Que celui qui les a longues et minces est fait pour voler dans les
grands courants d'air, et cette qualité croît aussi avec le poids.
Que les ailes courtes et larges indiquent un vol de peu d'étendue.
Enfin que les ailes courtes et étroites dénotent une grande vélocité
comme vitesse rectiligne. On peut même poser que : La vitesse est en raison
inverse de la grandeur de la surface.
Il ne faudrait cependant pas aller jusqu'à l'absurde parce que, à ce
compte, les aptérix seraient les volateurs les plus rapides ; mais on peut dire
que chez les oiseaux qui volent réellement, la vitesse rectiligne (parce
qu'elle l'est toujours et forcément) augmente avec la diminution de la surface
des ailes. Tout le monde connaît la vélocité des canards, sarcelles, imbrims,
etc., et comme opposition, la lenteur des hérons, des vanneaux et de l'effraie.
Il est inutile que nous nous étendions plus longuement sur ces principes
fondamentaux, parce que nous les verrons constamment expliqués et appliqués
dans l'étude du vol de chaque famille.
DE LA QUEUE
La queue est un appareil destiné à soutenir, à diriger et à tenir en
équilibre l'oiseau.
Elle est formée par une série de
vertèbres, de nombre variable, munies de muscles pour les mouvoir, et garnies
de plumes.
La queue chez les oiseaux est très utile, mais non indispensable. Un
oiseau privé de sa queue vole, de son vol à lui, au bout de quelques jours,
sans beaucoup de différence ni de difficulté.
Dans plusieurs espèces elle est un pur ornement plus gênant qu'utile,
comme chez le paon, le ménure- lyre, le couroucou pavonin, la veuve, le
paille-en-queue, les perroquets, etc. Privez-les de cet appendice, ils n'en
voleront pas beaucoup plus mal ; au reste la nature les soumet périodiquement à
cette épreuve.
Beaucoup d'oiseaux très fins voiliers ont des queues rudimentaires : les
hérons, les albatros, les canards, sarcelles, pélicans, goëlands, etc.
Dans d'autres cas elle grandit ou diminue sans cause apparente, comme
chez la tourterelle sauvage et la tourterelle d'Égypte, la pie et le geai, le
gypaète et l'aigle bateleur.
La grandeur de la queue est toujours un signe de faiblesse du vol,
surtout lorsqu'elle atteint de grandes dimensions.
Laissons donc de côté cet organe qui ne peut donner que des indications
trop vagues pour être utilisées.
Cependant, si on tenait à se rendre compte de la cause, du pourquoi de
l'existence de cet organe, surtout lorsqu'il est robuste, on arrive à cette
déduction.
La queue, chez l'oiseau, est ou un ornement ou un organe du vol. —
L'ornement n'intéresse pas cette étude : négligeons-le.
Comme organe du vol, la manœuvre suivante pourra nous éclairer.
Un faucon crécerelle suivait une haie, presque rez terre, et tout contre
elle ; sa vitesse était ordinaire, et sa direction rectiligne, quand tout à
coup, comme mu par un ressort, il changea de direction à angle droit pour se
précipiter sur un lézard.
L'angle produit fut d'une précision et d'une rapidité incroyable.
Pour le produire, l'oiseau a eu besoin du gouvernail très ample et très
puissant qu'il possède.
Là est l'utilité du grand développement de cet organe, il est destiné à
permettre la surprise par des changements subits de direction.
Il est probable que la forte queue du gypaète a la même utilité : cette
manière de chasser, à coup de poitrail, parmi les blocs de rocher, doit être
facilitée par l'ampleur et la force de sa queue.
En résumé, c'est un organe destiné à produire le vol de chasse, mais
qui, par rapport au vol réel de longueur, n'est pas indispensable, comme on le
démontre au reste en la supprimant.
On arrive donc à penser ceci, que la queue est l'organe qui sert à
produire un changement de direction rapide ; et ce qu'il y a de curieux, c'est
que, quand l'oiseau ne l'emploie pas, elle donne la rectilignité à son vol. —
Ce qui pourrait se résumer ainsi :
L'aptitude au changement de direction est en relation avec l’ampleur
et la puissance de la queue.
C'est seulement au point de vue théorique que nous faisons abstraction
de l'utilité de cet organe. Il est certain que l'adresse permet l'équilibre
constant sur deux points d'appui seulement : témoin nos deux jambes, les
échasses, le vélocipède, etc. ; mais, au point de vue de la pratique, un
troisième support devient bien utile, il apporte la stabilité absolue, évite
cette attention de tous les instants qu'il faut avoir pour ne pas choir.
Ce troisième appui existe même chez les oiseaux à queue rudimentaire. —
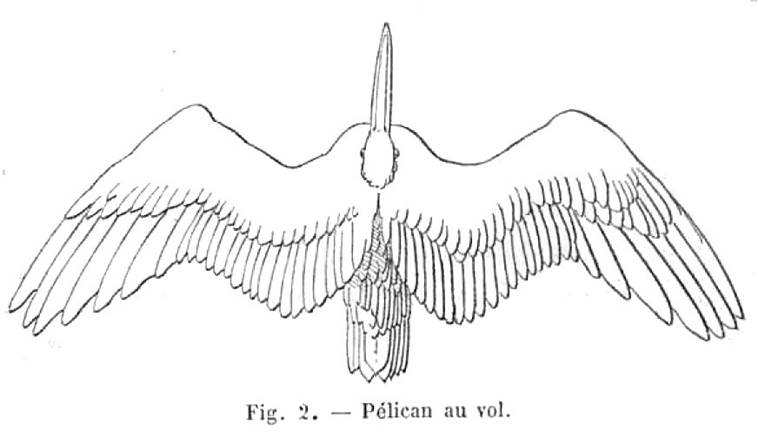
Fig. 2 –
Pélican en vol
Prenons par exemple le pélican, qui
ne brille pas par le développement de son appendice caudal : nous remarquons
que la forme générale de son corps y supplée. Au vol il a la tournure suivante.
C'est, comme nous le voyons, dans l'angle très prononcé que forment son
bras et son avant-bras qu’il trouve l'espace dans lequel peut jouer son centre
de gravité sans entrer dans l'équilibre instable. — Ce qui nous amène
incidemment à remarquer que : Les oiseaux sans queue ont tous l’avant-bras
très long.
La queue, pour agir, demande un vent assez fort, ou une vitesse assez considérable
: ce qui est tout un en aviation. Si l'oiseau n'avait qu'elle pour manœuvrer,
dans les cas de vol lent ou de vent faible, certains mouvements deviendraient
impossibles. — Il supplée, comme nous le verrons, au manque d'action de cet
organe, par une série de manœuvres qui produisent les mêmes effets d'une
manière bien plus efficace.
VOL DES RAMEURS
Prenons-le au point de départ.
L'oiseau est à terre, il s'abaisse sur ses jambes pour s'élancer, et
laisse pendre ses ailes.
Étudions ce premier mouvement : l'aile se divise en trois plans, un
formé par l'humérus, l'autre par le radius et le cubitus, et le dernier par la
main. — L'effet produit par la disposition de ces trois plans est de laisser
facilement glisser l'air en présentant des surfaces inclinées.
Là ne se borne pas la décomposition de ce mouvement : toutes les plumes,
surtout celles du bout de l'aile, s'inclinent de manière à traverser l'air par
leur tranche et non par leur plat. — Puis, autre complication, l'aile n'est
jamais élevée étendue, mais bien repliée sur elle-même, de manière à présenter
le moins de surface possible, et à pouvoir produire le mouvement avec moins
d'effort et plus de vélocité.
Voyons maintenant le second mouvement, l'aile de l'oiseau frappant
l'air.
Celui-ci est simple, l'aile est tout étendue, raide, les plumes
garnissent toute la surface, et l'aile est creuse.
Il y a donc grande différence de résultat obtenu entre l'élévation de
l'aile et son abaissement ; — cette différence est ce qui constitue le bénéfice
du vol des rameurs.
Pour pondérer cette différence d'une manière exacte, pour la palper pour
ainsi dire, il faut prendre par la tête de l'humérus une aile fraîche de très
gros oiseau, et exécuter avec la main ces deux mouvements. Cet exercice fera
mieux comprendre le vol que toutes les descriptions et explications possibles :
on est près, on voit bien, on sent les efforts nécessités par les deux
manœuvres, et on les juge parfaitement.
L'élancé donné par les pattes, et ce premier battement, ont enlevé
l'oiseau, qui répète rapidement ce battement et s'élève donc en l'air, non
perpendiculairement, mais dans un angle de 45 degrés. Pour s'enlever
perpendiculairement, l'oiseau est obligé de beaucoup se renverser : manœuvre
difficile, employée quelquefois par les pigeons pour se déraidir les ailes dans
le pigeonnier.
Pour changer cette direction de 45 degrés en un mouvement horizontal,
l'oiseau se sert de sa queue, qu'il abaisse, et qui produit sous l'action de la
vitesse, et même quelquefois d'un léger battement particulier, une
décomposition de forces, dont la résultante est un changement de direction de
45 degrés à l'horizontale.
Si la queue est impuissante, il se sert de ses deltoïdes qui relèvent
son corps et produisent aussi ce changement. Au reste, les oiseaux emploient
ordinairement ces deux moyens simultanément.
Le mouvement horizontal étant obtenu, le vol change un peu à mesure que
la vitesse augmente, l'aile ne frappe plus exactement perpendiculairement, mais
légèrement dans le sens de la vitesse pour l'accélérer.
Certains rameurs exceptionnels, pour acquérir une grande vélocité,
exagèrent ce mouvement. Le battement, chez eux, non seulement soutient, mais
surtout pousse en avant.
C'est cette manœuvre qui procure au faucon la célérité extraordinaire
qu'il possède, malgré qu'il ait une masse faible et une grande surface. — La
tourterelle bien lancée semble faire des sauts avec ses ailes ; le coup de
fouet est si rapide et si violent, sa vitesse est si grande, qu'à chaque battement
correspond un bond, non pas en hauteur, mais en avant : elle se projette à
grands coups d'ailes. Dans certains cas ces coups de fouet produisent un son
presque semblable à celui que produirait l'aile si elle frappait sur un corps
solide.
VOL DES VOILIERS
Plusieurs naturalistes ont donné des explications curieuses du vol des
oiseaux, surtout du vol des voiliers.
— Pour eux la légèreté est tout.
Ils ont désigné la porosité des os, les espaces remplis d'air, qui se
trouvent quelquefois sous la peau de ces animaux, comme des dispositions
indispensables à la station dans l'air.
Il n'en est rien. — Les oiseaux ont toujours une grande densité,
parfaitement la même que celle des mammifères ; privés de plumes ils ne
surnagent pas dans l'eau : ils ont donc 1 pour densité, tout comme l'homme, les
mammifères et les poissons.
Pour bien s'expliquer le vol, il faut considérer l'oiseau comme une
machine qui se soutient par la force déployée par ses pectoraux, comme un
glisseur, comme un patineur, mais non comme un ballon. Tous ces appareils de
dilatation des fous, des pigeons ; tous ces os creux des pélicans, albatros,
etc., ne servent à rien pour le vol, leur utilité est ailleurs.
Au reste, rien n'est plus facile à expérimenter : coupez les plumes du corps
à un oiseau, ne lui laissez que les plumes des ailes et de la queue, son vol
n'est changé en rien ; il aura froid, ne pourra pas nager si c'est un oiseau
d'eau, mais il n'en volera assurément pas plus mal.
Expliquons maintenant le vol des voiliers.
Les oiseaux planent en raison de la grandeur de leur surface et de
l'importance de leur masse.
N'oublions pas ce principe indiscutable. Un gros oiseau, un moyen et un
petit oiseau, tous trois de mêmes surfaces proportionnelles à leurs poids,
planeront d'autant mieux qu'ils seront plus lourds.
Ne nous occupons donc que des gros, ceux-ci seulement peuvent effectuer
les décompositions de force qui produisent le vol sans battement d'ailes.
Comme le voilier au départ est toujours rameur, à moins d'être perché
sur une hauteur d’où il s'élance, nous le supposons en l'air, possédant une
vitesse acquise.
Sans bouger les ailes il glissera.
S'il n'y a aucun vent il ira tomber à terre, à une distance qui sera en
raison, toujours de sa surface, et surtout de l'importance de sa masse ; par
conséquent, un arrian ira plus loin qu'un vautour fauve, et ce dernier qu'un
percnoptère ; cependant ils sont construits à peu près dans les mêmes
proportions.
Sans
vent le voilier tombe, son vol n'est plus possible, il est obligé de devenir
rameur ; c'est ce qui fait qu'il est rarement matinal, parce que la matinée est
ordinairement calme, surtout dans les pays chauds.
Admettons maintenant l'existence d'un courant
d'air, ce qui arrive presque toujours à une certaine hauteur dans l'atmosphère.
La scène change, le voilier décrit des cercles, s'élève en l'air à une
grande hauteur, puis de là se laisse glisser dans la direction où il veut
aller, même contre le vent.
Essayons d'expliquer ce fait.
L'oiseau se laisse glisser dans la direction du vent en s'abaissant le
moins possible, le vent lui donne une vitesse presque égale à lui-même en
s'engouffrant dans toutes les plumes qu'il retrousse. — Cette poussée par
l'arrière est puissante ; il y a prise, tandis que quand il est le bec au vent,
toutes les plumes sont lissées, collées les unes contre les autres, et
présentent des surfaces parfaitement construites pour avoir le moins de
frottement possible. — Cette différence d'action est comparable à celle de ces
moulins à vent, formés de plusieurs entonnoirs, dont le mouvement est produit
par la différence de résistance présentée à l'air entre la pointe et l'arrière.
Comme l'oiseau tourne, il arrive à se retrouver à marcher contre le vent
; là se produit le résultat demandé, l'élévation.
Nous énonçons sérieusement cette fraction d'explication, parce que cette
action est beaucoup trop négligée, et qu'elle est réellement utile à l'oiseau.
Arrivé à cette partie du cercle qu'il décrit, le voilier dispose ses
ailes et sa queue de manière à remonter un peu, de sorte que sa vitesse
acquise, se heurtant contre la force du vent, l'élève plus qu'il n'a baissé
pour acquérir sa vitesse.
En résumé, le bénéfice de l'opération, le résultat obtenu comme
exhaussement est donné par la force du vent, qui n'agit pas également lorsque
l'oiseau lui présente son avant ou son arrière.
Le voilier répète ce mouvement et gagne de la hauteur à chaque tour :
ces cercles sont d'autant plus concentriques que l'oiseau a plus de masse et
que le vent est plus faible. Cependant, même chez ceux qui sont le mieux doués
pour produire les décompositions de forces les plus approchées de la théorie,
le cercle n'est exactement concentrique que dans un cas, c'est quand le vent
est nul ; en attendant le courant vivificateur ils figurent l'ascension pour se
soutenir, mais ne la produisent pas ; ce qui fait illusion et trompe presque
toujours l'observateur, à moins qu'il ne soit placé il la même hauteur que l'oiseau.
Il ne faudrait pas cependant attacher une importance trop grande à cet
effet de prise du vent sur les plumes ; le problème se compose d'autres
éléments que celui-ci. La variation des surfaces offertes à l'action du vent
dans les différentes parties du cercle décrit, et la variation de vitesse ou
variation de position du centre de gravité, sont autant de facteurs dont il
faut tenir compte.
L'exhaussement se produit par le bon emploi de toutes ces données, et
par le choix d'une foule de circonstances heureuses, commençant par les courants ascendants, dont on
a beaucoup parlé ces temps-ci, et sur lesquels il ne faut guère compter
; et finissant par le choix judicieux de l’instant où se produit le coup de
vent pour lui présenter l'angle utile à l'ascension. — Enfin et surtout, par
l'inégalité de longueur de la partie de la course faite avec le vent, comparée
à celle qui est faite contre lui. La brièveté de cette dernière partie comparée
à la première est d'autant plus accusée que l'ascension est plus forte.
Le bénéfice produit dans l'ascension au moyen des ronds s'observe
facilement, se comprend, mais il faut avouer que, quand on veut bien
l'analyser, il y a un endroit faible, où franchement on devient insuffisant comme
explication : c'est l'instant où l'oiseau marche avec le vent. Est-ce qu'un
excès de vitesse conservé, vitesse capable de produire la sustention,
satisferait ? Nous ne le croyons pas, car nous ne croyons pas à sa véracité
absolue, l'observation montrant qu'il y a souvent arrêt complet. En tous cas,
bien ou mal analysée, la manœuvre est très employée ; l'observation indique
même que c'est celle qui donne le plus de bénéfice d'exhaussement, puisque
c'est le procédé que le voilier emploie par le vent le plus minime.
En attendant une explication limpide, nous nous bornerons à nous en
servir de confiance, nous en rapportant à la prescience des oiseaux ; nous
pouvons le faire sans rien hasarder.
En place, une manœuvre qui supporte facilement l'analyse, et dont la
compréhension est facile, est celle de l'ascension directe, vent debout, soit
en reculant, ce qui est facile, soit sans perdre du terrain, ce qui l'est moins
; ou même en avançant contre le vent.
L'angle juste, bien présenté, joint à une surface utile pour l'instant,
et la force irrégulière du vent bien employée ; accalmie pour avancer ;
accélération de la vitesse du courant utilisée à s'élever, toutes ces
conditions réunies rendent le problème facile à comprendre.
Seulement, ce procédé d'exhaussement nécessite un vent possédant une
vitesse capable de soutenir dans tous les instants l'aéroplane qui est sans
vitesse propre, tandis que, dans le procédé des ronds, ce même aéroplane a une
grande vitesse de translation qui lui est propre, et lui permet de se servir de
vitesses de vent qui seraient, à cause de leur faiblesse, inutilisables dans le
premier procédé.
Il ne faut jamais dans les calculs supposer qu'un courant d'air a une
vitesse régulière, on serait complètement dans l'erreur ; une étude attentive
du vol des oiseaux fait voir qu'il y a des bouffées irrégulières, non seulement
à la surface, mais même jusqu'aux confins de l'atmosphère visible.
Les oiseaux ont certainement, comme les bons marins, le talent de voir
venir le coup de vent ; le frisement de l'eau qui change de couleur, devient
plus sombre, indique à l'homme de mer l'arrivée de la bourrasque. Comment font
les oiseaux pour voir venir l'air rapide ? Il est difficile de s'en faire une
idée ; cependant il est certain qu'ils s'en servent assez souvent.
Cependant, c'est là encore une base sur laquelle il ne faut pas trop
échafauder, parce que les grands planeurs dédaignent d'utiliser ces
irrégularités du vent ; ils les supportent, les emmagasinent comme impulsion
reçue, mais ne se dérangent jamais pour en profiter.
Pour se faire une idée saine de ce qui se passe dans le vol sans
battement, pour se l'expliquer, il faut séparer deux choses qu'on confond
ordinairement : le vent régulier et le coup de vent irrégulier.
Il semble, à première vue, que lorsque dans un courant d'air régulier
l'oiseau décrit un rond, il doit perdre dans la partie où il pénètre le courant
juste ce qu'il a gagné d'impulsion en étant actionné par lui, plus la perte
occasionnée par les frottements. — Nous avons vu qu'il n'en est rien, parce que
l'oiseau présente à la pénétration ses formes d'avant, qui sont d'autant plus
parfaites qu'il est meilleur volateur : formes qui n'ont aucune ressemblance
avec celles de son arrière, où tout est disposé d'une manière contraire, pour
faire voile, et être pénétré. — Maintenant, à ce bénéfice, il faut joindre la
disposition de l'angle utile présenté, la surface plus ou moins grande offerte
à l'action du vent au moment nécessaire, la petitesse relative de la course
contre le vent, enfin ces mille riens qui ne s'analysent pas, qu'on nomme la
vie, et qui font ces chefs-d’œuvre d'équilibre qui, comme la station et le
mouvement, font la partie active de l'existence.
Cependant les très gros oiseaux ne semblent pas se tourmenter beaucoup
pour utiliser tous ces petits moyens accessoires ; les maîtres dans l'art,
ayant une fois établi un angle moyen, jugé bon par leur expérience pour le
temps qu'il fait, ne changent pas facilement de tournure : ils savent qu'il
leur est inutile de se livrer à de petites manœuvres, comme diminuer ou /
augmenter la surface à chaque tour ; on dirait qu'ils mettent leur aéroplane à
un cran fixe, qu'ils savent pratiquement bon, et se reposent pour bénéficier en
élévation sur le coup de vent. Il y a bien probablement des mouvements de déséquilibrement
qu'on ne peut apercevoir à la lunette, tels que mouvements de la tête, qui est
un balancier précieux et on ne peut mieux placé ; même des mouvements
inconscients d'ensemble ; mais quant aux changements intentionnels dans la
voilure, par un vent moyen, elle peut rester des heures entières au point fixe
où elle a été mise tout comme une voile de navire. — Il nous faut donc pénétrer
plus avant dans la question, chercher une explication plus satisfaisante de
cette manœuvre. Nous la trouverons en étudiant l'effet produit par le coup de
vent irrégulier.
Le coup de vent est une puissance qui est l'âme de l'ascension : c'est
la baguette qui frappe le cerceau de l'enfant, qui lui donne la force de rester
debout, de rouler, et même de franchir des élévations. — Supposons que nous
abandonnions ce jouet à une descente rapide : l'attraction lui communiquera un
mouvement qui le fera rouler jusqu'au bas. Si en bas il se trouve une montée,
le cerceau poussé par sa vitesse acquise, par son inertie, remontera à une
hauteur égale à sa descente, moins les frottements sur le sol et la résistance
de l'air.
Mais, si au lieu de le laisser simplement aller à la sollicitation de la
chute, on accélère sa marche à coups de baguette, il pourra remonter bien plus
haut que n'est élevé le point d'où il est parti.
Si maintenant nous supposons autre chose, qu'on puisse, lorsque le
cerceau est en train de remonter, déplacer le sol, de manière à ce qu'il aille
en sens contraire du jouet, c'est-à-dire lui venir dessus, nous activerons
encore l'ascension en lui communiquant une force supplémentaire, indépendante
de son individu, dont la résultante sera encore une élévation.
Étudions maintenant l'action de ce courant d'air vivificateur sur
l'oiseau en action.
Si le coup de vent se produit dans la partie où l'oiseau va avec le
vent, c'est le coup de baguette que le cerceau reçoit par derrière ; c'est de
la vitesse emmagasinée, c'est autant de chute économisée : donc, bénéfice pour
l'oiseau d'autant.
Si c'est dans la partie du rond où l'oiseau fait face au courant d'air,
c'est son sol de glissement qui est l'air, qui se projette sur lui, et le force
comme résultante à s'élever : donc encore bénéfice d'élévation, bénéfice qu'il
ne doit pas à l'action de la chute.
Si le coup de vent le prend en travers-arrière, en travers-avant, c'est
toujours un apport d'action ; c'est toujours un lancé, une poussée qui lui est
imprimée par une force étrangère à lui-même, et dont il profite ; ou une
économie de parcours, qui se traduit encore à son avoir par un exhaussement.
Mais, au fait, toutes ces explications ne sont utiles que pour les
curieux ; elles ne prouvent ni ne déjugent rien : qu'on comprenne, qu'on
s'explique mathématiquement une manœuvre ou qu'on n'y parvienne pas, le
résultat est le même ; il n'en reste pas moins la leçon du maître omnipotent,
omniscient, qui dit : Si vous me comprenez, tant mieux ; si vous ne me
comprenez pas, tant pis ; mais en tous cas, c'est comme cela que cela s'opère
!... Je vous le démontre la journée entière, non pas dans les ténèbres, mais en
pleine nue ; et si vous ne voulez pas profiter de la leçon, c'est que vous avez
juré de ne jamais venir me rejoindre.
Ainsi agit l'oiseau !
Et que peut faire une formule qui n'arrive pas à bien ! — Que peut faire
une explication plus ou moins limpide ? — Peut-il rester un doute quand la
preuve du fait est palpable et visible à tous les instants : — l'oiseau n'est
pas sorcier, il ne viole pas les lois de la nature ; nous ne nous expliquons
pas ces mille décompositions de force d'une manière rigoureuse parce qu'elles
sont compliquées comme le mouvement et la vie ; — mais elles nous sont
démontrées à chaque instant, et c'est une invite constante à soumettre notre
vie à cet exercice, qui ne doit pas plus être au-dessus de ses moyens que les
exercices d'équilibre que notre organisme opère inconsciemment à chaque instant
de l'existence.
Nous expliquons-nous bien la marche, le saut, la gymnastique ; les
mouvements du vélocipède, les changements de direction qui l'équilibrent
ont-ils été calculés mathématiquement ? Non. — Notre instinct de vie suffit à
cette analyse, non seulement exactement, mais encore avec la rapidité
nécessitée par le besoin. — lien sera de même assurément pour cet autre
problème d'équilibre qui lui ressemble fort : l'aviation ; la vie, ce
chef-d’œuvre de science inconsciente, se trouvera certainement à la hauteur de
ce nouvel exercice.
Il s'agira seulement de bien savoir ce que l'on doit faire, d'être bien
au courant de la manœuvre qui produit tel effet que l'on désire produire ; en
somme, savoir à fond son métier d'oiseau, tout comme on arrive à savoir ceux de
glisseur, patineur, nageur, vélocipédiste, danseur de corde, et en somme de
tous les exercices gymnastiques.
VITESSE DU VENT
Le vent est pour les voiliers la
source de tout bénéfice de sustention. Sans vent, pas d'ascension, donc pas de
vol possible pour eux ; aussi par le calme plat sont-ils tous perchés.
Quelle est la vitesse de vent minimum qui peut cependant soutenir et
exhausser le meilleur voilier.
L'observation fait remarquer des ascensions de
milans et de vautours par le calme plat exact. Cependant cela est un fait
impossible. Il faut absolument qu'à une certaine hauteur l'air ait un mouvement
sensible, peut être indiscernable à l'œil, mais qui cependant est décelé par
les manœuvres de l'oiseau.
Un voilier qui s’élève par un temps calme rame ordinairement jusqu'à une
centaine de mètres, et arrivé à cette hauteur commence à décrire ses ronds,
moitié ramant, moitié planant, diminue les battements à mesure que l'élévation
augmente et finit par les cesser tout à fait : ce qui démontre que l'air n'est
immobile qu'à la surface du sol.
Tout le monde a remarqué que sur les hauteurs il y a presque toujours un
grand courant d'air : on quitte un bas-fond, où la tranquillité est absolue, et
arrivé sur la montagne la brise est très sensible.
Une brise légère, celle des belles journées du printemps qu'on ne peut
appeler un vent, a cependant, à une hauteur de cent mètres, au moins 10 mètres
de vitesse, d'après des observations très précises que nous avons eu l'occasion
de faire sur des fumées de bombes de feu d'artifice, qui sont la mobilité
suprême.
Sitôt que le vent est franchement sensible à la surface du sol, il
dépasse de beaucoup 10 mètres de vitesse à 3 ou 400 mètres de hauteur.
Un bon vent, une bonne brise de mer, celle où le marin sans prendre de
ris surveille cependant sa toile, arrivé à 500 mètres d'altitude a une vitesse
de 20 mètres à la seconde.
Un grand vent du nord, d'après la vitesse de l'ombre des nuages, a une
rapidité de 30 à 40 mètres ; et un violent Khamsine à 500 mètres d'attitude a
une vitesse difficile à préciser. Par ce vent terrible, un grand vautour, qui
se meut dans son sens, a une vélocité épouvantable : en un instant il a
traversé le champ de la vision, soit 7 ou 8 kilomètres, au moins, pour un
oiseau de ce volume.
Ce sont ces vents de tempête qui dépaysent les oiseaux, qui font qu'un
volateur se trouvera en une journée à 1000 lieues de son habitat.
Ces vitesses énormes nous sont démontrées exactement par des faits
précis. Le ballon la Ville d’Orléans, parti pendant le siège de Paris à
11 heures 45' du soir, est arrivé près de Lifjeld (Norvège) le lendemain à 3
heures 40 du soir. Soit environ 300 lieues en 15 heures, ou 22 mètres à la
seconde.
Le ballon du sacre de Napoléon Ier a eu pendant sept heures consécutives
une vitesse d'environ 40 mètres à la seconde.
Dans les grands jours d'été de 18 heures, un oiseau emporté par un
courant d'air pareil, et s'aidant dans le même sens, pourrait parcourir 3000
kilomètres.
Trois mille kilomètres font environ 30 degrés, qui sont, en gros, la
distance qui sépare le Caire de Paris, le Cairote l'équateur. C'est la distance
de Paris à Arkangel, de New-York à Mexico ; l'Australie traversée. Et, de la
pointe nord du Spitzberg au cap Barrow de l'Amérique russe, il n'y a environ
que 30 degrés en passant par le pôle.
Quels beaux voyages un fort coup de vent permettrait de faire !
Mais il ne faut point s'illusionner ; il ne faut pas croire qu'un
accident est une règle.
De ce que certains jours on pourra faire des merveilles, il ne faut pas
espérer que cela continuera. Lorsqu'on voudra aller d'un point à un autre,
d'une manière exacte, les mécomptes viendront. C'est la navigation à la voile :
on sait quand on part, et on ignore quand on arrive. Ces 30 degrés fournis en
un jour, par ce temps extra-favorable, peuvent par un vent contraire en
demander 8 ou 10, et plus : ce même vent de 40 mètres à la seconde force au
repos sitôt qu'on a à aller ailleurs que là où il mène. Il est impénétrable ;
on n'avancerait pas contre lui d'une lieue en une heure.
La voile, c'est l'inconnu, le bonheur, la chance ; demandez plutôt aux
marins. — Ainsi, les 2.800 kilomètres qui séparent l'Irlande de Terre-Neuve ne
peuvent pas être franchis sans danger à moins de pouvoir passer la nuit sur
l'eau ; au reste il n'y a que les oiseaux nageurs qui se hasardent à faire
cette traversée.
Arrivons à la vitesse moyenne, celle du vent de tous les jours.
L'observation indique, par la comparaison du vol avec le chemin de fer,
que les oiseaux à vol lent font tout au plus 40 kilomètres à l'heure, et les
oiseaux bien doués, comme les tourterelles et les grands voiliers, en plein vol
dans l'espace, font 60 kilomètres. Ce qui fait que pour les appréciations
moyennes on peut se servir de la base de 1 kilomètre à la minute, comme donnée
sérieuse.
Voilà ce que fera la direction aérienne à la voile, plutôt moins que
plus. C'est déjà beau ; c'est 5 à 600 kilomètres dans la journée de 10 heures.
Les vents n'ont probablement pas tous la même puissance de sustention.
Il semble, en regardant attentivement les oiseaux qu'il y a des jours où l'air
porte mieux que d'autres.
Par les vents du midi, surtout les vents chauds et électriques, les
planeurs ont une propension très marquée à exagérer le vol sans battement.
Cette faculté de suspension est indiscutable pour les corps de peu de masse :
témoin les poussières et les sables du siroco, Khamsine, guibli, etc. Elle
serait donc perceptible pour les oiseaux, même pour les très gros ?
Par un vent électrique du désert on est sûr de voir beaucoup de vautours
; ce temps particulier a la propriété de les faire voyager. Les oiseaux de
proie nobles y sont également sensibles. En Europe, changement de vent, la
chaleur et l'orage après, sont pronostiqués par la crécerelle qui monte alors
très haut dans les airs, en criant, ce qui la fait remarquer. Les faucons, les
milans et les aigles se comportent de même.
Tout vent du désert, en Afrique, amène les vautours rares : c'est par ce
temps, seulement, qu’on voit les otogyps, les arrians et les gypaètes quitter
l'intérieur, et pousser des pointes jusqu’à la Méditerranée.
VITESSE DE
L'OISEAU
La vitesse de translation de l'oiseau, étudiée a un haut point de vue,
surtout chez les voiliers, peut être envisagée généralement ainsi : elle se
compose de la vitesse du vent jointe à celle de l'animal.
Chez les rameurs le cas est différent, elle se compose de trois facteurs
: la vitesse du vent, la vitesse théorique de l'oiseau, vitesse qu'il faut
estimer en la considérant comme s'il était un voilier, et vitesse produite par
sa force personnelle. Cette élude, qui est actuellement l'objet d'une foule
d'expériences de cabinet et de beaucoup de calculs, ne nous intéresse
nullement, puisque nous étudions le voilier dans toute la simplicité de son
vol. Nous envisagerons donc seulement le planeur dans les enseignements qu'il
pourra nous donner.
Pour mesurer la vitesse de translation de l'oiseau, il ne faut pas
l'étudier dans l'espace, parce qu'on n'a point de point de repère auquel on
puisse s'attacher : c'est sur l'ombre qu'il faut porter son attention.
Cette ombre est d'une étude facile ; elle peut être comparée à la
vitesse d'un cheval, d'un âne, d'un chien, d'une voiture, d'un chemin de fer,
on a par ce moyen des données sûres, des points de comparaison sérieux,
auxquels on peut se fier.
Pour toutes ces observations il n'y a rien de plus instructif que les
modèles nombreux. Jugez-en : J'ai, dans le moment où je trace ces lignes, deux
familles de corbeaux familiers qui viennent à quelques mètres de moi prendre la
nourriture que je leur jette. — Il y a sur les mosquées, en face, des milans
perchés, qui attendent mon arrivée pour plonger vers moi au moindre geste que
je ferai de jeter un morceau de viande. Là il est possible de voir de très près
cet oiseau lancé à toute vitesse, puisqu'il y en a deux qui viennent m'enlever
leur pitance dans la main.
Puis ce sont des batailles sans fin entre corbeaux et milans et milans
entre eux, et la bataille est toujours une exhibition de tours de force ; les
milans sont à chaque instant sur le dos : c'est la position de combat dans les
airs pour tous les aquilinées. On les voit souvent se prendre avec les serres,
se tenir, et descendre ainsi attachés en tournoyant pendant des centaines de
mètres.
Par les grands vents cette étude est intéressante au possible.
Essayer d'expliquer ces mouvements par des formules mathématiques
devient une charge. La description en est déjà difficile : comment songer à
fixer dans, les rails immuables de l'algèbre des évolutions qui varient à
chaque coup de vent, à chaque désir ? C'est exactement comme vouloir calculer
la force dépensée par un gymnasiarque dans ses exercices, ou la quantité de
kilogrammètres ou de calories utilisés dans une lutte entre deux athlètes.
Ce que l'on sait sur la vitesse des oiseaux n'a rien de bien précis, car
ils ne se prêtent pas aux expériences exactes. La rapidité du vol des rameurs
est indiquée d'une manière assez rigoureuse par les, voyages qu'on fait faire
aux pigeons par un temps de calme exact. Cette vitesse est d'environ 15 à 20
mètres par seconde suivant les variétés.
On sait que la tourterelle vole plus vite que le ramier ; cette vitesse
est d'environ 80 kilomètres à l'heure : soit 20 et quelques mètres à la
seconde. Les canards et les sarcelles ont encore une plus grande célérité ;
mais de combien ? il est difficile de le préciser. — Puis, ces vitesses
effectives, comme chemin parcouru, dans la seconde, varient avec la direction
et la force du vent. Il est donc impossible de rien dire de sérieux sur cette
question qui, au reste, ne nous intéresse pas d'une manière absolue quant aux
rameurs.
Les voiliers se prêtent quelquefois à l'étude de la mesure de la
rapidité de leur vol ; vitesse qui varie naturellement suivant le vent, mais
qui indique toujours un bénéfice à l'avoir des grandes masses. Il y a souvent
course entre trois oiseaux : le vautour fauve, le percnoptère et le milan.
Près de la porte de l'Abbassieh, au Caire, parmi les montagnes de
poteries, la voirie fait déposer les animaux morts. On ne les enterre pas,
c'est inutile, parce qu’entre chiens errants et oiseaux rapaces, ils sont mangés
en quelques heures. — Sitôt que l'animal mort est déposé, sitôt que les
écorcheurs ont fini leur besogne, les oiseaux carnivores se mettent en route ;
ils passent au zénith de l'observateur, et arrivent à destination, toujours
visibles à la lunette. La distance est connue, il n'y a qu'à vérifier le temps
employé à accomplir ce voyage.
Ce trajet est fait avec la même vitesse par les trois oiseaux ; mais la
force dépensée est d'autant moindre que la masse est plus grande. Quant à la
rapidité, elle varie, naturellement, avec la vitesse et la direction du vent.
Les oiseaux de forme similaire volent théoriquement avec des vitesses
proportionnelles à leurs grandeurs ainsi une marouette et une perdrix, toutes
deux rameurs il vol semblable, avancent dans l'air avec des vitesses en
relation avec leurs volumes. Chez les planeurs l'effet produit est le même ; le
cercle décrit par l’hirondelle de rocher a cinq mètres de diamètre, celui qui
est produit par l'arrian en a cent. Cependant, pratiquement, sous l'action des
accidents et des besoins de l'existence, ce n'est pas exactement ce qu'on
observe : on remarque plutôt que les oiseaux de forme comparable, quelque
taille qu'ils aient, ont des vitesses semblables. Le petit va aussi vite que le
grand, et a même souvent une tendance à être le plus véloce.
Cela est dû à l'excès de puissance que possèdent les petites espèces :
puissance indispensable pour leur permettre d'éviter les grosses, parmi
lesquelles sont les grands carnivores.
Chez les voiliers, pour tourner les difficultés, les oiseaux de peu de
volume deviennent rameurs sitôt qu'ils ont à agir avec un peu d'énergie.
Comme résultats déduits de ces études journalières, nous pensons
approcher de très près la vérité en disant que la vitesse moyenne de marche du
milan qui plane pour étudier le sol est de 5 mètres à la seconde, par un vent
de 5 mètres à la seconde : c'est l'oiseau qui semble se suffire du plus faible
courant d’air pour obtenir une sustention moyenne. Les grands vautours, pour
monter avec cette vitesse de vent, sont obligés de développer toute leur
surface. Il semble que, pour eux, la vitesse du vent, pour s'accorder avec
leurs facultés, devrait aller jusqu'à 7m,50.
ACTION DE LA
VITESSE
Les théoriciens posent souvent ce problème : Quelle est la force dont il
faut disposer pour arriver à la sustention ?
La force de soulèvement, ascensionnelle si on veut, est si peu de chose
dans beaucoup de circonstances, qu'on peut dire qu'elle est négligeable, et
qu'elle peut se réduire à la force nécessaire pour soutenir l'appareil.
Cette force-ascensionnelle n'est indispensable que quand le vent est
nul.
Le problème serait mieux posé s'il l'était ainsi : Quelle est la vitesse
qu'il faut communiquer à un aéroplane, oiseau ou machine, pour qu'il puisse se
soutenir dans les airs et s'élever ?
Là, comme à toutes les faces de ce problème, il y a démonstration dans
la nature.
Les oiseaux qui n'ont pas assez de puissance dans les pectoraux pour
s'enlever franchement ne sont pas rares. — Les voiliers peuvent très peu
s'élever, surtout les très gros. Un gyps fulvus ne peut pas fournir une
ascension de 20 mètres par un angle de 45 degrés ; par la verticale, il
n'arrive pas à 10.
Ainsi, voici un des rois des airs qui peut être prisonnier dans une
chambre-cage sans plafond, pourvu que les murs aient 20 mètres de hauteur et
qu'ils ne soient éloignés que de 20 mètres.
Chez les oiseaux à ailes étroites cet effet est encore bien plus
sensible.
Le martinet, ce sauvage, ce véloce, ce rustique habitant des nues, ne
peut s'élever à deux mètres ; il est exactement en cage dans une grande caisse
sans couvercle : et cependant, s'il y a un animal doué pour le vol, c'est bien
lui. —Les grands oiseaux marins sont dans le même cas. — Une frégate est
impotente si elle n'a l'espace devant elle : tandis que sitôt que ces deux
volateurs ont la vitesse ou un courant d'air, ce qui revient exactement an
même, ils redeviennent de suite l'un le martinet et l'autre la frégate, ce qui
est tout dire.
Pas de vitesse, pas de vol !
J'ai eu une fois à résoudre un problème basé sur ce principe, qui était
assez curieux.
J'étais en Algérie à cette époque, il y a belles années déjà ; c'était,
autant que je puisse m'en souvenir, en 64, au printemps. A cette époque j'avais
déjà la solution du problème. Avec un peu d'aide et de meilleures circonstances
j'aurais pu l'exécuter. Le désastre de 1870 n'aurait pas eu lieu, la guerre
russo-turque restait dans les limbes, les peuples étaient libres, l'Asie se
précipitait peut-être sur l'Europe ; qui sait ? enfin, laissons cela.
Je disais donc qu'un matin à la marine, à Alger, étant allé voir,
suivant mon habitude, quelle avait été la pêche de la nuit ; histoire de
pousser mes études sur la forme des squales, coupe des grands nageurs sous-marins,
etc., je me trouvai en face d'un marchand, qui au lieu de poissons vendait des
oiseaux de mer. Il en avait une cinquantaine.
Je ne connaissais pas ces animaux ; cependant je me remis bientôt et
décidai que c'était des procellarias, variété puffinits Kulhii, que
j'avais déjà aperçus au large, mais seulement de très loin.
Comme ils étaient à des prix modérés, je m'en offris quatre, puis je
pris le chemin de fer de huit heures, et à dix je me trouvais chez moi, en
pleine Mitidja.
Mon but était de les étudier, puis de leur donner la clé des champs
quand ils m'ennuieraient.
Je les mis donc sur l'eau, dans une petite mare à canards, voisine de la
ferme.
Ici je crois utile de donner une description succincte de cet oiseau,
pour les personnes qui ne le connaissent pas, afin de faire saisir toutes mes
déconvenues.
Le procellaria est un oiseau gros comme une petite poule. — En regardant
au tableau des études, type larus, nous trouvons qu'il pèse 750 grammes, que
son envergure est de lm,25, la largeur de ses ailes de 0m,125. — Il possède
donc deux grandes baguettes qui ne lui permettent de s'envoler que dans des
conditions spéciales. On s'en formera une idée très juste en se figurant une
petite poule qui aurait pour ailes deux grandes règles à dessin. — Les jambes
sont longues, minces et faibles, les pieds palmés. — Il ne marche presque pas,
mais fait huit ou dix pas en courant, et se pose tout de suite comme s'il était
fatigué.
Mes quatre oiseaux, sur la mare, ne faisaient rien d'extraordinaire ;
aucun n'avait de velléité de s'envoler.
J'en pris un, le plus faible, et le jetai en l'air assez haut. — Il prit
son vol, piqua une tête contre un mur et s'assomma.
Vexé, j'en pris un second, et le
montai au premier étage. — Ce second était malade, il se laissa choir si
stupidement que je le donnai aux chiens.
J'en pris un troisième, et je jurai de voir ce jour-là un procellaria au
grand vol. Pour cela faire, je le montai au sommet de mon observatoire, qui
dépassait le toit de la maison de plusieurs mètres. — De là je le projetai au
large. Ce pauvre diable d'oiseau n'eut pas plus de chance que les autres : il
battit fortement des ailes, s'abaissa, et, au moment où je le croyais
sérieusement en route, rencontra un poteau et se brisa une aile.
J'avoue que je n'étais pas content de mon emplette, et il y avait de
quoi. Dépenser de l'argent pour donner la liberté à des captifs, se creuser la
tête, les monter au cinquième et ne réussir à rien, c'était du guignon.
Il en restait encore un, dernier espoir. Je m'étais mis dans la tête de
voir et oiseau en plein vol, et je ne voulais pas cette fois manquer mon coup.
Je réfléchis longtemps ; enfin, il me vint une idée : voici.
Il y avait à un kilomètre de la ferme un terrain nu, sans herbe ; le sol
était plat comme une glace. Je trouvais que ces conditions avaient une certaine
similitude avec la surface de la mer par un temps calme.
J'y transportai le n° 4, qui avait l'air rigoureusement aussi inepte que
ses trois devanciers. — Je le déposai sur cette immense aire et m'éloignai. —
Il ventait frais de l'ouest. Notre animal resta couché un bon moment, finit par
mettre le bec au vent, puis s'étira les ailes. Alors il me montra que j'avais
sainement réfléchi.
Prenant sa course en battant des ailes, qui n'étaient pas gênées par les
herbes, il parcourut ainsi une centaine de mètres, portant de moins en moins
sur les pieds, puis seulement sur les ailes, mais toujours ras de terre. Enfin
d’un seul bond, en prenant le vent, il s'enleva à vingt mètres, revint sur moi,
et là me dit : Souviens-toi, cher sauveur, que dans la direction aérienne,
la question de base est la vitesse.
C'est certainement ce que j'ai bien compris ; et depuis lors je me suis
de plus en plus persuadé de la justesse de ce principe.
Vitesse, toujours vitesse, produite par la
chute, produite par le courant d'air, par le battement si ou veut, c'est
toujours la puissance qui soutient et hors de laquelle l'air ne porte plus.
C'est cette résistance de l'air, cette difficulté qu'il éprouve à céder
rapidement qui permet au boumerang australien de revenir vers celui qui l'a
lancé.
Le boulet qui, quoique sphérique, ricoche sur l'eau comme il le ferait
sur une plaque de métal, trouve une résistance basée sur le même ordre d'idées.
En allant plus loin, l'astéroïde qui est déviée de sa course et rebondit
sur les parties les plus ténues de notre atmosphère éprouve une résistance qui
provient de la même source. Cet air, malgré sa raréfaction poussée à la
dernière limite, a encore assez d'inertie pour supporter le bolide qui a
souvent un poids énorme. — Tandis que ce même air, au niveau de la mer, à 0,760
de pression, pesant lgr,03 le litre, cède si facilement, si on l'attaque
lentement, qu'il sera incapable de porter quoi que ce soit.
VOYAGES DES
OISEAUX
La vitesse avec laquelle les oiseaux se meuvent dans l'air varie avec le
mode de construction de chaque famille.
Laissons ceux qui comme les gallinacés n'ont d'ailes que juste ce qu'il
faut pour fuir ou arriver à se percher, et remarquons que, malgré cette grande
inégalité dans les facultés du vol, ils sont presque tous soumis deux fois par
an à exécuter de grands voyages. Ces pérégrinations sont les mêmes pour tous :
ce sont au moins 10 degrés de latitude à franchir, afin de changer de climat.
Généralement ce voyage est facile, la terre est partout au-dessous
d'eux, ils peuvent se reposer quand ils sont las. En Amérique, en Asie, aucune
difficulté ne se présente ; mais pour passer de l'Europe à l'Afrique, surtout
en face de la France, une grande nappe d'eau se présente, qui constitue pour
les volateurs un danger sérieux.
C'est bien probablement le point du globe le plus funeste à la gent
ailée, et c'est certainement à son influence qu'on doit attribuer la pénurie de
gibier à plumes qu'il y a en France.
Les oiseaux de l'Allemagne et de la Russie ont bien plus de probabilités
de réussite dans leurs émigrations que ceux de notre pays ; ils ont l'Italie et
Malte d'un côté, et la Grèce, Candie et la côte de Syrie de l'autre, tandis que
les nôtres n'ont que les Baléares : s'ils manquent ces îles, ils sont en
danger.
Comment ces malheureuses marouettes font-elles pour fournir une aussi
longue traite ?... Tous ceux qui ont navigué sur la Méditerranée au moment des
passages ont pu rencontrer ces pauvres passereaux exténués, qui viennent
demander un quart d'heure de repos à l'île mouvante. — Les cailles ont une
bravoure qu'on ne leur supposerait pas : on les rencontre par petits groupes de
cinq ou six individus, rasant l'eau, présentant légèrement le ventre à la
brise, et ramant avec une raideur et un entrain remarquable : mais, quand elles
arrivent, comme il est temps ! et quelles courbatures !
Les hirondelles ne changent pas de manière d'être pour se dépayser.
Ainsi, le martinet chasse en voyageant tout comme s'il était dans la contrée où
est son nid, c'est sa vie de tous les jours ; seulement ses évolutions ont un
sens général.
Une espèce qui s'embarque sans le moindre souci pour cette dangereuse
traversée, c'est le canard. Il est bien plus à son aise que les chouettes, les
faucons et même les aigles. Nous avons vu cependant une paire de ces derniers
traverser la mer en face du Benghazi avec une fière crânerie. Ils ont gagné la
hauteur en décrivant des ronds, puis ont piqué droit sur la terre d'Afrique
sans donner un coup d'aile ; mais il faisait si beau ce jour-là qu'ils volaient
sans aucune crainte ; puis, peut-être leur assurance venait-elle de la vue de la
terre, qui, visible de la hauteur où ils étaient, ne l'était pas pour nous.
Il faut, à ce propos, remarquer que chez beaucoup d'oiseaux le sentiment
géographique est tout simplement donné par la vue. De mille mètres en l'air on
a un vaste champ d'observation. L'oiseau qui est à 500 mètres voit sur mer la
côte basse à plus de 50 kilomètres devant lui ; si le temps est clair, une
grande montagne se distingue du double.
Ce qu'on a mis sur le compte de la prescience n'est-il pas un fait tout
simple ? On objectera que, dans le temps de brouillard, leurs yeux ne peuvent
les guider ; c'est exact, mais qui peut affirmer qu'ils arrivent bien tous à
destination : la mer est le grand piège aux oiseaux : les poissons mangent plus
de gibier que les chasseurs. — La meilleure preuve que ces pauvres voyageurs
s'égarent souvent, c'est qu'au moment des passages tous les bâtiments sont des
refuges : et ce ne sont pas seulement les petits oiseaux qui demandent asile,
ce sont de fins volateurs comme des pigeons, des faucons, des tourterelles, qui
arrivent tellement exténués qu'ils se laissent prendre à la main.
Quelle est la vitesse de l'oiseau en voyage ?
Là encore point de réponse sûre ; cependant, d'après ce qu'on peut
observer, il ne semble pas voler plus vite dans cette circonstance que quand il
est au-dessus de la terre ferme.
La force et la direction du vent sont des facteurs qui font varier la
vitesse de translation de l'oiseau du simple au décuple. Il est à espérer pour
eux qu'ils tiennent compte de ces accidents atmosphériques, et que quand ils
sont surpris par un orage, c'est que par suite de la grande distance parcourue
et du changement de climat ils n'ont pu le prévoir. En tous cas, une chose dont
on peut être sûr qu'ils profitent, c'est de la présence de la lune pour les
éclairer dans les longs voyages de nuit. Ils choisissent généralement la pleine
lune pour accomplir leurs migrations.
EFFETS PRODUITS
PAR LA MASSE
La différence de poids produit chez les oiseaux de même forme et de même
puissance musculaire des effets très variés et réguliers.
Voyons comment se comportent dans un exercice difficile l'aigle, le
faucon et l'alouette, trois oiseaux parfaitement comparables comme allure
générale.
L'aigle reste immobile dans les airs, sans bouger les ailes, se servant
seulement de sa queue pour s'équilibrer : il est aussi fixe dans l'espace que
s'il était cloué au ciel. — Le faucon aussi reste immobile, mais en battant des
ailes ; et l'alouette ne peut faire cette manœuvre, dans les mêmes
circonstances atmosphériques, sans de grands efforts, encore est-elle toujours
entraînée.
Cette loi de la disproportion des aptitudes au vol du petit au grand
trompe l'œil et toutes les données reçues. — Un exemple précis en fera
comprendre toute l'importance :
La caille, que tout le monde connaît, est un oiseau lourd par
excellence, c'est une boule qui a deux ailettes qui la soutiennent tout juste.
Mise au creuset de l'expérience, elle donne les résultats surprenants que voici
:
Elle dispose de plus de surface par rapport à son poids : que le
flammant dont le décimètre carré porte 76gr, 16 ; cependant on envisage
généralement ce grand échassier rose comme un tas de plumes ;
Que le pélican, qui vole très bien, — 66gr,34 ;
Que le procellaria, qui ne vit que de sa vitesse, 57gr,14. Enfin, et
c'est à n'y pas croire, que le grand vautour fauve (gyps fulvus) qui
plane des journées entières, dont le décimètre carré est chargé de 71gr,80.
Et cependant vole-t-elle mal cette pauvre caille, qui fournit
ordinairement une traite de deux cents mètres, et pas sans souffler. — Je parle
de la caille moyenne, verte, du poids de 100 grammes : le décimètre carré n'a à
porter chez elle que 44gr,14.
De la comparaison des rapports qu'il y a entre les poids et les surfaces
des oiseaux inscrits dans les tableaux ci-après, il ressort une vérité qu'on
peut traduire ainsi :
La quantité de surface proportionnelle nécessaire à un oiseau pour un
genre de vol donné diminue avec l’augmentation du poids de l'oiseau, dans
une proportion qui est à déduire de tableaux plus complets que ceux que nous
présentons, et d'expériences à faire sur la puissance de sustention
d'aéroplanes construits sur des gabarits pareils, de grandeurs différentes, et
chargés jusqu'à ce qu'ils produisent des effets de sustention pareils entre
eux.
Les bénéfices obtenus par les grandes masses, qui sont accusés par les
tableaux de cette étude d'une manière permanente et régulière, sont assez
difficiles à expliquer. — Le rapport qu'il y a entre la manière de croître des
volumes et des surfaces intervient certainement ; il est un facteur à l'avoir
de la masse la plus importante par son action sur le traînement qui diminue :
cela est indiscutable. — Les surfaces représentent par leur frottement les
causes retardatrices, les volumes par leur masse produisent des effets
accélérateurs. Ce bien et ce mal n'augmentent pas dans la même proportion.
La partie de l'animal où se produit l'augmentation de volume est
sensiblement le corps : quand le corps double de volume, la surface ne grandit
pas en proportion ; là est un grand bénéfice au profit de la masse la plus
considérable ; voilà pour les volumes.
Quant aux surfaces, c'est bien encore un bénéfice qu'il faut constater.
Une fois une aile établie, un rien la double ; et cependant l'envergure ne sera
pas beaucoup agrandie ; c'est encore vrai, mais tout cela est insuffisant pour
expliquer les énormes écarts que nous rencontrons, dans l'examen des tableaux.
Car il n'en faudra pas moins que, s'il faut une surface de..., pour supporter
un poids de..., si ce poids double, il faut rationnellement à l'aéroplane une
surface double pour le supporter, moins le bénéfice fait sur le frottement, qui
est peu important.
Il serait assez naturel de penser que la surface nécessaire pour porter
le gramme de matière-oiseau devrait être presque invariable ; l'écart devrait
être équivalent à l'action nécessitée par le bénéfice ou la perte occasionnée
par le traînement.
Et cependant il n'en est rien. Les tableaux nous indiquent que les
choses se passent différemment ; ils nous montrent des différences énormes.
Cette surface de 774 millimètres carrés, nécessaire à l'hirondelle grise
de rochers pour obtenir la sustention du gramme de son individu, est
représentée chez le vautour fauve, qui vole et se soutient au moins aussi bien
qu'elle, par 139 millimètres carrés. — Différence du simple au quintuple et
plus.
En cherchant une explication à ce phénomène, nous voyons intervenir une
cause perturbatrice qui amène toujours un bénéfice à la plus forte masse : c'est
la variation de valeur de résistance de l’air en face de masses différentes.
Il faut avouer que ce malheureux tube, où l'on fait le vide, et où on
laisse choir les corps hétérogènes, ainsi que la loi qu'il démontre, a bien
aidé à fausser sur ce point l'entendement humain. — A moins de réflexions
spéciales sur le cas qui nous occupe, il reste dans l'esprit l'affirmation
suivante, qui a l'air de se poser en axiome : c'est que les corps tombent avec
la même vitesse. On oublie toujours d'ajouter : dans le vide seulement.
Au point de vue pratique, les traités de physique devraient dire que les
corps, sur notre terre, tombent avec une rapidité qui est en raison de leurs
densités, en raison de leurs formes, et surtout en raison de leurs masses.
L'air est un corps tangible, un fluide pondérable, mais n'est nullement
l'éther immatériel. — Il démontre sa matérialité, son imperfection de fluidité
lorsqu'il a à agir sur une masse minime.
Il est tellement peu mobile que la molécule est tenue en suspension dans
sa masse. L'attraction n'a plus d'action sur elle, et cela malgré la densité la
plus grande possible. — De petits fragments d'or ou de platine restent en
suspension dans son sein.
La masse du poids d'un milligramme ressent déjà les effets de
l'attraction, mais n'est cependant pas encore soumise aux lois de la chute des
corps graves ; la matérialité de l'air est encore prépondérante.
La masse de 1 gramme, densité moyenne de 1, est sur la limite des corps
envisagés par les lois de l'attraction. — Tout le monde a bien remarqué qu'une
mouche n'est pas sollicitée par la gravitation comme un gros oiseau. On
comprend bien d'instinct que pour un papillon l'air est plus épais que pour un
pigeon.
L'attraction, et l'inertie par conséquent, n'ont plus la même action sur
1 gramme que sur 10.
Ces effets sont d'une étude peu usuelle, ils sont presque inconnus à
notre entendement instinctif ; cependant ils sont précis et ponctuels : nous
les verrons, au reste, démontrés d'une manière visible dans tous ces tableaux.
En continuant cette étude des effets de l'importance de la masse, nous
remarquerons dans celles comprises entre 10 et 100 grammes, se traduire chez
les oiseaux des propriétés de vol se différenciant franchement. — De 100
grammes à 300, de 500 à 1,000, de 2,500 à 5,000, à 7,500, sont autant
d'échelons dans l'augmentation du pouvoir économique de sustention et de
translation des corps dans l'air, d'après les renseignements fournis par ceux
qui y circulent constamment, c'est-à-dire les oiseaux.
Nous venons donc de voir une douzaine de manières d'être de l'attraction
et de l'inertie par rapport à la masse, depuis le milligramme jusqu'à 7,500
grammes. Quels seront les effets de ces deux forces sur des masses supérieures
?
Il est probable que la proportion se continue, et qu'arrivée aux poids
de 100 kilogrammes elle n'est pas dénaturée d'une manière trop sensible ; ou,
pour s'exprimer autrement, que les lignes asymptotiques qu'on pourrait établir
d'après les chiffres contenus dans ces tableaux continuent jusqu'à ce poids
leur marche normale.
Nous en avons pour indice les grands ptérodactyles : celui de 18 pieds
de la craie, de M. Rowerbank, et celui du Greensand, de 27 pieds d'envergure. —
A cette époque, l'air était peut-être un peu plus dense qu'il n'est
aujourd'hui, mais la différence ne peut être qu'infime, et tout à fait
négligeable. Elle n'était certainement pas d'un vingtième en plus ; la
gravitation était la même : toutes les conditions étaient donc identiques.
Voici donc un animal de 9 mètres environ d'envergure qui se soutenait
dans les airs. — Supposons-le établi dans la proportion de 5 : 1, ce qui
correspond environ à la tournure du pigeon et du corbeau. Nous aurons donc pour
sa surface 9 X 1.80 = 16mq, 20.
Pour une masse pareille prenons pour coefficient de charge 10
kilogrammes par mètre carré, nous arrivons au poids énorme de 162 kilogrammes.
Si nous nous contentons de prendre pour coefficient 7,180 grammes, poids exact
supporté par le mètre carré du gyps fulvus, nous avons pour résultat 116
kilogrammes 319 grammes : nous sommes donc probablement dans le vrai.
Maintenant, comment se comportera dans l'air
une masse pareille ?
Quand on regarde voler un oricou du poids de 8 à 10 kilogrammes, une
chose qui frappe de suite, qui étonne même, c'est la fixité du vol. Une
direction étant donnée, les accidents de coup de vent sont sans effet sur cet
oiseau ; ils sont emmagasinés dans ce gros corps, qui semble y être insensible,
et qui continue majestueusement à se mouvoir sans montrer qu'il en ait ressenti
les effets. — L'aéroplane chargé de 100 kilogrammes devra donc se mouvoir avec
encore plus de tenue et de régularité que l'oricou.
Que sera-ce donc quand du poids de 100 kilogrammes on passera à 500 ou à
1,000 kilogrammes. On peut être assuré que les accidents de vol, à puissance de
vent égale, diminueront encore bien plus.
Pour le poids de 100 kilogrammes l'intuition donne une idée saine de
cette allure ; on a presque des points de repère pour se retrouver ; mais
arrivé au poids de 1,000 kilogrammes on ne sait plus rien, et pour 10,000 c'est
l'inconnu absolu.
Cependant, jusqu'à preuve du contraire, il semble que les bénéfices
continueront à se mettre à l'avoir du poids le plus important.
EFFETS PRODUITS
PAR L'AGGLOMÉRATION
Il semble résulter de l'observation que les oiseaux, voiliers ou
rameurs, ont plus de puissance de pénétration quand ils sont agglomérés que
quand ils sont isolés.
Il est assez difficile de s'expliquer ce phénomène d'une manière bien
satisfaisante, mais il existe cependant.
Il est probable qu'il se développe une action de masse, qu'il naît une
puissance nouvelle créée par la proximité.
C'est, au reste, un fait bien connu des chasseurs. Une charge de plomb,
disposée de manière à écarter, va moins loin que quand elle est disposée de
manière à serrer le coup. — Les plombs non tassés, les cartouches coupées,
grillagées, les plombs collés au vernis, sont autant de systèmes tendant à ce
but : obtenir la plus grande agglomération pour obtenir la plus grande portée
possible.
Les oiseaux connaissent cette propriété des corps rapprochés, puisqu'ils
l'utilisent souvent. — Ainsi, les passereaux ne font de longs trajets que
groupés en masse serrée ; à commencer par le moineau qui a un ordre de marche
bien fixé. — Les pigeons, les canards, les oies, cygnes, grues, etc., ne
voyagent jamais qu'avec un ordre précis, qui est toujours le même pour chaque
espèce.
Il y a chez ces animaux une foule de manières de se grouper. Les uns se
mettent en masses de formes non définies, comme le moineau, l'alouette, et la
plupart des passereaux. D'autres s'en vont tous à la suite les uns des autres
comme les étourneaux en voyage. D'autres encore se disposent en ligne
horizontale, et cheminent ainsi : comme les canards, sarcelles, barges, et
presque tous les petits échassiers. Souvent cette ligne prend la tournure d'un
V, comme dans les vols d'oies, cigognes, grues, et surtout dans ceux de
flammants et de pélicans. Enfin, l'ordre le plus parfait comme pénétration est
celui qui est pris par les étourneaux dans un cas, c'est quand ils se sont
attardés et que la nuit les surprend. Ils se groupent alors d'une manière
excessivement serrée, et prennent la forme d'un projectile cylindro-conique, ou
mieux, précisément la tournure du boulet Piobert.
Quand l'homme aura plus tard à voyager en grandes masses, il étudiera
lequel de ces ordres de marche lui sera le plus profitable ; quelques
expériences suffiront pour déterminer l'allure qu'il devra prendre.
Ces agglomérations d'oiseaux en marche sont souvent bien remarquables :
ainsi, dans nos campagnes, en hiver, l'effet produit par les bandes de corbeaux
traversant le ciel gris attire forcément les regards ; leurs battements
réguliers font que, dans certaines positions, le vol disparaît presque
complètement ou s'enlève vigoureusement en points noirs : la vue est forcément
attirée par cette variation d'intensité.
Les vols des grands voiliers voyageurs ont quelquefois une majesté
curieuse. — Je me souviendrai toute ma vie d'une énorme agglomération de
cigognes vue à 7 ou 800 mètres en l'air, se détachant sur un de ces ciels de
l'orient tout or et azur. On voyait avancer lentement cette masse ; de temps en
temps un battement partait du sommet de ce triangle irrégulier et se propageait
le long de ces immenses lignes. — Ces oiseaux avançaient lentement ; la masse
se divisa en deux parties, qui prirent chacune la disposition angulaire.
Ce n'est rien qu'une bande d'oiseaux qui passe, cependant cela produit
toujours un effet intense, même sur les indifférents ; généralement leur
apparition vous cloue sur place, on s'arrête à les regarder, et on se souvient
longtemps de ce spectacle.
Les pélicans en ordre de voyage donnent à leur vol la forme d'un coin,
ils ont de loin la tournure d’une pointe de flèche. Ils se meuvent avec une
lenteur curieuse et une régularité qui rappelle la marche des machines qui
rabattent le fer. Ces énormes palmipèdes sont aussi quelquefois bien
empoignants. Je me souviens d'en avoir vu un jour un vol sur le Nil, descendre de
là-haut, où ils paraissaient gros comme des hirondelles, et venir se poser à
200 mètres de ma dahabieeh, sur une de ces îles de boue gélatineuse,
particulières à ce fleuve. Je les suivais à la lunette dans toutes leurs
évolutions ; ce spectacle dura bien une demi-heure. Quel étonnant spectacle !
Qu'ils étaient beaux ces énormes oiseaux dans leurs tournoiements dans les nues
! — A cette distance on entendait le sifflement de leurs ailes tranchant l'air,
leurs cris rauques ayant quelque ressemblance au braiement de l'âne ; et,
jusqu'au claquement de leurs larges pattes venant frapper cette boue liquide.
C'est malheureusement un spectacle que, même quand on vit sur le Nil, on
ne voit que rarement.
LES TROIS SUPPORTS
Chaque famille de volateurs a au
vol un aspect particulier qu'il est intéressant d'étudier.
Il y a des oiseaux qui ont les bras longs, d'autres qui les ont courts ;
les uns ont les rémiges allongées, les autres les ont courtes. — Il y en a qui
ont les ailes longues et minces, d'autres minces et courtes, d'autres rondes,
d'autres carrées, terminées par cinq plumes de même longueur ; d'autres
pointues, dont la troisième plume, la deuxième, ou même la première est la plus
longue.
Chaque forme correspond nettement à une aptitude, est spéciale et
parfaite pour un temps donné, et se comporte moins bien dans d'autres. En
somme, tous ces types différents ne peuvent remplir le même rôle.
A quel temps particulier, à quelles aptitudes spéciales correspondent
ces formes ?
Quand la nature a eu à pourvoir un gros oiseau (nous n'avons au reste à
nous occuper que de ceux-ci) d'ailes devant le transporter rapidement, elle les
a construites petites et étroites, et les a fait mouvoir par de puissants
pectoraux : —genre canard.
Quand l'oiseau a eu pour besoin de pouvoir se mouvoir avec succès dans
les grands courants d'air, comme ceux de la mer, elle les a toujours dotés
d’ailes étroites et longues pour éviter le trainement : goéland, mouette, fou,
albatros.
Quand elle a eu besoin, comme pour l'aigle, de faire un être fort ;
quand elle a voulu créer un grand chasseur, elle lui a donné tout ce qu'elle a,
c'est-à dire le pouvoir de planer pour pouvoir étudier le sol ; — ailes de
voilier — auxquelles elle a adjoint des moteurs puissants, pour pouvoir le transformer
au besoin en rameur.
Quand elle n'a eu à pourvoir l'oiseau que de la faculté de pouvoir
stationner sans fatigue dans l'atmosphère, elle lui a donné deux choses : une
grande masse, et une grande surface.
Quant aux autres, ses déshérités, elle en a fait des rameurs ; ce sont
ceux qui traînent péniblement leur individu au moyen de force peines et
fatigues.
Étudions maintenant quel rapport il y a entre le vol d'un oiseau et
l'allongement ou le raccourcissement du radius et du cubitus par rapport à la
main.
Avant d'aller plus loin, nous devons remarquer que l'allongement de
l'avant-bras coïncide avec celui du bras : il y a relation presque constante entre
ces deux parties de l'aile, mais divergence ponctuelle entre ces deux parties
réunies et la main.
Chaque famille de volateurs a ses proportions ; il y a toute une étude
très intéressante à faire comme mesures exactes. — En l'absence de ces données
précises, essayons cependant quelques remarques.
Il est possible de classer tous les genres de planeurs entre les deux
types que nous allons indiquer.
Parmi les oiseaux qui planent, l'usage usuel de l'angle aigu, de 100
degrés environ (le sommet de l'angle étant le bec), correspond avec le
raccourcissement du bras et de l'avant-bras, et l'allongement excessif de la
main. — Ce sont les planeurs rapides, hirondelle, martinet, et, en moins
accentué, milan, naucler, etc.
Remarquons en passant que ce genre de vol nécessite une queue puissante.
Dans le type extrême opposé, celui
des planeurs lents à ailes larges, l'angle affectionné est de 200 degrés, et
quelquefois plus, on remarque une diminution de longueur de la main et un grand
développement du bras et de l'avant-bras. Le type de ce genre est le vautour.
Queue généralement faible.
Il y a cependant une famille de voiliers à ailes étroites qui possède
l'exagération de l'allongement du bras, de l'avant-bras, et même ordinairement
de la main : c'est la famille des pélicanidés, qui comprend quatre ou cinq
genres qui sont des voiliers excessifs, paradoxaux. Les phaétons sont de
remarquables planeurs. Le pélican est un maître charmant qu'on peut étudier à
son aise, car il est facile de le voir au grand vol autour d'une pièce d'eau.
Quant à la frégate, c'est le nec plus ultra de la création, le chef-d’œuvre de
la nature en ce genre ; chez elle, l'allongement est général : bras, avant-bras
et main, tout est énorme comme longueur ; aussi est-elle un planeur lent ou
rapide suivant le besoin. Ce modèle qui a tout pour lui ne peut nous servir :
laissons-le, car nous ne pouvons l'imiter.
Nous arrivons donc à remarquer que les deux types extrêmes du vol sont
l'un le martinet et l'autre l'oricou. — Le premier est l'angle aigu,
l'instabilité exacte : c'est la vitesse à outrance ; quelque chose comme le
vélocipède qui ne peut rester debout qu'étant en mouvement.
Les vautours, au contraire, ont les ailes ouvertes à angle renversé. Les
ailes et la queue forment alors trois points sur lesquels s'équilibre la
station.
La disposition de ces trois points mobiles produit le mouvement ou
l'arrêt.
C'est donc sur les dispositions variables de ces trois points qu'est
basé le vol des oiseaux équilibristes qu'on nomme voiliers. L'angle formé par
ces trois points comprend tous les types du vol plané et fournit à toutes les
manœuvres, depuis la stabilité exacte jusqu'à la chute, de la vitesse à
l'immobilité, de l'en avant au recul ; car au point de vue théorique il est
possible d'envisager le vol en arrière.
MANOEUVRES
DIVERSES
Écrire sur les manœuvres que font les oiseaux ressemble assez au fait de
rédiger un tableau ou un morceau de musique : la meilleure description possible
ne vaudra jamais la moindre ébauche ou une simple ligne de notes.
Cependant, comme nous ne pouvons-nous contenter de prêcher
l'observation, nous allons essayer de dire quelques mots sur quelques
évolutions de la gent ailée ; car avant d'oser se livrer à un appareil aussi
bien fait que possible, il faut au moins savoir théoriquement un peu ce qu'on a
à lui faire faire ; sans cela on serait sûr de ne réussir que dans la descente.
Le départ chez les oiseaux se fait de plusieurs manières. Chez la
plupart d'entre eux c'est l'acte le plus facile. Ceux qui éprouvent des
difficultés sont les gros oiseaux d'eau qui sont obligés de courir longtemps en
s'aidant des pieds et des ailes pour pouvoir acquérir la vitesse nécessaire à
la sustention. — Les gros oiseaux de mer à ailes étroites sont dans ce cas, et
en général tous les oiseaux d'eau comme les oies, cygnes et pélicans.
Les rameurs se contentent de faire un saut pour s'envoler ; leurs
pectoraux ont assez de puissance pour les mettre de suite en plein vol. — Au
reste, ce saut est déjà un élancement d'une grande action ; on s'en aperçoit
lorsqu'on regarde sauter un grand passereau complètement privé de ses ailes,
comme un corbeau ou une pie : on voit que ce seul effort les transporte-il un
mètre de hauteur.
Plus les oiseaux auxquels on s'adresse deviennent petits, plus ce saut
devient considérable : voyez le merle, l'alouette, et en plus petit cette
étincelle de vie qu'on nomme la mésange bleue. —Chez les oiseaux la force des
jambes est comme celle des pectoraux, elle croît proportionnellement avec la
diminution du poids. Aussi un rossignol ou une sylvie, dans un buisson,
n'utilisent-ils la plupart du temps leurs ailes que comme appoint d'équilibre
et comme direction.
Les pluviers, certains scolopax, les tringas, etc., se mettent au vol en
courant.
La plupart des grands échassiers, les grands vautours, partent aussi à
la course, mais abandonnent dès qu'ils le peuvent le pas allongé pour le
changer en sauts qu'ils continuent tant que les pattes peuvent toucher la
terre.
Quant aux oiseaux de proie en général, ils ont deux manières de prendre
le vol. — Lorsqu'ils partent de rez terre, avec ou sans charge, excepté les
vautours, c'est toujours par un saut d'un mètre environ qu'ils entrent en
action. Dans les autres cas, étant toujours perchés très haut, ils n'ont qu'à
se laisser tomber et ouvrir les ailes pour se trouver en plein mouvement.
L’arrêt pour les gros oiseaux est une chose sérieuse, qui semble devenir
d’autant plus grave qu'ils sont plus lourds. — Généralement ils ont toujours
soin de se retourner le bec au vent ; par ce moyen ils éteignent leur vitesse
acquise. — Un pigeon inexpérimenté, qui se pose la queue au vent, est
ordinairement renversé ; il roule sur lui-même.
Dans l'état de nature, lorsque le savoir voler est exact, jamais un
oiseau ne manque son abordage.
Par les grands vents, les oiseaux lourds et à grande surface font des
chefs-d’œuvre d'arrêt. Un aigle, dans ce cas, se pose avec une douceur incroyable
: le choc n'est pas supérieur à une chute de 10 centimètres de hauteur.
Quand le vent est nul, les faiseurs de démonstrations qui ont peur de se
secouer se servent d'un autre moyen : ils abordent contre une pente rapide, la
plus accentuée possible, et par ce moyen éteignent encore complètement leur
inertie de mouvement, en remontant autant que leur élancé la demande.
Dans la direction aérienne cette étude devra être poussée à outrance ;
ou y ajoutera une foule d'embellissements, tels que : surfaces à ressorts, lits
de fourrage, immenses cordes tendues, élastiques, avec anneaux auxquels on
s'attachera ; abordages sur l'eau pour les machines disposées pour pouvoir
flotter, etc., etc.
L'atterrissement est l'effroi de la gent ailée. Il y a surtout toute une
classe qui redoute avec juste raison les chutes même minimes : ce sont les
échassiers. Aussi jouissent-ils tous d'une surface énorme, qui a peut-être pour
but unique de leur permettre de se reposer sans risquer de briser leurs longues
jambes.
Les plus heureux sont ceux qui peuvent se reposer sur l'eau. Tout le
monde a vu l'abordage des cygnes, c'est un spectacle qui frappe : ces sillons
qu'ils creusent avec leurs pattes dans l'élément liquide, ces jets d'eau et
d'écume qu'ils soulèvent, tout ce tapage les fait forcément remarquer. — C'est
le mode d'atterrissement commode et pratique auquel l'humanité devra s
'adresser.
Les manœuvres du plein vol sont généralement assez simples : leur
description est éparpillée, dans cette étude. — Il y aurait bien cependant à
parler de la chasse et de la lutte, mais comme ces tours de force sortent du
cadre de l'analyse du vol simple, nous nous bornerons à renvoyer le lecteur à
l'observation.
ÉTUDES D'OISEAUX
Voici une étude sur les oiseaux, qui, malgré son exiguïté, a cependant
demandé de longues années de chasse. J'en possède la fin seulement, les deux
tiers n'ayant pu résister à mes nombreuses pérégrinations : ils ont été perdus,
oubliés ou abandonnés.
Ce n'est pas le tout que de tuer un oiseau, il faut encore l'avoir dans
des circonstances favorables à l'étude, c'est-à-dire avoir deux choses qu'on ne
possède pas toujours : des balances pour savoir le poids de l'animal de suite
après sa mort, puis ce qu'il faut pour pouvoir mesurer et calculer la surface.
Les oiseaux qui arrivent sur les marchés des villes d'Europe sont
généralement impropres à cette étude, parce qu'ils sont presque toujours
desséchés ou vidés, ce qui fait qu'on a toujours un poids problématique. — Sur
cinquante oiseaux rares qui m'ont été adressés, je n'en ai pas reçu trois
utilisables ; à chacun il manquait quelque chose qui me forçait à le rejeter.
Un des derniers reçus est bien curieux, il est rapporté du Choa par le voyageur
Arnous ; mais que tirer d'un paquet de rémiges et de quelques grandes plumes
des couvertures ? — On peut dire d'après leur examen que si ce sont des plumes
de gypaète, cet oiseau atteint une taille extraordinaire dans ce pays : la plus
longue est au moins aussi grande que celle du condor, elle a 0m,74 de longueur.
A moins que ce ne soit le grand autouridé de l'Afrique centrale, dont je
soupçonne l'existence d'après des relations d'Abyssins. Ce serait alors, sur
l'ancien continent, le pendant de la harpie de l'Amazone.
J'ai possédé, pendant de nombreuses années, le plus bel aigle que j'aie
vu ; ni Paris, ni Genève ne possèdent, à ma connaissance, rien de pareil comme
taille et comme beauté : cependant je ne puis donner aucune mesure exacte sur
les aigles.
J'en ai tué une forte douzaine et ne puis en présenter un.
Enfin, la plus belle fille du monde, comme on dit vulgairement, ne peut
donner que ce qu'elle a : J'offre ce qui me reste.
Tous ces oiseaux sont pesés frais. Quant à leur surface, voici comment
je m'y prends : Je les étends sur le dos sur une feuille de papier ; les ailes
sont développées dans l'allure du vol quand il n'y a pas de vent : c'est ce qui
est coté Vent 0" à la seconde. — Quelquefois, lorsque l'aile ne pouvait
pas s'étendre, l'allure arrivait à ressembler à celle que prend l'oiseau lorsqu'il
y a un léger vent : dans ce cas elle est marquée Vent 5 à la seconde, soit
V5". — Enfin, certaines études ont été faites sur des oiseaux dont les
ailes sont disposées comme quand ils volent contre un bon vent : dans ce cas
ils sont marqués Vent 10", Vent 20".
Une fois sur le dos, bien en position, dans
une bonne tournure de vol, ils sont immobilisés avec des poids : ce sont des
lames de plomb pour aplatir les plumes qui se relèvent, et deux ou trois fortes
masses pour tenir les ailes dans le mouvement et pouvoir résister au retrait
des muscles : puis, avec un crayon, rien n’est plus simple que d'en faire une
silhouette précise. C'est donc la surface totale de l'oiseau qui est obtenue,
ailes, queue, corps, tête et pattes. — Du reste, si on ne s’occupait que de la
surface des ailes, on ne serait pas dans le vrai, car en marche, tout supporte,
tout fait aéroplane, plus ou moins bien, suivant sa forme. — Assurément, on
pourrait négliger les pattes aux échassiers ; elles ne sont qu'un obstacle que
l'animal traîne après lui ; mais pour le corps, il n'y a pas à songer à le
supprimer, car il porte d'une manière sérieuse.
Donc, on peut dire simplement que c'est la surface de l'ombre de
l'oiseau.
Pour le calcul des surfaces il faut de la patience, beaucoup de chiffres
et beaucoup d'ordre : c'est une douzaine de triangles à calculer et quatre ou
cinq parallélogrammes. C'est un travail très fastidieux à cause de sa longueur.
On prend alors son courage à deux mains, et quand l'opération est finie, on se
dit que c'est un jalon de plus qui est planté.
Au poids et à la surface sont joints l'envergure et la largeur moyenne
de l'aile, qui permettent alors d'indiquer les proportions de l'aéroplane de
l'oiseau. Ces calculs sont marqués dans les tableaux par une simple fraction de
proportion. : : 5 : 1, par exemple, indique que la largeur étant 1, l'envergure
est 5.
A cela est joint la quantité de surface nécessaire pour porter 1 gramme
; le poids dont est chargé le mètre carré, et enfin quelle serait la surface
qui serait en proportion d'un poids de 80 kilogrammes. Ce poids de 80 kilog.
correspond au poids approximatif d'un homme muni d'un aéroplane léger : c'est
donc la surface qu'il faudrait à l'aéroplane pour tel type.
Pour ne pas présenter au hasard de la lettre alphabétique ces divers
oiseaux, ils sont réunis en famille de vol. Là on trouvera des groupements
bizarres : toutes les règles ornithologiques sont hardiment violées : les charadrius
sont accouplés sans hésitation avec les vanellus ; voire même les
accipitres avec les passereaux, ce qui est infiniment plus grave, etc., etc. —
Il sera visible que la similitude seule de vol a été recherchée.
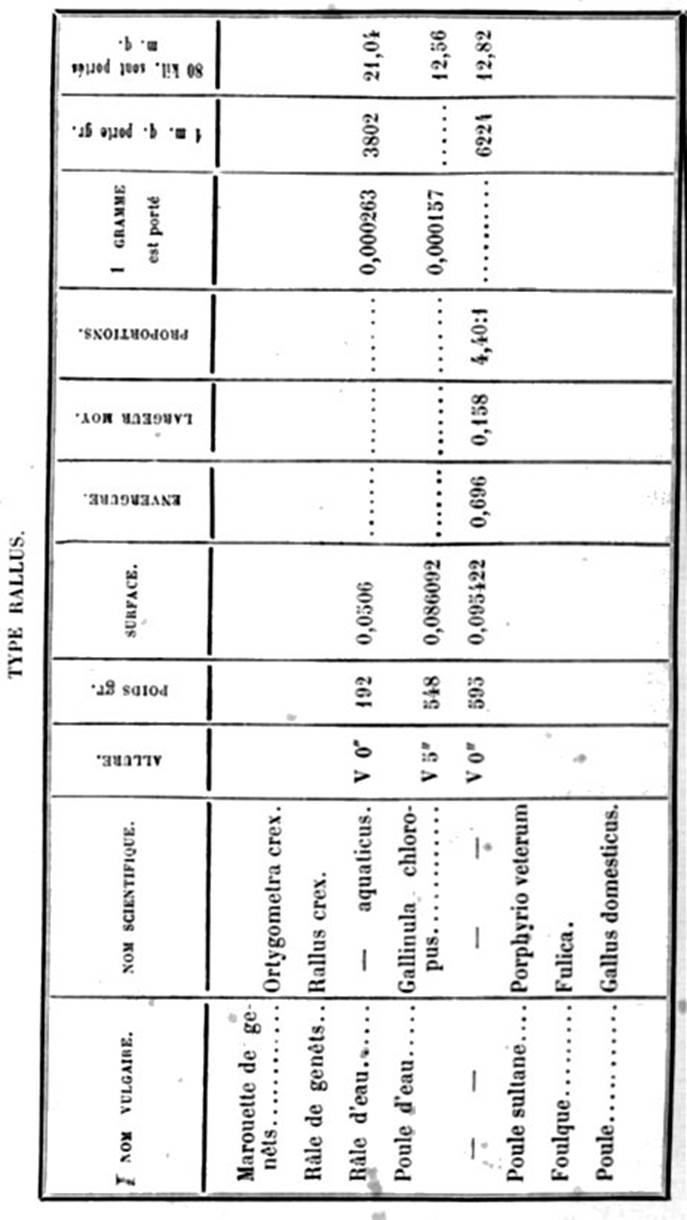
TYPE RALLUS
Sous cette rubrique, sont compris tous les oiseaux qui, en volant,
donnent à leur corps une inclinaison d'environ 45°, au lieu de s'étendre
horizontalement ; position qui est tenue très rigoureusement par les autres
oiseaux.
Les marouettes, les râles divers, les poules d'eau et les poules
domestiques composent cette branche de volateurs. Les dindes, pintades,
canepetières et paons n'en font pas partie, parce qu'ils s'étendent très bien
au grand vol.
Ces oiseaux, quoique volant rarement, sont cependant obligés de faire de
réels voyages ; ils choisissent probablement les grands vents qui portent
beaucoup. — Ces grands courants d'air ont, au reste, une puissance dont on ne
se rend pas compte par l'instinct.
Par un fort siroco d'au moins vingt mètres à la seconde j'ai forcé des
poules kabyles, qui volent un peu mieux, il est vrai, que les poules d'Europe,
à faire de grands trajets, pendant une partie desquels elles ont plané d'une
manière surprenante. Les pintades par ce vent violent se soutenaient en l'air
avec une aisance qu'on n'aurait jamais supposée à un gallinacé.
On voit d'ici poindre une observation de ménagère :
Et les œufs, ce jour-là, ont-ils été nombreux ?
J'avoue ne pas m'en être inquiété ; j'aurais sacrifié toute la
basse-cour à une belle démonstration. Au reste, quand on veut arriver à savoir,
il faut faire ce qu'il faut pour cela, et même saccager les poules au besoin.
Ce sont mes pauvres pigeons qui en ont vu de terribles ; ils ont été mis
à toutes les sauces : ailes courtes, longues, demi-longues, étroites et
longues, étroites et courtes ; ailes agrandies avec des rémiges d'oiseau de
proie, soudées d'une manière très solide à l'étau et à la colle-forte.
Voici ce qui arrive lorsqu'on change la forme de la surface active d'un
oiseau. Comme il a la prescience de son vol particulier, il vole à sa manière
habituelle ; mais ses organes ne sont plus disposés pour produire ces effets
coutumiers, ils sont taillés de manière à en produire d'autres. L'oiseau se
trouve donc, par ses habitudes et son instinct, avoir un vol, et par sa
disposition nouvelle en avoir un autre. Cette dernière le rappelle à chaque
instant à la nécessité du moment ; le besoin l'amène, bon gré mal gré, à voler
comme vole le type qu'on lui a donné.
Ainsi, un faucon crécerelle qui avait son nid près de mon observatoire
eut les rémiges coupées de moitié juste : c'était le transformer forcément en
rameur. Je lui rendis la liberté, et comme il resta sur son territoire de
chasse, j'eus toutes les occasions possibles de l'étudier. — Quoique bien gêné
il n'était cependant pas trop malheureux ; ses proies lui échappaient bien
quelquefois, mais il remplaçait les moyens qui lui manquaient par une activité
qui suppléait à ses nouveaux défauts. — Il était facile à remarquer, car cette
mutilation lui donnait une tournure insolite : cette longue queue, qui
paraissait encore plus longue maintenant qu'elle n’était plus accompagnée par
deux longues ailes, attirait de loin le regard.
Il ramait donc constamment ; seulement, à chaque instant il se laissait
glisser suivant sa vieille coutume, mais comme il se sentait choir outre
mesure, le sentiment de la sustention le forçait à recourir de suite aux
battements.
J'ai transformé des milans en procellarias en leur rognant les ailes de
la moitié sur toute la longueur et en leur supprimant la queue. L'effet produit
a été de les forcer, malgré leurs habitudes de planeurs par les vents faibles,
à rechercher les grands vents qui seuls les soutenaient sans fatigue.
Il faut, comme on le voit, pour pouvoir se livrer il ces études,
disposer complètement de l'oiseau, l'avoir parfaitement sous la main.
L'augmentation de surface a moins bien réussi ; je l'ai essayée sur des
pigeons et sur deux milans mes voisins ; je n'étais parvenu qu'à en faire des
oiseaux excessivement embarrassés dans leurs mouvements. — Il aurait fallu
s'adresser à un autour ; mais comment pouvoir étudier un oiseau aussi fugitif,
tandis que les milans ont un habitat fixe, qui fait que, s 'il manque une plume
importante à celui de votre quartier, vous pouvez le reconnaître, le préciser,
et par conséquent l'étudier.
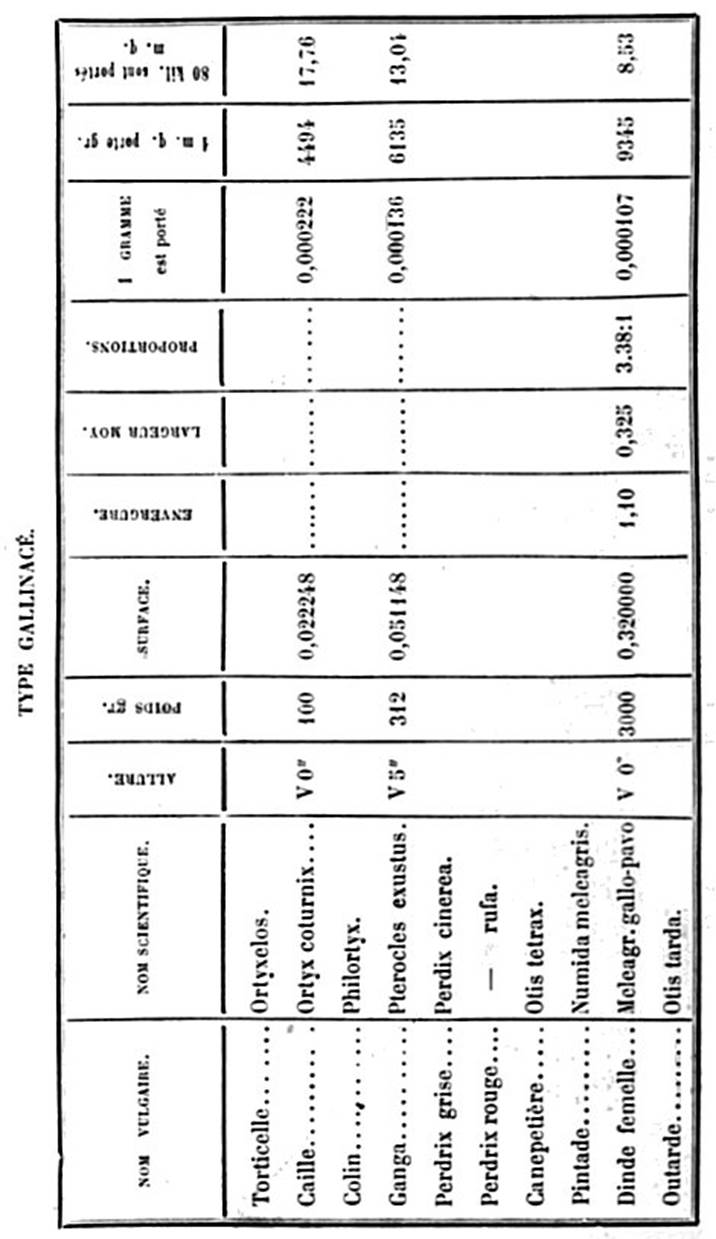
TYPE GALLINACÉ
Le type gallinacé est peu intéressant au point de vue de cette étude :
ce n'est certainement pas là que nous devons chercher des modèles.
Ils sont tous des rameurs excessifs.
La loi de disproportion des surfaces comparée aux poids suit la même
progression que dans les autres tableaux. Plus le poids de l'animal augmente,
plus sa surface proportionnelle diminue.
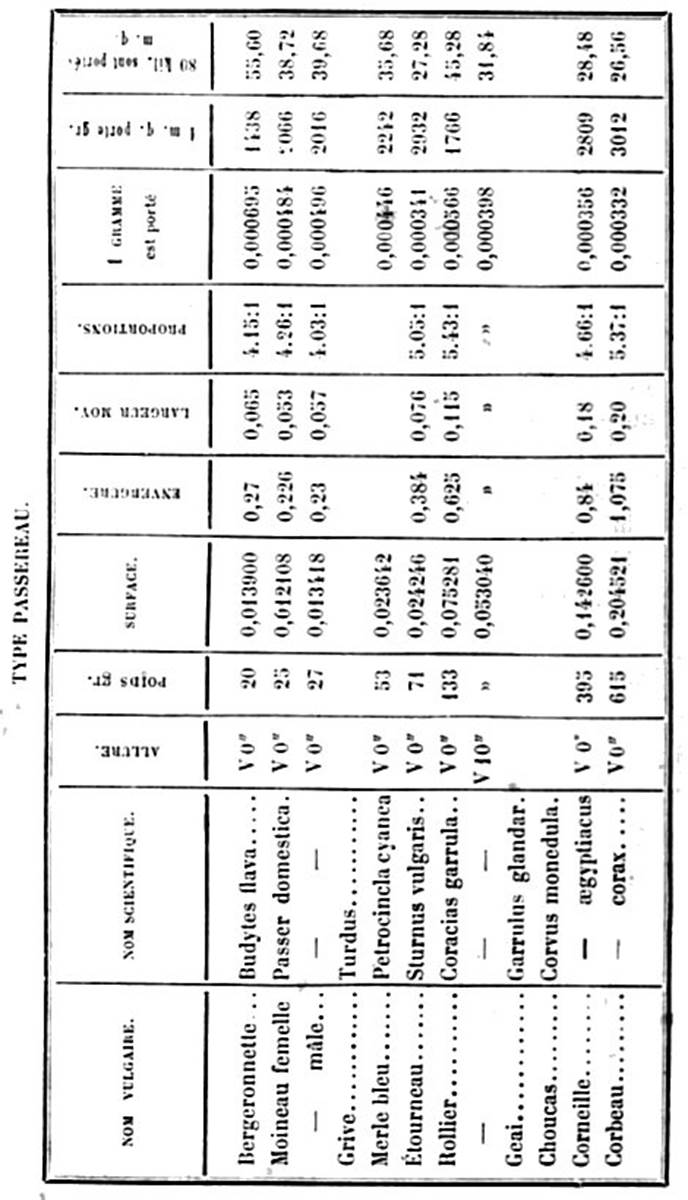
TYPE PASSEREAU
Type qui, malgré ses qualités exceptionnelles, est peu intéressant pour
la recherche qui nous occupe.
Il est inimitable à cause de la grande puissance dont il dispose ; puis,
les grands modèles font défaut, la nature ne dépasse pas l'oiseau moyen, le
kilogramme est la limite extrême qu'elle s'est permise.
ÉTOURNEAU (Sturnus
vulgaris)
Cet oiseau est un bon rameur, peu intéressant cependant comme individu :
le lecteur le connait ; il niche dans le nord, traverse la France en octobre
par petites troupes de quinze à vingt individus, se rend en Afrique où il passe
l'hiver.
Jusqu'ici il ne présente rien de particulier à nos yeux ; sa manière
d'être est la même que celle des merles, des grives et autres oiseaux de cet
acabit ; mais, arrivé en Algérie, la scène change, l'individu disparaît pour
faire place à la collection. C'est sous cet aspect que nous allons l'étudier.
Je vais raconter ce que j'ai vu bien souvent :
A trois kilomètres de ma ferme se trouvait la forêt de Baba-Ali, où se
réunissaient le soir ces bandes d'oiseaux. C'était à cette époque une immense
broussaille de deux ou trois mille hectares. — Des saules noirs émergent d'un
buisson de ronces, grand comme une contrée : voilà le tableau.
On ne pénètre que sur les bords de cette mer d'épines, et encore pas
bien profondément : les sangliers seuls peuvent s'y mouvoir au moyen de leurs
percées boueuses, et cheminent ainsi sous-bois dans tous les sens.
Dès que l'aurore pointe, ces oiseaux s'éveillent et se mettent à
gazouiller. Le chant de l'étourneau est excessivement fin, c'est tout ce qu'il
y a de plus délicat ; il semble chanter pour lui ; malgré cela, on les entend
très bien de quatre kilomètres. Les Arabes nomment ce chant matinal, qui emplit
la contrée, la prière des zour-zour (étourneaux).
Peu d'instants avant le lever du soleil, cette musique cesse subitement
; alors se produit un effet d'optique curieux : la forêt semble s'élever ; ce
sont les étourneaux qui s'envolent. — Un autre bruit se perçoit ensuite, bruit
qui va en augmentant, et finit par devenir inquiétant, formidable. Il est
produit par ces milliards d'ailes qui battent ensemble et font cette harmonie
étrange.
Ces vols, alors, produisent de vrais phénomènes météorologiques. Ils
font des éclipses totales, avec cette lumière tremblante, gris d'acier, qui est
particulière à ce phénomène. — Le crépitement des ailes imite la grêle, la nuit
est venue, les ténèbres ont succédé à la lumière.
On les regarde passer avec stupéfaction ! Il en passe pendant des quarts
d'heure entiers, sur cinq ou six cents mètres d'épaisseur.
La fin de ce vol monstrueux va en diminuant d'opacité, elle s'égrène
légèrement ; la prairie alors en est couverte : non seulement tout touchant,
mais sur un pied d'épaisseur. — Ils sont là, tous, voletant, cherchant une
petite place pour pouvoir boire l'eau du marais.
La masse cependant a fini par passer, le ciel s'est éclairci, les
retardataires se jettent dans les troupeaux, vont, viennent, sautillent,
gazouillent, font bon ménage avec les bêtes, leur montent hardiment sur le dos,
piquent les tiques, et n'ont aucune peur des bergers.
A neuf heures, ils se dirigent par petites familles vers l'Atlas, où ils
passent la journée à manger des olives sauvages. — On ne les revoit plus avant
le soir, où, quelques instants avant le coucher du soleil, apparaissent au loin
dans les airs d'immenses serpents, qui cheminent lentement vers la forêt, en se
tordant dans tous les sens. — D'autres fois, ce sont d'énormes sphères à
mouvements rapides et à contours changeants : cette manière de se grouper est
leur ordre de bataille pour résister à l'attaque du faucon. Leur ennemi plonge
et replonge dans cette boule, mais la légion s'écarte, le laisse passer, se
referme, et ce n'est que rarement que le vorace réussit dans son attaque.
Plus tard, quand la nuit approche, de petits vols de retardataires,
composés d'une centaine d'individus, passent agglomérés en boule. Ces petits
groupes se meuvent à un mètre du sol avec une vélocité surprenante.
L'étourneau isolé ne présente jamais cette vitesse : il y a là un effet
d'excitation, et peut-être une action de masse. — Le fait est que, serrés comme
ils le sont, le cent tient dans l'espace de deux mètres cubes ; la nuit aidant,
— qui ne permet pas de les voir venir, — ils causent une surprise, qui rappelle
très bien l'effet désagréable produit par les projectiles qui passent trop
près. En cinq minutes ils sont à la forêt : suivons-les au perchoir, là nous
attend un spectacle intéressant.
Nous approchons, la forêt est en face, il n'y a que l'Arrach à
traverser. — La nuit est noire, mais comme la rivière n'est pas forte, le gué
est vite trouvé.
Enfin nous y voilà !
C'est là qu'il faut des bottes, le sol est un marais détrempé ; il faut
absolument suivre le sentier des bestiaux, et il y a de la boue jusqu’aux
genoux. — Quoique nous ne soyons que sur la lisière du bois, nous avons
parfaitement conscience de la proximité de ce milliard d'êtres.
Avançons.
Quel curieux feuillage ont les saules de Baba-Ali ! et ces branches !
Mais au fait tout cela ce sont des oiseaux ; quelle immensité vivante ! quelle
myriade d 'êtres ailés !
« Ne risquons-nous rien?... »
«Gare!.... un arbre vient de casser?... » Quel épouvantable vacarme
! nous sommes littéralement dans les étourneaux et tout couverts de fiente.
Toutes ces pauvres bêtes déplacées subitement cherchent dans la nuit une
nouvelle place : c'est un bourdonnement indescriptible. — Cependant, lentement,
petit à petit, tout ce monde de volatiles finit par se caser, après nombre de
coups de bec et force criailleries.
Mais — silence ! — Qui vient là ? — Ne bougeons pas, car il y a des
panthères et des maraudeurs dans la forêt.
Ce n'est heureusement rien de dangereux. Ce sont des Arabes chasseurs ;
nous allons les voir à l'œuvre.
Leurs armes sont de grandes branches enduites de glu, qu'ils promènent
sur ces masses noires, sur ces grappes d'oiseaux.
C'est un chaos horrible ; toutes ces malheureuses bestioles, les ailes
collées, tombent à terre en criant, essayent de remonter dans les arbres, ne
peuvent y parvenir ; le tumulte est si grand que c'est à se boucher les
oreilles, quand enfin, complètement affolés, les oiseaux de tout ce canton
partent en masse avec un bruit de tonnerre, disparaissent subitement dans la
nuit, et vont chercher pour dormir d'autres parages plus hospitaliers.
Nous pouvons partir, la chasse est finie : demain matin les Arabes
viendront les ramasser. — Tous les chacals seront repus, les sangliers auront,
la nuit entière, fait craquer sous leurs terribles mâchoires ces pauvres petits
corps ; mais il en restera bien encore quelques mille pour alimenter le marché
d'Alger.
CORNEILLE
Cet oiseau est le pendant du renard pour la finesse, peut-être même son
supérieur comme intelligence.
Rien de fin, de délié comme ce spirituel animal. Il a la malice de la
pie, mais moins bruyante, plus sérieuse ; ses actes sont raisonnés.
Ce carnivore est le plus grand chercheur qu'on puisse rencontrer. La
nature pour lui permettre de remplir cette mission lui a donné un jugement, un
entendement incroyable ; sa petite cervelle raisonne avec une justesse
parfaite.
Ce qui lui permet de vivre, ce n'est ni son vol perfectionné, ni ses
pattes élastiques et puissantes comme des ressorts, ni son bec vigoureux :
c'est la pensée qui est sa force dans la lutte pour l'existence.
Ce qui se passe dans cette petite tête est prodigieux ; il faut étudier
la corneille en liberté pour s'en faire une idée. Ces animaux, en cage ou en
demi-liberté dans une habitation, ne montrent qu'une faible portion de leurs
dons. — Dans l'Est, dans la Russie, la Turquie d'Asie, la Perse, l'Égypte,
l'Inde, ils vivent aux dépens de la société ; ils sont voleurs, bruyants,
ennuyeux, par conséquent souvent en butte à des répressions ; mais, soit
paresse de l'homme, soit adresse de la bête, ils restent toujours et quand même
le commensal de la société.
Ils sont ci, là, sur l'arbre de la cour, dans le jardin, surveillant de
leurs yeux noirs si l'occasion de commettre un larcin ne se présente pas. Qu'un
pigeon sorte trop tôt de son pigeonnier, qu'un jeune chat se hasarde trop loin
de l'habitation, il est aussitôt mis il mort à grands coups de bec. Qu'une
ménagère oublie quoi que ce soit dehors, ce quoi que ce soit disparaît s'il
brille ou s'il est aliment. — Quant aux poules, leurs œufs jouent positivement
de malheur, la corneille va les voler jusque dans le poulailler.
Voulant voir de près comment ils s'y prennent pour s'emparer d'un œuf,
j'en pris un jour un et le mis sur une terrasse, à la portée de mes voisins qui
étaient très familiers. — Ils ne se firent pas prier. — Rien n'est plus facile
pour eux, leur bec s'ouvre largement, et l'œuf y tient très bien.
Vexé de voir avec quelle facilité ils exécutaient ce que je croyais être
pour eux une difficulté, il me vint une idée :
Ils prennent facilement un petit œuf de poule, me dis-je, mais je vais
leur en présenter un qui demandera une autre ouverture de compas pour être
enlevé.
Je pris un gros œuf de dinde, et le leur
donnai.
Le mâle, plus hardi que la femelle, vint,
regarda ce monstre avec inquiétude, il n'en avait probablement pas encore vu de
pareil, tourna autour, flairant un piège, finit par se rassurer, et chercha une
combinaison. Ce travail de la pensée dura bien une minute. Enfin, poussant un croo
qui devait être sûrement un eureka, il se précipita sur l'œuf, perfora
d'un coup de bec, passa par ce trou sa mandibule inférieure, avec la supérieure
fit pression contre la coquille, et s'enfuit avec son butin.
Voilà la pensée dans toute son acception ; c'est la combinaison pure et
simple, la difficulté tournée et vaincue. Ceux qui nient la pensée chez les
animaux auraient-ils fait mieux ? Au reste, à cette catégorie de gens qui
n'observent pas, qui ne reconnaissent à l'animal que l'instinct et nient chez
lui la pensée, je vais leur proposer un problème à résoudre avec leur encéphale
perfectionné, apte à trancher ces difficultés de combinaison.
Quittons le monde des volateurs, et jetons un instant les yeux sur cette
créature que Dieu donna à l'homme en le voyant si faible, d’après la charmante
genèse de Toussenel :
J'avais en Algérie une petite ferme où j'élevais seulement des bestiaux
sous la garde de bergers kabyles. — De temps en temps j'y allais coucher pour
tenir mes hommes en haleine et pour dérouter les maraudeurs.
Un matin donc, que j'y avais passé la nuit, je fus réveillé par des cris
qui me firent rondement sauter à bas de mon lit et me mettre à la fenêtre.
Voici ce qui causait ce remue-ménage : un veau de lait s'était échappé
de son box, le troupeau était déjà au loin, et la bête folâtre, heureuse d'être
en liberté, gambadait dans la prairie et s'en donnait à cœur joie.
Je descendis pour donner un coup de main aux Kabyles, parce que un veau
qui fait de la voltige n'engraisse pas ; mais ce n'était pas chose facile de
l'attraper, nous n'étions que quatre, et il nous échappait constamment.
Parmi la smala de chiens qui me suivait toujours, j'en avais un énorme,
magnifique dogue de combat, gros comme le veau que nous poursuivions.
Je le sifflais pour avoir du renfort.
Bobo, c'était le nom de ce vieil ami, en trois bonds fut vers nous ; et
là me demanda, avec ses grands yeux de phoque, ce qu'il fallait faire.
— Attrape ! lui dis-je.
— Facile, me fut-il répondu.
C'était vrai, un taureau de cinq cents n'allait pas loin avec lui.
— Doucement ! dis-je, voyant qu'il allait le prendre par le cou ou par
l'oreille.
Bobo, docile comme une machine, fut à l'instant sur son derrière.
— Attrape ! redis-je ; doucement ! doucement, ne lui fais pas de mal.
Le chien me regarda bien en face ; ses yeux disaient : Tu me dis de
prendre et de ne pas prendre, que veut dire cela ? Il était complètement
dérouté, et franchement il y avait de quoi l'être... — Enfin, une idée lui
vint, il courut après le veau, au petit trot, sans l'effrayer, et ….
Au fait, que ceux qui nient le raisonnement chez les animaux veuillent
bien pour un instant se figurer qu'ils sont chien de prise, c'est-à-dire qu'ils
ont quatre pattes, qu'ils sont très forts et ont une mâchoire terrible ; qu'il
s'agit d'arrêter un veau gras, délicat, qu'il ne faut pas blesser. — Raisonnez,
cherchez, j'attends la réponse ; Bobo, lui, a trouvé (1).
Mais revenons à nos moutons, c'est-à-dire à nos corbeaux.
(1) Dans la seconde édition de cet
ouvrage, nous donnerons les noms des personnes qui auront trouvé la solution de
ce problème.
Les faits que je viens de citer sur la corneille mantelée semblent
étrangers à l'étude qui nous occupe ; cependant ils s'y rattachent exactement
par un point, c'est par la démonstration de la variété de mouvements que doit
permettre le vol à ces oiseaux pour pouvoir mener une pareille existence.
On pourrait dire d'eux qu'ils sont le type du vol sociologique.
Les grands corbeaux, le corvus corax d'Europe, les corvultur et
picathartes de l'Afrique centrale, sont souvent de bons voiliers ; ils
sont moins actifs que les petites espèces ; se servent d'elles en suivant leurs
indications, et servent eux-mêmes d'intermédiaires aux percnoptères, dans cette
grande échelle d'êtres ailés qui est chargée de la voirie terrestre.
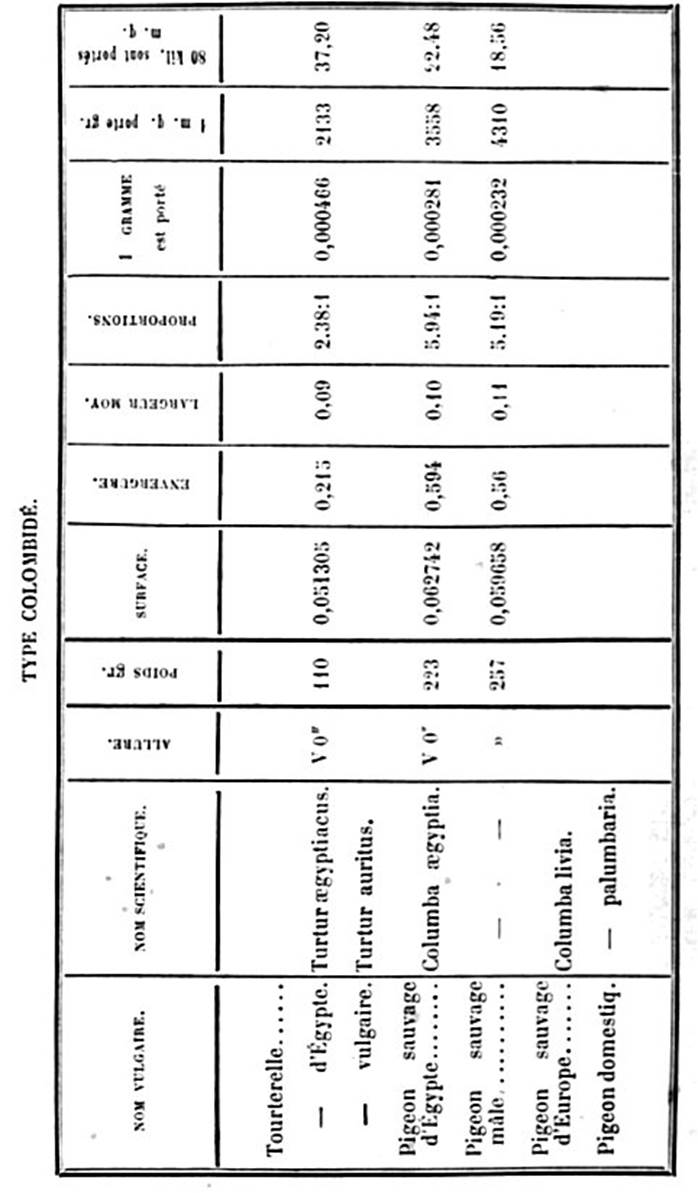
TYPE COLOMBIDÉ
Groupe de modèles
inimitables et inutiles.
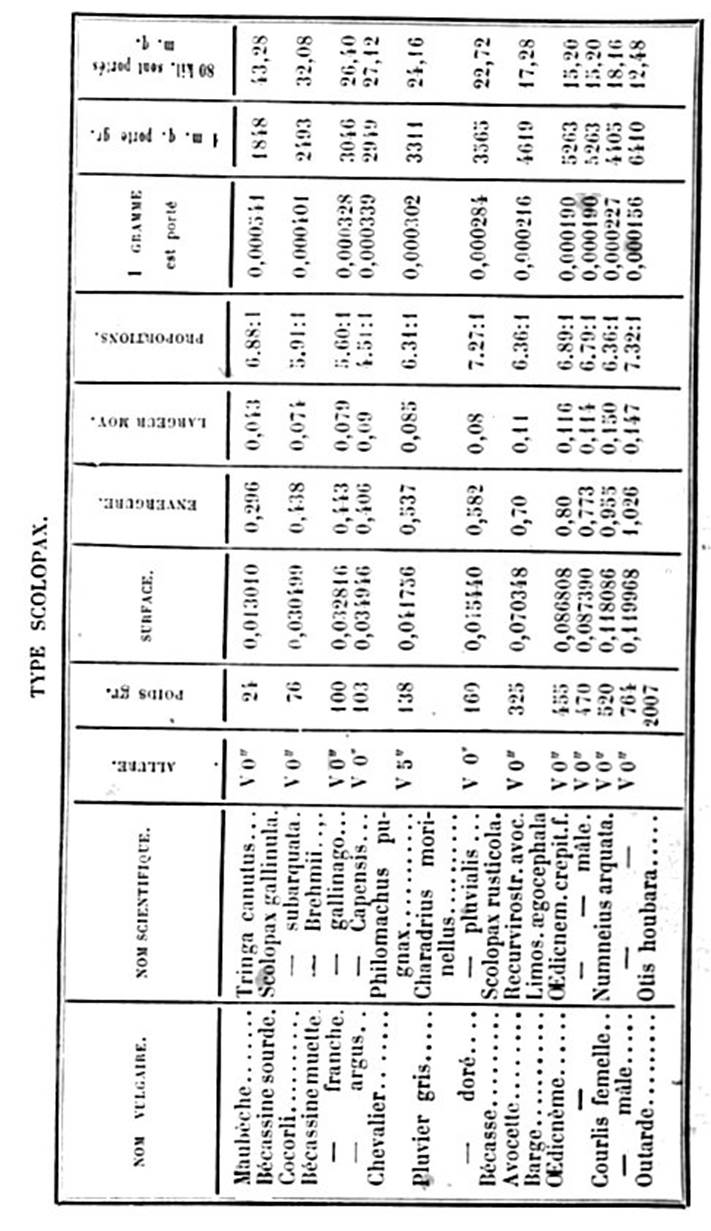
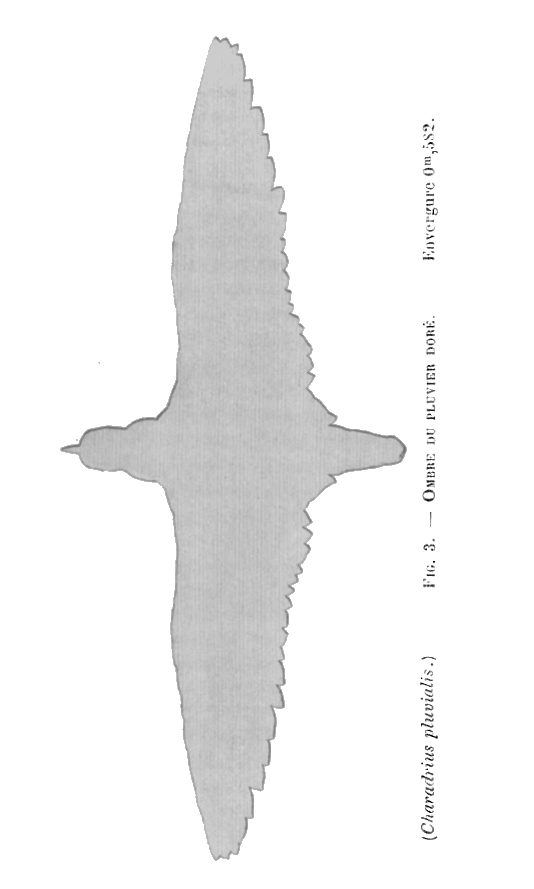
SCOLOPAX
Cette branche renferme des oiseaux qui possèdent un vol très rapide. Ils
en ont besoin pour échapper aux oiseaux de proie.
Comme ils sont obligés de vivre dans des endroits complètement
découverts ; que nul abri n'est à leur disposition, il leur faut une grande
vélocité, et surtout la plus grande puissance de départ possible.
La bécassine qui s'enlève semble être lancée par un ressort. Cette
ascension rapide doit dérouter les rapaces ; au reste, ne s'adressent-ils
jamais à elle.
Ces oiseaux ont ensuite besoin de cette grande vitesse de translation
pour pouvoir se transporter aisément d'un étang ou d'un marais à un autre ; et
la distance qui sépare ces nappes d'eau est ordinairement très considérable.
Pendant ce trajet leur célérité les protège efficacement contre toute attaque.
OUTARDE HOUBARA
Cet oiseau est le lien qui unit les charadrius aux gallinacés. Au point
de vue de la conformation extérieure, c'est un pluvier plutôt qu'une poule :
l'absence de pouce, cette tête de serpent, ces ailes aiguës, minces et longues,
ne laissent aucun doute sur la parenté. — Cette tranche hybride commence par
l'œdicnème et devait finir, par l'absurde, au dronte, en passant par
l'autruche, le diornis, l'epiornis, etc.
Cet oiseau s'envole par un saut en l'air comme la canepetière. Son vol,
vu son poids et la conformation de ses ailes, est singulièrement rapide et
rectiligne. — Il fait par moments, lorsqu'il cherche à se reposer, des temps de
planement à la façon des pluviers qui abordent une terre labourée.
C'est un oiseau excessivement rare et sauvage, qu'on aperçoit
quelquefois au loin dans les roches du désert ; et qui, pour s'éloigner du
chasseur, n'a pas besoin de lui offrir le spectacle de son vol : la vitesse de
sa course suffit amplement à le mettre en quelques instants hors de portée.
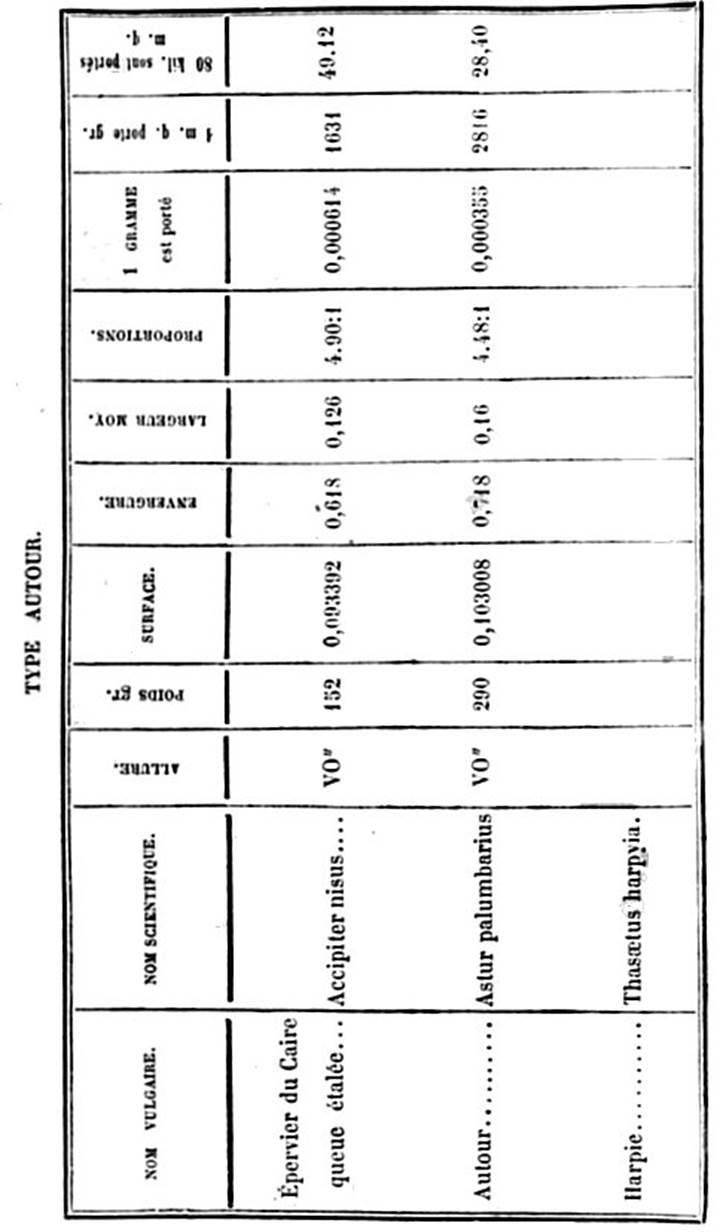
AUTOURIDÉS
Ces oiseaux sont séparés de la
grande famille des oiseaux de proie, parce que, quoique étant des rapaces, il y
a entre ces deux divisions des différences profondes : l'une possède ce qu'on
pourrait appeler le grand vol, et l'autre le vol court.
Chez les aigles, les faucons, les milans et les busards, les rémiges
sont longues, la deuxième et la troisième sont les plus allongées ; ce qui leur
donne des ailes aiguës. Chez les autouridés, c'est la cinquième rémige qui est
la plus longue ; puis l'ensemble des rémiges est remarquable par sa brièveté.
Ce ne sont plus des oiseaux de haut vol, comme hauteur et comme durée ;
ils sont fréquemment posés,
Ils comprennent trois espèces : les éperviers, les autours et la harpie
qui a la même conformation, et est forcée d'avoir le même vol. — Je ne connais
pas la manière de se mouvoir de cet animal, ne l'ayant jamais vu, mais je suis
sûr d'être dans le vrai en disant qu'il a en grand les mêmes allures que
l'autour.
La nature nous présente en cet oiseau le chasseur de la forêt. Sa vie se
passe dans les arbres. Son fort à lui n'est pas d'attaquer en rase campagne un
lièvre ou un canard : il n'y réussirait pas ; c'est de poursuivre sous-bois les
oiseaux ou les mammifères. La puissante queue des oiseaux de cette famille leur
a été donnée
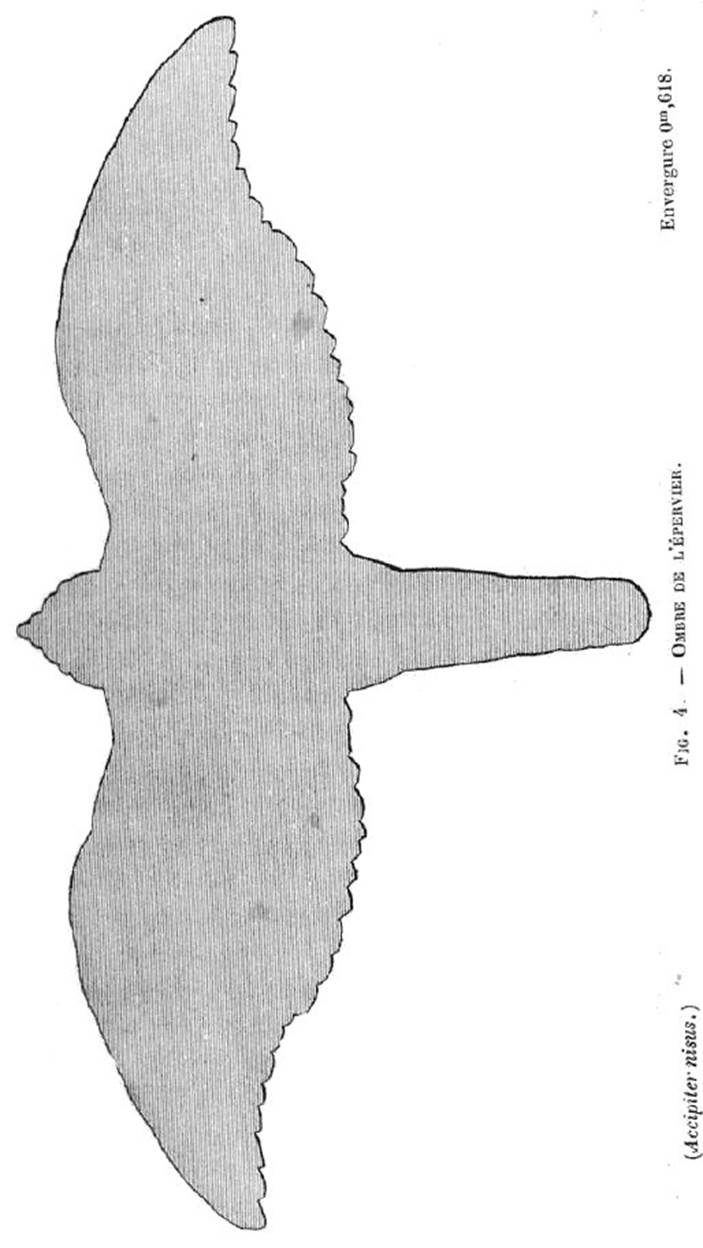
pour pouvoir produire subitement
des angles très prononcés : il leur faut pouvoir attraper sous-bois un pigeon
ou une tourterelle, et c'est ce vigoureux gouvernail qui leur permet de se
faufiler à toute vitesse entre les branches innombrables et les troncs
d'arbres.
Il y a un autre oiseau qui arrive au même résultat par un autre moyen,
c'est le grand-duc.
Ses besoins sont les mêmes ; c'est aussi sur la lisière des bois et dans
les arbres que se passent ses exploits cynégétiques. Sa queue est nulle :
impossible de s'en permettre une dans les trous où il a l'habitude de se
blottir ; elle serait trop gênante.
Comment faire ?
Il s'en sort par une aptitude toute particulière que la nécessité lui a
fait acquérir : c'est une mobilité et une puissance extraordinaires dans la
manière de présenter les plans de ses ailes. — Dispositions qui changent sa
direction avec une incroyable célérité. Nul autre volateur n'a ce don aussi
développé.
Aussi avec quel étonnement regarde-t-on un de ces énormes oiseaux voler
sous-bois ; on ne revient pas de cette adresse ; l'habitude qu'on a de voir se
mouvoir d'une manière très rectiligne les oiseaux qu'on voit ordinairement,
fait que le vol du grand-duc stupéfie ; c'est à croire qu'à chaque instant il
va se heurter contre quelque arbre, et cependant tout est évité. Il passe
silencieusement, horizontalement ou même verticalement, dans des espaces où à
première vue il n'y a pas passage, et cela toujours avec une précision
mécanique, sans hésitation ni arrêt de vitesse.
C'est bien le vol le plus extraordinaire qu'il soit possible de voir ;
seulement, c'est un spectacle rare, même pour les habitants de la campagne.
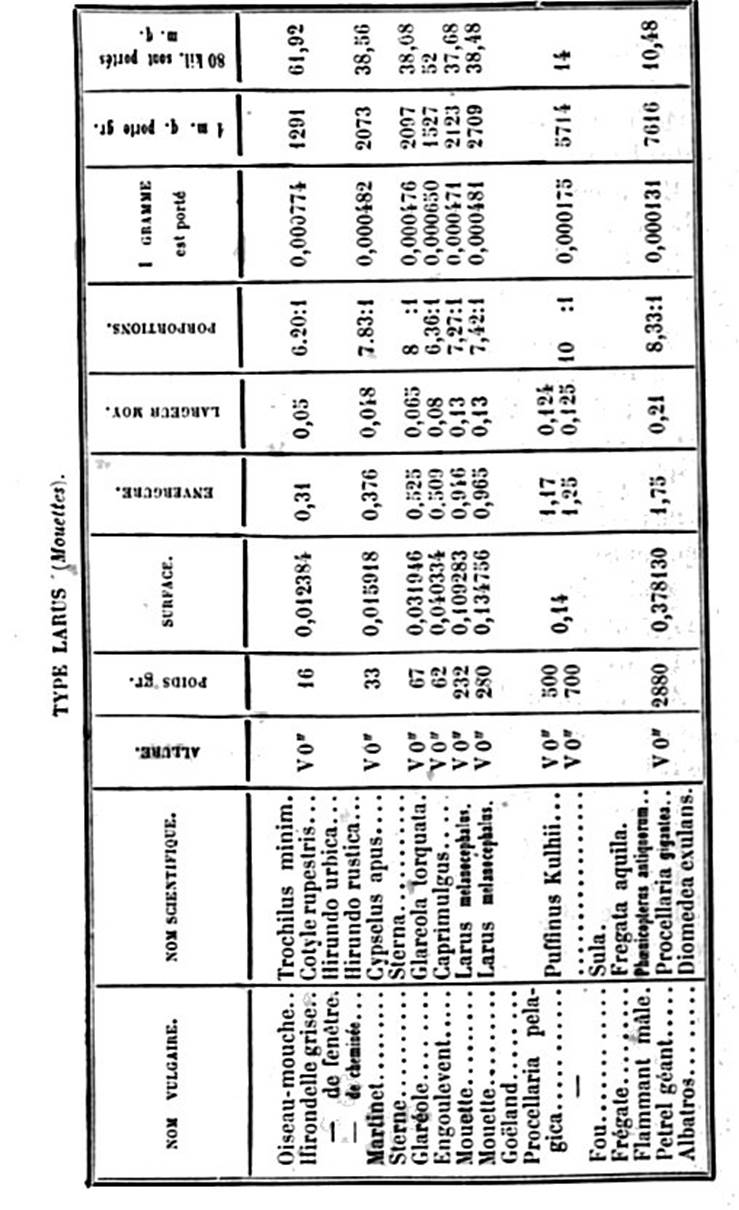
TYPE LARUS
Ce genre nous enseigne une chose, c'est que, pour pouvoir stationner et
se mouvoir dans les grands courants d'air rapides, il faut éviter le
traînement.
La grandeur de l'envergure a moins
d'action que la largeur de l'aile. — C'est rationnel ; mais il faut avouer que
la nature a bien fait de l'enseigner, car c'était une déduction difficile à
trouver.
Nous remarquons que les proportions sont de 6 à 10 : 1.
L'albatros, qui n'est pas sur ce tableau, doit dépasser de beaucoup ce
rapport, car on parle de 5 mètres d'envergure, et cet oiseau a au plus 25
centimètres de largeur d'aile. Ce serait donc environ comme 20 : 1.
Cet enseignement est excessivement important, il aura son emploi dans la
construction des aéroplanes à forme variable.
OISEAU-MOUCHE
Un bijou splendide, mais qui nous
est complètement inutile.
HIRONDELLE
Charmants oiseaux dont le vol est tellement
remarquable qu'il n'est bon qu'à réjouir nos yeux.
MARTINET
Oiseau paradoxal, qui vole bien et vole mal ; reste cependant en l'air
en permanence. Il est tout plumes et pectoraux, le reste est nul. Ses défauts
sont énormes ; il ne plane pas du tout, du moins à la manière ordinaire ; ne
rame pas mieux, surtout quand il n'a pas de vitesse ; va vite, mais pas comme
une sarcelle, et est cependant étourdissant : c'est le rustique barbare des
airs.
GUEPIER (Merops
apiaster)
Ce joli oiseau a le vol de l'hirondelle. Il est comme elle un
insectivore. Il se nourrit spécialement de guêpes carnivores et d'abeilles
maçonnes, qui sont très communes dans les pays qu'il fréquente.
L'apiaster a pour habitat le nord de l'Afrique, la Syrie, la
Sicile et généralement tout le littoral de la Méditerranée. Le thebaïca
se rencontre sur le Nil, il la hauteur du tropique. La région des grands lacs
possède de nombreuses variétés de cet oiseau, qui pour la plupart ne sont pas
décrites.
Les guêpiers passent leur vie presque
complètement en l'air ; ils se tiennent souvent réunis en vols nombreux, sans
ordre, poussant continuellement leur cri, qui s'entend malgré qu'ils soient
trop haut pour que l'œil puisse les discerner.
Le vol de cet oiseau se compose d'une série de battements précipités,
suivis d'une longue glissade très élégante, et souvent d'une simple poussée
produite par la fermeture complète des ailes qui lui procure une chute d'un
mètre : chute suffisante pour lui permettre de planer une demi-minute. — Par
instants il est complètement voilier, mais ordinairement il pénètre le courant
d'air à la manière des hirondelles et des martinets, et le fait aussi bien
qu'eux. Cependant son vol est plus lent, plus rectiligne que celui de ces deux
mangeurs de mouches. A cause des deux longs brins qui ornent sa queue il fait
peu de crochets ; il cueille l'insecte à toute vitesse sans jamais se
retourner.
Ces oiseaux se posent cependant quelquefois : quand ils sont près de
leurs nids, c'est sur les grandes herbes qu'ils aiment à se percher ; quand ils
sont en voyage, ils choisissent certains arbres sur lesquels ils se groupent en
quantité assez considérable pour transformer, comme aspect, un arbre mort en un
arbre très feuillé : chaque individu simulant alors, à s'y méprendre, une
feuille, dont il a la couleur. — C'est sur ces agglomérations que se font les
grands coups de fusil des Nemrod novices. — Comme chair il est à peine
mangeable ; on ne le met à la casserole que dans les pays où il n'y a pas de
gibier. En tous cas, son plumage vert métallique fait son malheur, car il lui
vaut beaucoup de coups de fusil, qui n'ont d'autre but que celui de pouvoir le
contempler de près.
Je n'ai rencontré ses nids, en grand nombre, que dans les Bararis, pays
inculte et noyé, qui sépare les terres cultivées de la Basse-Égypte des grands
lacs Burlos, Manzaleh, Edko. — Le voyageur qui fait son tour d'Égypte, qui voit
le Caire, visite les antiquités du Saïd et traverse le delta en chemin de fer,
part avec la conviction d'avoir bien vu la vieille terre des Pharaons, ou au
moins d'avoir une idée bien exacte de tous ses aspects. Cependant, un des
grands côtés de ce pays lui a échappé ; il est une contrée très vaste dont il
ne soupçonne pas l'existence : ce sont les Bararis, immenses steppes noyées,
allant en latitude d'un
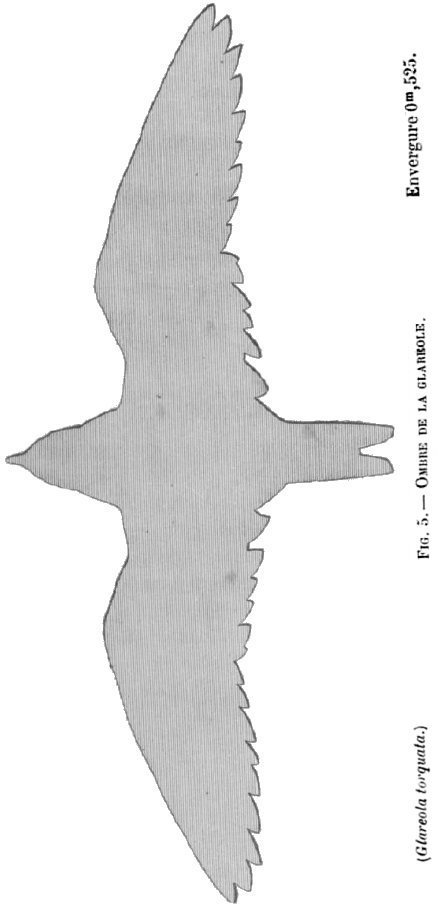
horizon à l'autre, et en longitude du canal de Suez au
Bahr-Youssef.
En entrant dans ce désert marécageux par Belqas, on voit, à une heure de
marche en descendant au Nord, les cultures cesser subitement. —La terre, sans
être cependant improductive, ne possède comme végétation que des roseaux,
quelques tamaris et la bruyère des terres salées.
C'est là qu'est le paradis des chasseurs au marais ! — Les canards et
les sarcelles s'y voient par millions, le scolopax cocorli anime ces
solitudes de ses cris aigus auxquels répondent les sternes et les mouettes, qui
arpentent cette plaine immense à grands coups d'ailes réguliers. Les deux
martins-pêcheurs, le vert et le noir et blanc (coryle rudis), se
rencontrent à chaque pas. — L'aigle africain plane sur toutes ces flaques
d'eau, plonge de temps en temps dans les roseaux, d'où il s'enlève ensuite
lourdement, pour transporter avec peine sa proie sur quelque côm qui fait île,
et dont il fait sa résidence. — Parfois enfin, on voit se dessiner sur le ciel
d'un bleu cru la gigantesque silhouette de l'oricou, qui du haut des nues
étudie cette contrée noyée, pour y découvrir quelque cadavre de buffle apporté
par les canaux.
Il y a de tout dans ces solitudes, depuis la caille jusqu'à loutarde
houbara, depuis le pélican jusqu'au petit plongeon (colimbus minor),
depuis la loutre jusqu'au sanglier. On voit même, de temps en temps, des
sentiers tracés dans la boue par les pas des hyènes et des loups blancs.
L'homme y est rare ; on ne rencontre pas le moindre hameau. Par hasard,
on apercevra au loin un arabe se profiler à l'horizon : c'est un pêcheur de
bayades ou un chasseur, qu'on fera bien de tenir à distance, car dans ces parages,
comme au far west américain, les relations ne dépassent pas comme approche la
portée d'un bon fusil.
Ce pays inhabité et très peu connu est rempli de petites montagnes de
création humaine : ce sont des ruines de villes, dont pour la plupart les noms
ne nous sont pas parvenus. Cependant quelques-uns de ces monticules ont de
grandes pages dans l'histoire de l'humanité : ceux de Sâne recouvrent les
ruines de l'ancienne Tanis, capitale des rois Hycsos, et celui de Sakha,
celles, bien plus anciennes encore, de Xoïs, berceau de la quatorzième
dynastie. — Il y en a d'énormes, qui couvrent des centaines d'hectares, et dont
la hauteur est souvent de 40 à 50 mètres. Ces petites montagnes sont formées de
briques crues parsemées de débris de poterie.
C'est dans ces amoncellements de glaise que niche le guêpier : il fait
un trou dans le flanc de la butte, trou qui pénètre au moins à un mètre dans le
monticule, et c'est là qu'il élève sa jeune famille. — Certains de ces côms,
comme on les nomme dans le pays, sont criblés de millions de ces trous : le
grand côm de Sandaleh en est percé à jour, à toutes les hauteurs, à portée de
la main comme dans les endroits les plus inaccessibles.
Le fellah est tellement apathique que jamais il n'en a déniché un seul ;
aussi ces charmants oiseaux sont-ils d'une familiarité excessive. Ils passent,
dans cette contrée, à un mètre de l'homme, en chantant et à tout vol.
On rencontre encore des nids de guêpiers dans les berges de certains
canaux peu fréquentés. Ils sont alors disposés en ligne, au-dessus de la
hauteur atteinte par les plus grosses eaux, et leur ouverture est alors
tapissée d'un enduit vert sombre, qui semble fait avec de la salive, de la
glaise et des herbes.
Grâce à ce tempérament particulier du Sémite, qui lui permet de n'être
pas curieux, les animaux sauvages qui vivent dans les contrées de l'Orient ont
une confiance en l'homme qu'ils n'ont pas dans le Nord. — L'oiseau voyageur
doit avoir deux caractères, deux coutumes, deux manières de se comporter, l'une
pour sa station d'été où il niche, et l'autre pour les pays où il hiverne ;
habitudes complètement disparates et contraires : dans l'une c'est le qui-vive
perpétuel, et dans l'autre la confiance outrecuidante. Il paraît que dans
l'extrême Orient, Inde, Chine, etc., cette confiance méritée se continue. Ce
sont les bons pays pour les oiseaux ! c'est là que les corneilles viennent
voler le dîner sur la table ! c'est là que les enfants ne prennent jamais de
nid !
Quelle différence de caractère dans les races !
Une des choses qui rompent la monotonie des longues courses qu'on est
obligé de faire dans la Basse-Égypte pour se transporter d'un village à un
autre, est certainement le spectacle de la familiarité de ces animaux. — Celui
qu'on risque d'écraser à chaque pas, c'est l'alouette huppée. Elle ne veut
franchement pas se lever !.... A un mètre du pied du cheval elle se décide
cependant, paresseusement, en poussant ses petits cris joyeux ; va à vingt pas
delà, pour se laisser réapprocher et repartir de nouveau.
Après celui-ci, il y a nos jolis guêpiers, au plumage métallique vert et
or, qui attendent le passant par bandes de huit ou dix individus, perchés sur
les grandes graminées qui bordent le chemin, et le saluent de leur grouit
grouit sonore et doux ; puis, à portée de cravache, s'élancent avec
agilité, traînant après eux les deux longs brins de leur queue.
Plus loin ce sont ces cocasseries de huppes, très occupées à retourner
une immondice pour trouver des carabes dont elles sont très friandes :
celles-là ont trop de besogne pour s'occuper des passants ; on les pourrait
prendre avec la main. Enfin, pour celui qui a des yeux, il y a un spectacle
continuel ; tantôt c'est le faucon qui plonge dans le champ, le milan qui fend
les airs, se dirigeant avec sa longue queue fourchue, la corneille mantelée
perchée sur un arbre solitaire et surveillant son nid, le couhiey blak
parcourant de son vol élégant les champs interminables de bersim. — Et enfin,
comme bouquet, de temps en temps à l'horizon, quelque immense vol de vautours,
descendant des confins du ciel jusqu'à la terre, avec cet aspect de trombe
mouvante, qui toujours vous fait faire quelques kilomètres pour aller voir ce
qui se passe là-bas.
Quant à moi je m'y laisse toujours
prendre.
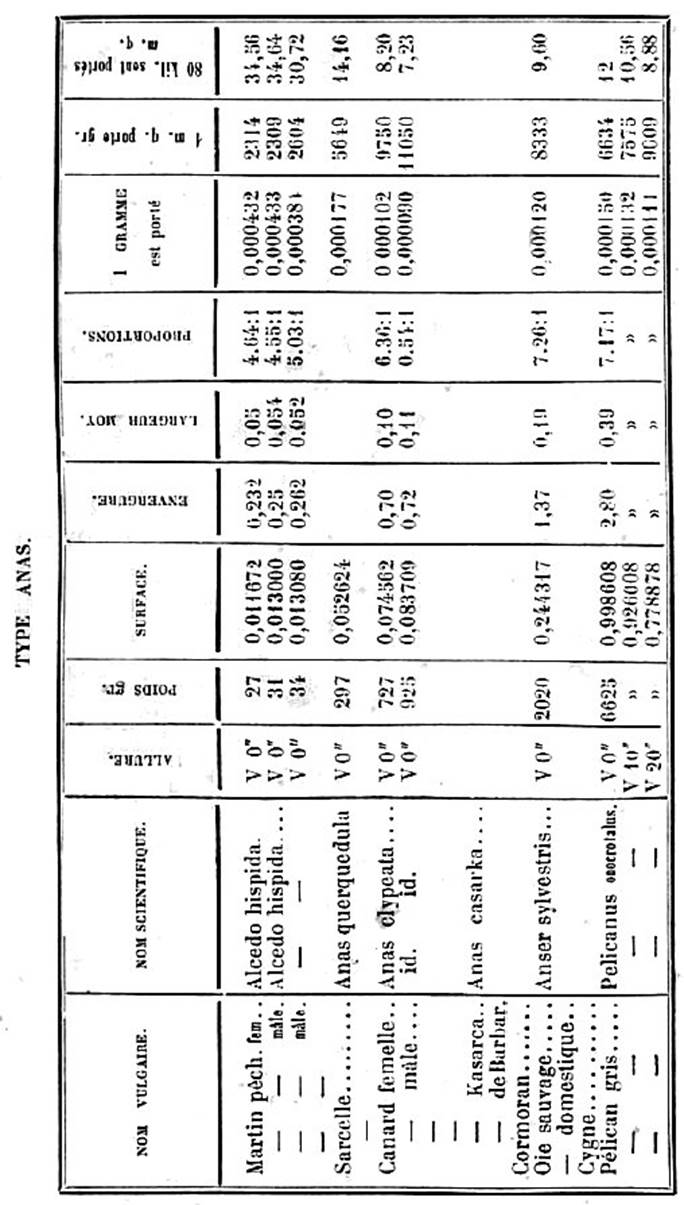
SARCELLES ET
CANARDS
Ces oiseaux sont les représentants de la rapidité dans le vol.
Ce sont des rameurs excessifs, qui usent leur provision de combustible,
forte couche de graisse huileuse qui recouvre leurs pectoraux.
Voici le type, à étudier pour arriver à l'aviation par les machines à
fonctionnement constant. Là, départ et abordage, tout est pratique ; ces deux
points ont une importance capitale. C'est une étude dont le lecteur trouvera un
aperçu à la fin de cet ouvrage.
Ces oiseaux sont dans le même cas que les scolopax, ils ont de grandes
distances à parcourir pour aller d'un lac à un autre, et comme ils sont sans
armes, la vitesse est leur seule sauvegarde pendant ce trajet. — Elle est
efficace, puisque en route ils ne sont jamais attaqués.
L'aigle, qui est leur grand ennemi, abandonne la poursuite sitôt qu'il
les sent bien lancés.
CORMORAN
C'est un oiseau très bien construit pour être heureux dans l'air, mais
son amour pour le poisson lui
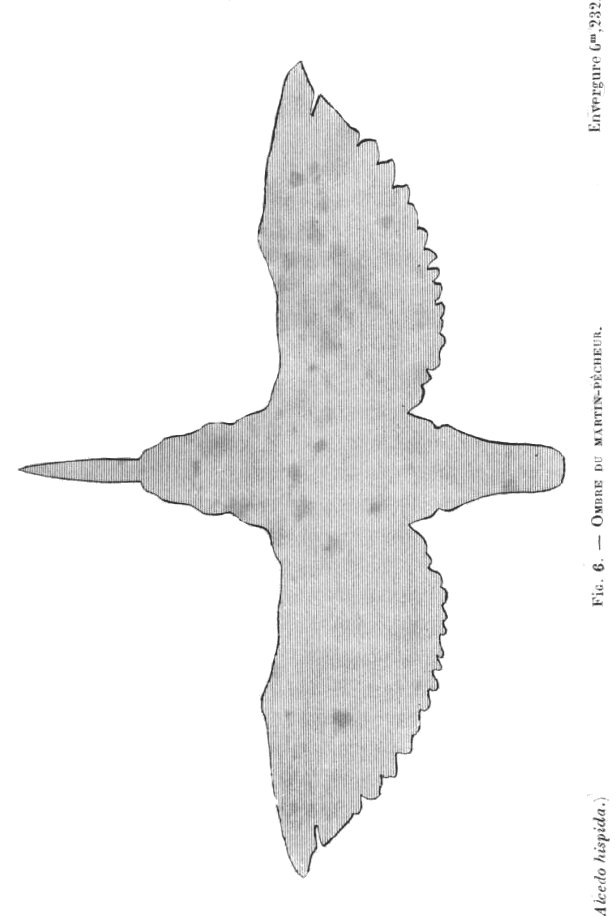
fait négliger les charmes de
l'éther et préférer l'élément aqueux.
Il est assez rare en Europe ; il y en a quelques-uns sur le lac de
Genève, mais ils sont difficiles à étudier parce qu'ils se tiennent au large.
Ceux que l'on voit sur les étangs ou sur les fleuves sont tout à fait des
rencontres du hasard. J'en ai vu énormément sur le haut Nil, mais c'est loin ;
il y en a aussi beaucoup dans les mers de la Chine.
Le point le plus rapproché où on peut le voir à coup sûr est la pointe
sud de la Corse.
Je transcris une note de voyage :
Vu des cormorans dans le détroit de Bonifacio, par une mer parfaitement
calme : le bateau les forçait à se lever.
Le vol qu'ils ont exécuté pour fuir n'a rien d'extraordinaire ; c'est un
battement soutenu et assez lent. Ils faisaient ainsi deux ou trois cents mètres
et se posaient sur la mer, on les voyait alors disparaître complètement, la
tête seule dépassait la surface de l'eau.
Je ne sais s'il plane. Il le pourrait, mais j'en doute, en ayant suivi
un à la lunette pendant plusieurs kilomètres, et l'ayant vu ramer constamment.
PÉLICAN
Un philosophe plaisant, un sybarite de la vitesse, posté sur deux vastes
ailes.
Où niche-t-il ? d'où vient-il ? Je
n'en sais rien au juste. Tout ce que je sais, c'est qu'on en voit beaucoup en
Egypte. — Il y en a des bancs sur les terres noyées, sur le Maréotis, sur le
Manzaleh. Il y en a même dans la ville qui sont apprivoisés. J'en ai acheté un
cent sous dans le Mouski. — Toutes les années on en promène au Caire dans les
mois de novembre, décembre et janvier.
Drôle de bête ! J'en ai eu deux pour amis ; c'est plaisant à n'y pas
croire. — Je me retiens, parce que si je commençais à raconter des farces de
pélican, j'en aurais pour longtemps. Que ceux qui veulent rire s'en offrent un,
et n'aient pas peur de son bec qui est très inoffensif, ils auront de la gaieté
pour leur argent.
Laissons le côté humoristique de l'étude de ce charmant animal et
occupons-nous de son vol.
Le pélican présente une particularité de conformation, c'est une
grandeur excessive dans le bras et l'avant-bras. Il est sans queue. Sa
stabilité, l'espace dans lequel peut jouer son centre de gravité, sans être en
rupture d'équilibre, est placé entre les branches de cette grande M, figurée
par son corps et ses ailes étendues. — C'est cette disposition qui lui procure
son équilibre longitudinal, que sa queue rudimentaire ne pourrait lui fournir.
Son vol est magnifique, il est rarement rameur ; sitôt que le vent le
permet il tourne au voilier.
L’effet que produit la masse est toujours surprenant. Dès qu'un oiseau
devient gros, pour peu qu'il ait de la surface il devient voilier ; témoin
celui-ci : il a moins de surface proportionnelle que la sarcelle ; et cependant
quelle antithèse que ces deux vols ! — Chez la sarcelle le gramme est porté par
177 millimètres carrés et chez le pélican par 150 millimètres carrés seulement.
En pleine action il ne tend pas un cou d'un mètre comme les oies, les
cigognes et les cygnes, mais au contraire le replie comme les hérons et pose
mollement la tête sur les épaules ; ce qui lui donne une tournure particulière
qui est gracieuse au possible. Il a alors l'air si à son aise, il paraît si
commodément posé sur ses deux immenses ailes aux angles pittoresques, qu'une
fois lancé il semble parcourir l'espace sans aucune fatigue.
Il est bien certainement de tous les gros oiseaux celui qui a la
silhouette la plus élégante : le grand vautour est raide et semble découpé en
fer-blanc, le cygne et l'oie ont l'air d'être déjà embrochés, l'aigle est
rigide et tout d'une pièce ; le pélican, malgré sa lourdeur si gauche tant
qu'il est à terre, une fois dans le domaine des airs, devient gracieux comme
une mouette. Les dispositions variées qu'il donne à ses ailes, la grande
longueur de ses bras et de ses avant-bras fournissent à chaque instant des
aspects nouveaux que les évolutions des autres oiseaux ne présentent jamais.
Le pélican est dans les oiseaux ce que l'éléphant est dans les
mammifères au point de vue de l'intelligence. Comme lui, une curiosité sans
borne l'attire vers l'homme. Les actions de ce souverain de la création
l'intéressent profondément. L'attention qu'on lui voit mettre à suivre tous les
mouvements est un indice certain de sa haute intelligence.
Il n'ira pas faire comme les grands rapaces une bouderie sombre qui
commencera avec sa captivité et finira à sa mort ; il n'ira pas se blottir dans
un coin, ou s'immobiliser dans les regrets sans fin de sa liberté perdue ;
point du tout : au bout de deux ou trois jours, si, sans le regarder, sans
paraître s'inquiéter de lui, vous êtes occupé à quelque chose, il ne se passera
pas une demi-heure qu'il ne soit dans vos jambes pour mieux étudier vos
actions. — De temps en temps, il allongera bien encore quelque effrayant coup
de bec, mais il n'y a pas à trop y prendre garde : il n'y a qu'à ne pas retirer
la main, parce qu'on pourrait se couper en se frottant aux scies de ses
mandibules. —Quand il remarquera qu’on ne lui riposte pas, il deviendra alors
d'une familiarité presque importune : il entrera dans la maison comme chez lui,
cherchera les puces aux chiens, volera un soulier, escamotera sans en avoir
l'air une bille sur le billard ; et ne cessera même pas ses polissonneries à la
nuit, car si on le laisse faire, il fera la veillée comme un bipède humain.
Au jardin, il ne faut pas songer à le faire fraterniser avec la
basse-cour, il a un mépris profond pour ces volatiles impotents du cerveau ; il
ne quittera
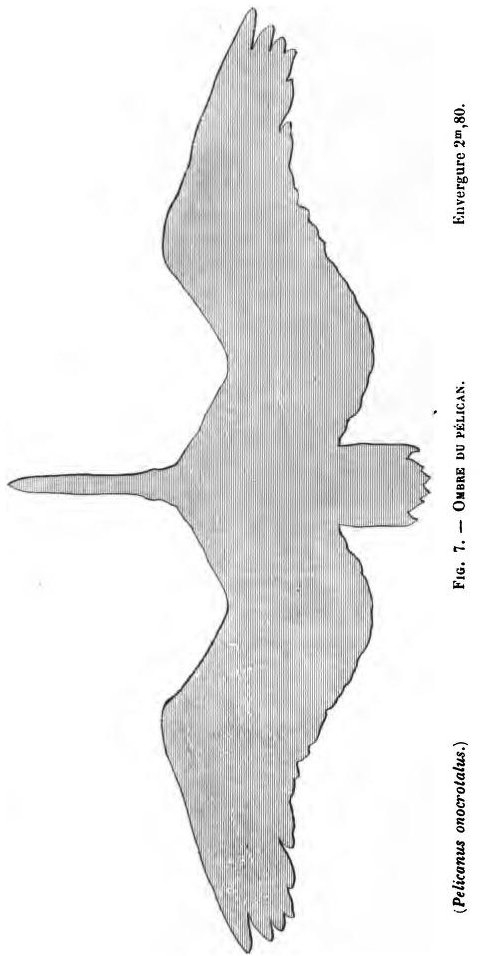
pas le voisinage du point de
réunion, se couchera en boule au milieu du groupe, mettra son bec sur le dos,
et de ce poste bien choisi, de son œil intelligent, suivra tous les gestes et
toutes les paroles.
Il s'impose le compagnon de l’homme ; il décide qu'il fera de lui sa
société ; et, comme il est peu gênant, comme loin d'être répugnant il est au
contraire propre et magnifique, l'homme se laisse faire et devient son ami.
Il y aurait encore à parler du pélican qui a toutes ses ailes, qui peut
voler ; car jusqu'ici il n'a été question que du mutilé : mais alors ce serait
sans fin. J'ajouterai seulement ceci, c'est que sa familiarité croit avec ses
ailes. — Jugez alors de ce qu'il est quand ses plumes sont au complet.
Il serait peut-être possible de l'avoir en Europe en pleine liberté. Il
se trouverait tellement dépaysé qu'il n'essaierait pas de se sauver. Si on lui
laissait pousser les ailes, ses premiers essais de vol ne lui permettraient pas
de songer à faire un long voyage ; tout au plus la première année visiterait-il
la contrée environnante. En ayant soin de le tenir captif dans le mois de
septembre, époque des migrations, on pourrait, dans un pays où les chasseurs
seraient prévenus, se procurer le spectacle très curieux des évolutions de ces
énormes oiseaux d'eau, qui sont aussi gentils que les cygnes sont bêtes et
méchants.
CYGNE
Il y a deux points où l'élude du cygne est facile à faire : Genève et
Londres. — La Tamise avec son atmosphère brumeuse ne permet pas de les suivre
bien loin. Au reste, ils ont l'air bien malheureux sur cette eau fangeuse.
Pour les voir tout à son aise, il n'y a qu'un endroit, c'est le lac de
Genève. — Là ces beaux oiseaux sont chez eux et sont les vrais propriétaires du
lac.
Ils nichent dans les fossés de la ville, et vont mendier, c'est quêter
qu'il faudrait dire, des morceaux de pain jusqu'à Villeneuve. — Ils font même
plus fort, ils suivent les bateaux à vapeur, se posent pour chercher ce qu'on
leur a jeté par-dessus le bord ; puis, lorsqu'ils sont en retard de deux ou
trois kilomètres, ils reprennent leur vol, atteignent le navire et se reposent
dans le sillage.
Leur vol est un mélange de battements de peu d'amplitude et de planement
rectiligne. Ils ne tournent pas comme les pélicans ou les oiseaux de proie ;
c'est toujours en ligne droite qu'ils se dirigent, comme les canards, les oies,
et tous les oiseaux qui ont peu de surface à leur disposition.
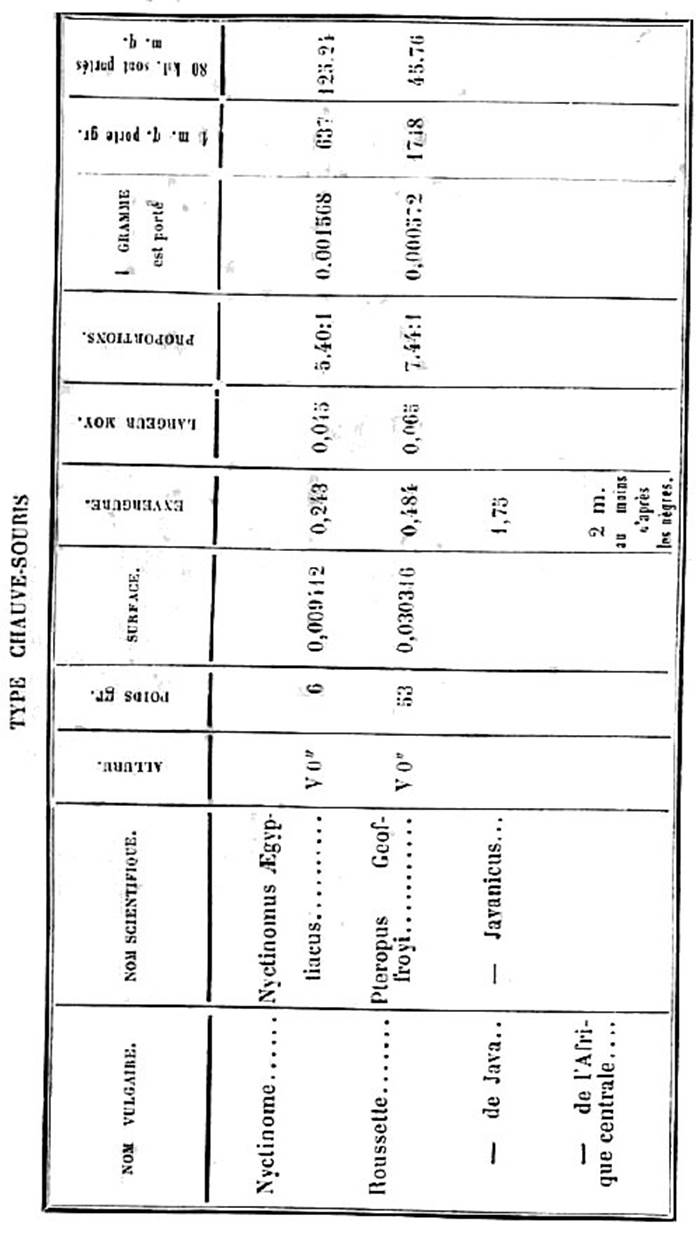
CHAUVES-SOURIS
Quand ou regarde avec attention une de ces grandes chauves-souris, on
est porté à faire de curieuses réflexions. — Ce n'est nullement un oiseau, mais
bien un mammifère ; et même on peut dire que c'est tout à fait un être
supérieur. — Les roussettes ont un faux air d'anthropoïde qui leur attire plus
d'un regard de la part de l'observateur attentif ; elles représentent
passablement la charge d'un homme ailé. — Quand nous étudions les oiseaux, il
reste dans notre entendement, par rapport à leurs facultés, un voile formé par
l'énorme distance qui les sépare de nous dans l'échelle de la création ; mais,
pour ce mammifère, la proximité est trop précise pour nous permettre aucune
illusion : nous l'analysons de sang-froid, et nous reconnaissons en lui notre
précurseur.
Les petites espèces sont insectivores, leur vol est celui d'un rameur
parfait, pouvant joindre à cette qualité la faculté qu'ont les chouettes et les
autours de pouvoir changer très rapidement de direction : il le faut au reste
pour pouvoir vivre d'insectes. Pour parvenir à produire ces crochets, qui sont
le point remarquable de leur allure, elles se servent de la déviation du plan
des ailes et de la direction que peut donner une voile comme gouvernail mue par
les pattes de derrière et un appendice caudal ordinairement très vigoureux.
Les roussettes d'Égypte, qui ont jusqu'à 60 centimètres d'envergure et
pèsent souvent plus de 100 grammes quand elles sont grosses, n'ont déjà plus la
même tournure dans l'air que les petites chauves-souris de l'Europe ; le poids
donne la fixité dans la direction, ce qui fait que dans les pays où elles sont
nombreuses, on les confond la nuit avec les chouettes, dont elles ont la taille
et le vol.
Elles sont frugivores, tant qu'elles peuvent l'être, c 'est-à-dire tant
qu'il y a des fruits ; mais, comme ils ne sont pas abondants dans la vallée du
Nil, et qu'il y a de nombreux mois où il n'y en a aucun, qu'avec cela elles
sont très nombreuses, il faut donc qu'elles puissent se nourrir d'autre chose.
— Aussi chassent-elles assidûment les insectes sur les canaux et les moineaux
dans les arbres. — On met toutes leurs rapines sur le compte des scops qui sont
nombreux aussi ; mais elles ont sur la conscience une bonne part de ces
assassinats nocturnes. Cependant, sitôt que les fruits reparaissent, elles
retournent à leur alimentation végétale.
Ce goût très prononcé qu’elles ont pour les figues du sycomore, les
raisins, etc., est en Egypte un écueil sérieux pour ces cultures : on est
obligé, pour conserver les fruits, d'entourer les arbres, les treilles, les
tonnelles, de filets, sans cela il ne resterait rien. Qu'on juge des dépenses
qu'occasionne cet animal.
Elles nichent partout où il y a de l'ombre, dans les cavernes de la
montagne, dans les ruines, en ville même quand l’emplacement leur semble
convenable. — On a démoli au Caire, il y a quelques années, un vieil hôpital,
qui était traversé par une rue couverte. Il y en avait des milliers là-dessous.
A certaines heures le soleil éclairait assez cet affreux passage pour pouvoir
les distinguer : on pouvait alors suivre leurs batailles constantes ; leurs
cris attiraient les regards, et leur odeur nauséabonde empuantait ce hideux
cloaque.
Au vol, on ne les entend jamais pousser de cris. Quand elles passent à
quelques mètres de distance, on entend le bruit que font leurs ailes, qui
ressemble assez à celui qui est produit par le vanneau en volant. — Elles se
groupent quelquefois au vol en masse serrée, formant une boule qui
tourbillonne. : c'est ordinairement pour dévaliser un sycomore qu'elles se
réunissent ainsi ; un coup de fusil dans cette masse en jette parfois des
dizaines à terre.
En captivité dans une grande chambre, la roussette vit facilement ; elle
a alors comme les rapaces nocturnes la faculté de se mouvoir avec facilité dans
ce local étroit, où un oiseau de jour, de même taille, ne sait se retourner.
Elle s'apprivoise assez pour reconnaître son maître, et semble douée d'une
intelligence assez développée.
Chaque pays, chaque grande île a ses variétés particulières : l'Amérique
a, dans les grandes espèces, des carnivores et des insectivores, et l'ancien
continent des frugivores. C'est seulement parmi ces dernières que nous pouvons
trouver des sujets qui, par leur masse et l'envergure qu'ils possèdent, peuvent
nous intéresser. On assure qu'il y a dans les îles de la Sonde des roussettes
qui ont 2m,50 d'envergure. Cet animal, l’Acerodon Meyerii, de la taille
d'un vautour, vaut assurément, à lui seul, le voyage. Que de choses
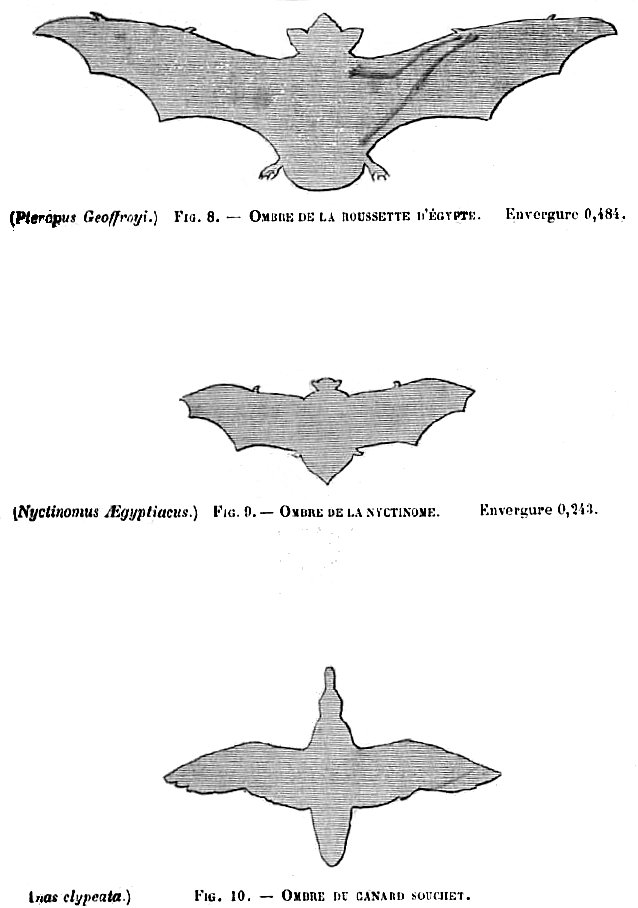
il
y aurait à apprendre, non seulement sur le genre de vol, mais encore sur la
construction, sur la manière d'être de ces longs doigts qui forment rémiges, et
sur l'effet produit, pendant l'action, par la pression sur ces tissus
élastiques.
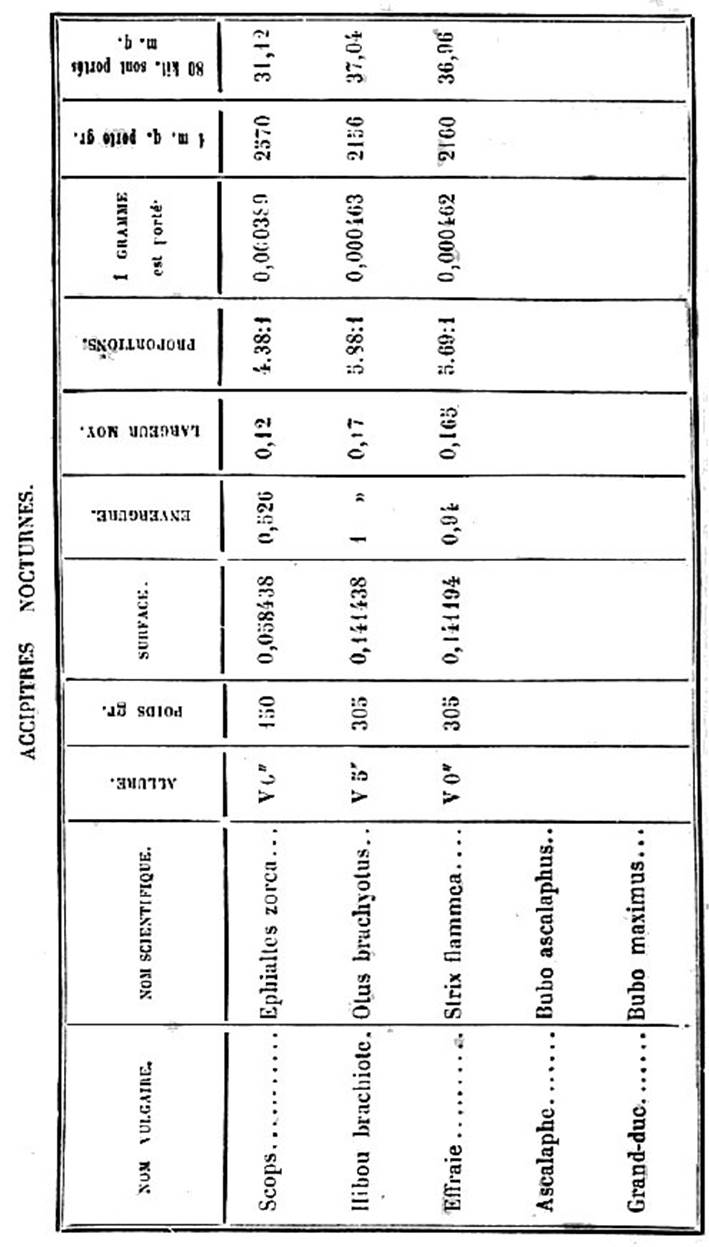
ACCIPITRES NOCTURNES
Les rapaces de nuit sont
certainement les oiseaux chez lesquels les facultés qui permettent la chasse
sont les plus perfectionnées. Les yeux sont des merveilles. Chez le duc, la
pupille est tellement contractile, que quand, dans certain éclairage particulier,
on passe la main entre son œil et le jour, cette variation d'intensité de
lumière se traduit instantanément par un élargissement et un rétrécissement du
simple au double du diamètre. Les serres sont au moins aussi puissantes que
celles de leurs collègues de jour. Quant au vol, il est généralement
remarquable, surtout chez les grandes espèces.
Dans cette famille, les aptitudes au vol, comme nous le comprenons, sont
rigoureusement en proportion de leurs poids ; un seul parmi eux fait exception,
c'est l'effraie (Stryx flammea), qui sort de cette gamme par une
exagération de surface et d'envergure. Comme cet oiseau ne pèse que 300
grammes, sa masse n'est pas assez considérable pour lui permettre de bénéficier
de ses qualités. — Attachons-nous de suite à celui que son poids rend
intéressant.
GRAND-DUC (Bubo
maximus)
C'est un curieux animal que le grand-duc, un pinceau vaudrait mieux
qu'une plume pour en donner une idée exacte. — Ces oreilles cornues, ces grands
yeux jaunes, ce plumage constellé de croix et de larmes, le bruit qu'il fait
avec son bec, qui ressemble à s'y méprendre à celui que produit un os qu'on
brise ; tout, jusqu'à ses poses, lui donne un air satanique qui est peu de ce
monde. Laissons de côté cet aspect infernal et examinons-le au grand jour.
C'est un énorme oiseau de proie, ses griffes sont robustes, ses ailes
puissantes ; son bec, presque entièrement caché sous les plumes poilues qui lui
préservent les narines, est cependant vigoureux, et possède une force qui
manque totalement au bec de la plupart des oiseaux de proie diurnes. Ses
oreilles sont vastes : on voit à première vue, à l'énorme développement de cet
organe, que le sens de l'ouïe doit être d'une grande perfection.
Cet ensemble de brillantes qualités, joint à un courage extravagant,
font de cet oiseau un animal extraordinaire de puissance.
Le grand-duc pourrait certainement disputer à l'aigle le sceptre des
airs. L'aigle est comme le lion, il a la prestance de la royauté, tandis que le
tigre, qui n'a
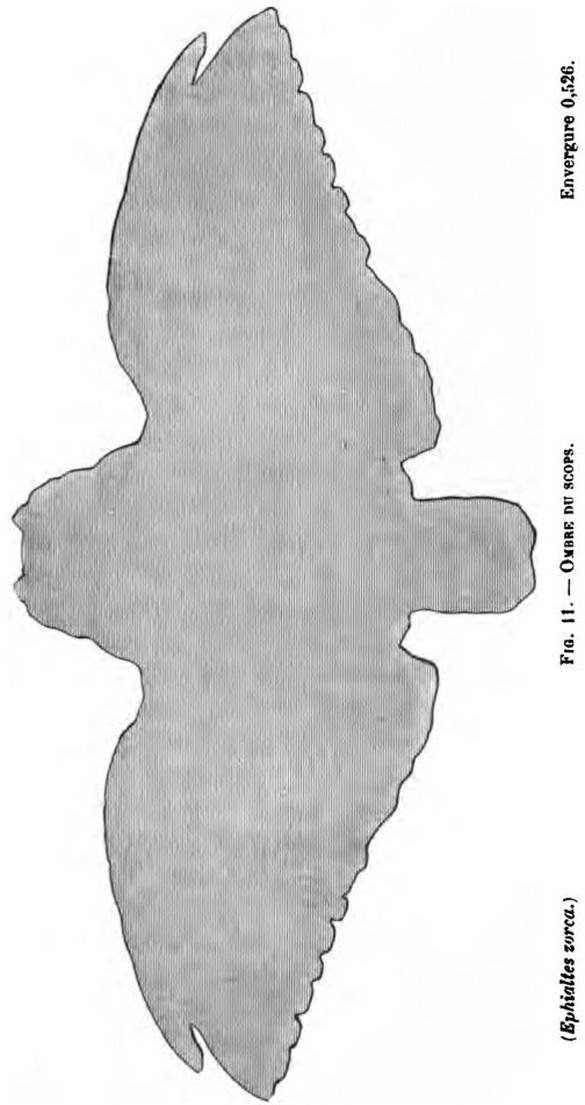
qu'une brillante réputation de
férocité, lui disputerait sa proie certainement avec succès s'ils se trouvaient
tous deux sur le même territoire de chasse.
Examinons donc encore mieux cet oiseau, nous sommes en face d'un être
considérable.
Sa charpente osseuse est robuste, ses plumes sont comme celles de tous
les oiseaux nocturnes, c'est-à dire d'une douceur de velours ; mais ce duvet si
doux recouvre des muscles d'un autre ordre d'action que ceux de l'aigle : ils
ont moins de longueur, sont plus brefs et plus rigides dans leurs contractions
; les bras de levier sont plus longs.
Le vol est une merveille : il est excessivement compliqué. Il plane très
bien, quoique rarement ; il rame comme un pigeon, et a par-dessus tout le
talent de s'arrêter brusquement au plus fort de sa vitesse et de prendre une
autre direction, pour pouvoir éviter les chocs qui lui arriveraient à chaque
instant contre les troncs d'arbres.
Ce vol est absolument silencieux. On voit passer ces énormes bêtes sous
le feuillage sans entendre le moindre murmure. Ce silence est obtenu par la
conformation de ses plumes qui ne sont pas construites comme celles des oiseaux
de jour. Chez lui, le choc des canons entre eux est garanti par un duvet
excessivement moelleux.
On ne les voit haut en l'air que quelquefois à l'aurore, au printemps ;
ils tournent alors très haut, par paire ; puis, quand le jour devient trop
fort, ils redescendent rapidement dans leurs antres ténébreux où ils restent
blottis jusqu'au coucher du soleil.
J'ai assisté un soir au départ de deux grands-ducs. J’étais monté avec
un jeune guide à une caverne très élevée ; nous avions au-dessous de nous les
forêts de sapins. Le jour était sur son déclin. Nous nous étions abrités
derrière une forte assise de pierre qui nous cachait parfaitement, et là nous
attendîmes.
Cinq minutes après le coucher du soleil un grand-duc se trouva, comme
par enchantement, posé sur un rocher en face de la caverne. Nous ne l'avions ni
vu ni entendu venir. Quelques instants après, un second oiseau apparut plus
grand et plus gros que le premier ; c'était la femelle, elle était énorme ; sa
taille était au moins de 80 centimètres. Ils tournèrent lentement de côté et
d'autre leurs faces cornues ; puis, l'un d'eux jeta aux échos de la vallée
trois notes puissantes, mais harmonieuses à la façon de la mélodie des
chats-huants.
Cette voix est étrange et impressionne fortement.
Peu après le mâle descendit à un ruisseau qui coulait des glaciers ; la
femelle le suivit ; ils burent, se baignèrent légèrement la figure, puis
remontèrent sur le rocher où ils étaient primitivement. — Là ils s'essuyèrent,
lissèrent leurs plumes, et se mirent à danser.
On m'avait annoncé ce spectacle dans des termes tellement excessifs que
je n'y avais pas cru ; mais je vis là la scène la plus grotesque qu'on puisse
imaginer :
Qu'on se figure deux énormes bêtes, peu élégantes, sautant en l'air
alternativement comme des marionnettes, faisant claquer leurs becs en guise
d'accompagnement.
A cette vue un fou rire me prit ; le berger me posa la main sur le bras
pour m'engager au silence. — Je regardai les oiseaux, ils n'y étaient plus, le
rocher était nu ; ils étaient partis mystérieusement comme ils étaient venus.
Je visitai leur aire, il y avait deux ou trois cents kilogrammes d 'os
de lièvre, de bouts d'ailes de perdrix et de boulettes de poils qu'ils
rejettent de leur estomac.
J'ai eu un couple de ces oiseaux en captivité, les petits de ceux dont
je viens de parler. L'année suivante, le petit berger les dénicha, et vint me
les offrir.
Ces oiseaux, malgré leur envergure de près de deux mètres, volaient
parfaitement dans une cage de 12 mètres sur 5 ; ils allaient, venaient,
faisaient plusieurs tours entiers sans se poser, tandis que les grands rapaces
diurnes, dans le même local, se bornaient à en franchir lourdement la longueur
en trois bruyants battements d'ailes.
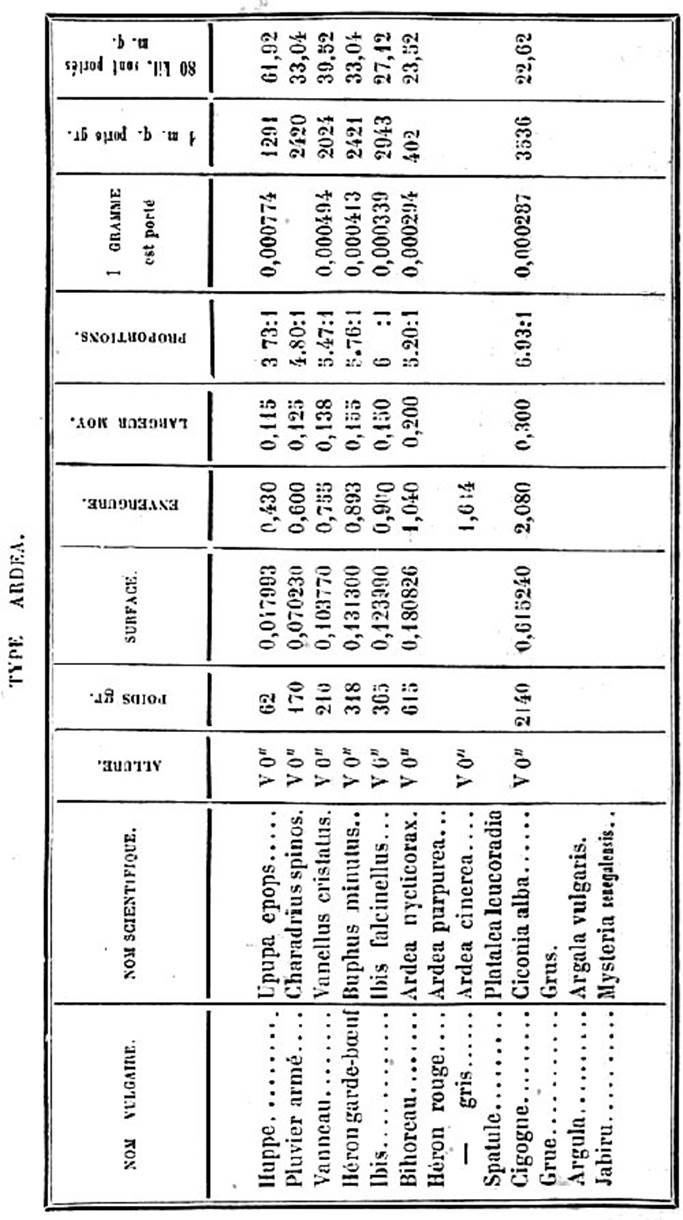
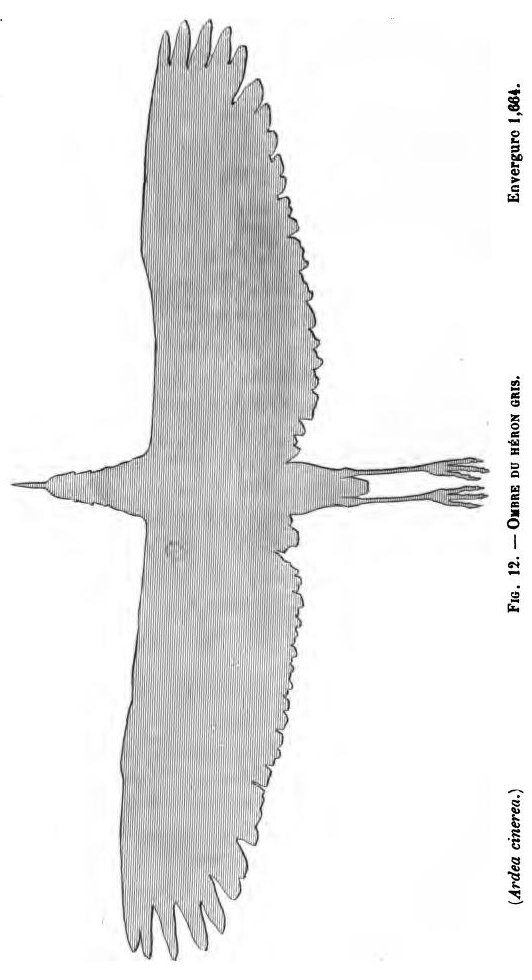
TYPE ARDEA
Ce tableau renferme des oiseaux qui possèdent une surface
proportionnelle très grande par rapport à leur poids.
Quel est le but de la nature en les dotant de cet excès de bien ? —
Probablement de leur offrir la faculté de bien voler dans le temps calme, et
surtout de pouvoir se poser sans se briser les jambes. Ce qu'il y a de positif,
c'est qu'ils sont gênés dans leurs mouvements par ce surcroît d'ampleur dans la
voilure ; aucun d'eux n'est un volateur remarquable, ni comme vitesse, ce qui
est facile à comprendre, ni même comme station dans l'air, ce qui est plus
extraordinaire.
Ce sont en somme des voiliers tellement exagérés, que chez eux le
traînement détruit toutes les autres qualités. — Il n'y a que quand le poids
arrive à deux kilogrammes, que la masse parvient à atténuer le frottement de
l'air contre ces ailes extra-emplumées.
Les premiers oiseaux de ce tableau ont tous un vol de papillon ; la
huppe, le pluvier armé et le vanneau, n'avancent contre les grands vents qu'en
ployant complètement les ailes. Ces défauts s'atténuent à mesure que le poids
augmente. L'ibis vole déjà mieux que le garde-bœuf, et tous sont distancés par
les cigognes.
Nous trouvons dans ce type la preuve que la surface utile, active, de
l'aile, est dans la main et l'avant-bras, et que celle du bras est presque sans
action. — La démonstration est brutale comme celle que donne la nature. — Elle
a supprimé tout simplement les plumes de l'humérus à la plupart des hérons, et
ne leur a laissé que celles de la couverture, qui ne sont qu'un pur ornement.
CIGOGNE
C'est cet animal qu'on devrait acclimater en France ! car, hélas, nous
n'en avons plus sur le sol français : celui-ci serait réellement utile et ne
coûterait absolument rien. — Puis, c'est joli, gracieux, assez familier pour
avoir beaucoup de charmes, et assez sauvage pour n'être pas importun. Ce serait
si facile à faire : quelques jeunes élevés dans une localité, un arrêté du
préfet les protégeant, arrêté auquel on ne demanderait qu'à se soumettre.
Une fois fixées, quand elles auront niché dans une contrée, on peut
répondre de leur vie ; leurs mœurs sont si douces, leurs charmes si grands,
qu'elles auront pour défenseurs la commune tout entière.
Quand on voit l'Arabe qui n'aime rien que l'argent se prendre d'amitié pour
elle, il faut que réellement elle ait de bien grandes qualités.
Dans tous les pays bas elle serait un bienfait, car sa nourriture se
compose uniquement de serpents, de crapauds et d'insectes.
En somme elle ne fait que du bien : aussi est-elle chérie des
populations auxquelles elle a confié son nid. —Demandez aux Alsaciens ce qu'ils
en pensent, aux étudiants de Tubingue, aux Belges, aux Arabes, aux nègres même
: tous, ceux du sommet de l'échelle humaine comme ceux des derniers échelons,
ne tariront pas sur ses vertus.
Donc, il faut à la France des cigognes, pour animer ses campagnes, pour
lui porter bonheur, parce que réellement elle a ce don : il y a unanimité de
croyance sur ce point ; puis, parce que c'est un magnifique modèle d'aviation,
facile à étudier puisqu'il est presque domestique.
Il était à croire que de l'Allemagne ou des pays flamands nous
viendraient des études sur la direction aérienne ; ces gens ont un modèle
constamment sous les yeux, et un bon modèle : il y a mieux, c'est vrai ; mais
le vol de la cigogne est infiniment plus facile à analyser et à comprendre que
celui des oiseaux qu'on a sous les yeux en France, qui sont des pigeons, des
moineaux, des hirondelles, et de loin en loin quelque malheureuse buse qu'on
aperçoit quelques instants au détour d'un bois. — La cigogne au contraire
s'établit en pleine ville, sur le point culminant, afin que nul n'en ignore ;
elle crève les yeux, il faut la voir forcément, à moins d'être manifestement
aveugle. Sans quitter son bureau, on peut faire des études. — De temps en
temps, de crainte d'être oubliée, elle ravive l'attention par un roulement de
coups de bec qui est tout à fait une réclame.
Et cependant ils n'ont pas compris !
La parole de l'Écriture qui dit : « Ils ont des yeux pour ne point voir,
» est pleine de justesse.
Cet échassier est franchement un gros oiseau ; 2 kilogrammes de poids,
et ordinairement dépassés, constituent une masse capable de bien utiliser la
force du vent.
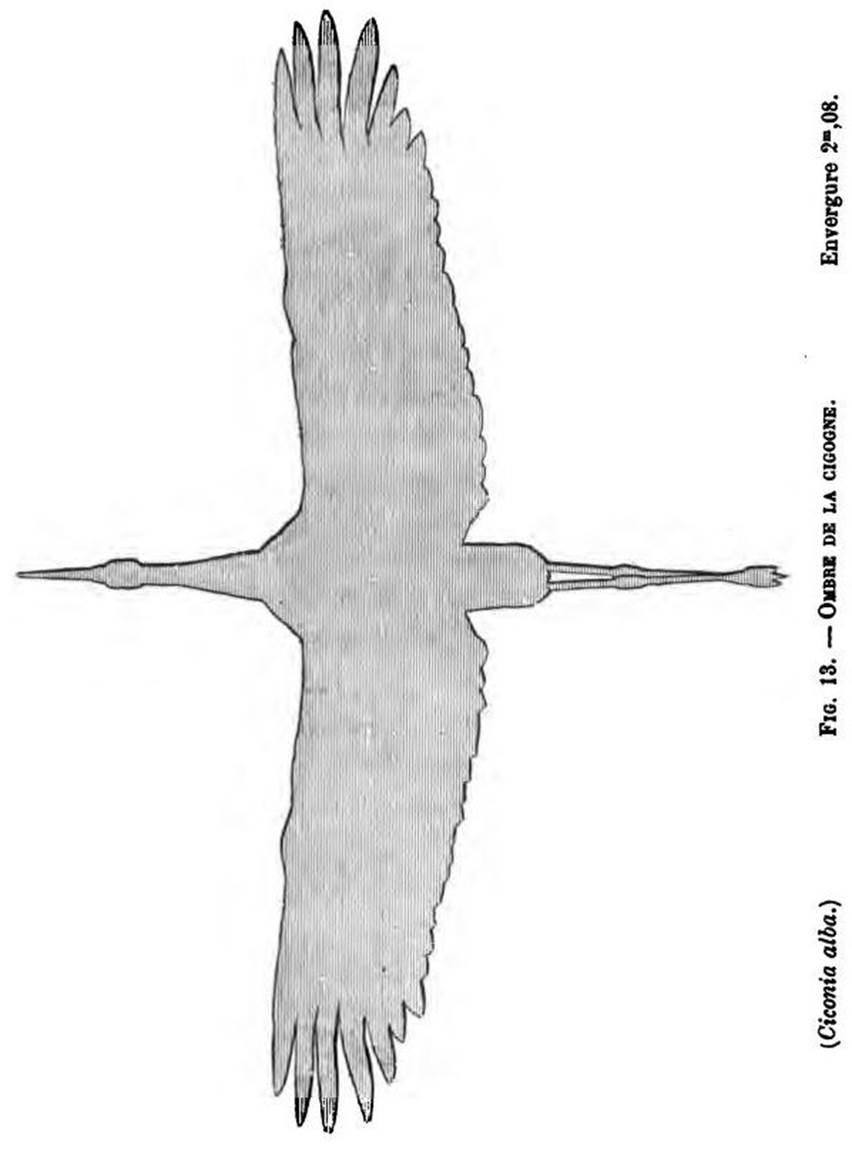
Son vol est tout à fait le planement aussi continu que l'état de
l'atmosphère le permet ; ses ailes sont alors parfaitement rectilignes. Quand
elle aborde la terre, elle prend alors la tournure arquée.
Par le temps calme, elle donne trois coups d’ailes et fait une glissade.
Dans certains cas elle a une particularité dans l'allure qui la fait
reconnaitre de très loin : c'est l'habitude de s'incliner beaucoup plus que les
autres oiseaux lorsqu'elle décrit des ronds pour monter. Cette inclinaison
semble dépasser la position utile pour résister à la force centrifuge. Ses
ailes, dans ce cas, font facilement avec l'horizon un angle de 45 degrés.
Quant aux grandes cigognes carnivores qu'on voit en pays nègre, leur
masse devient telle qu'elle compense tous leurs défauts. Leur vol arrive à
beaucoup ressembler à celui des meilleurs voiliers. Sauf les pattes et le cou,
c'est à les confondre de loin avec les vautours.
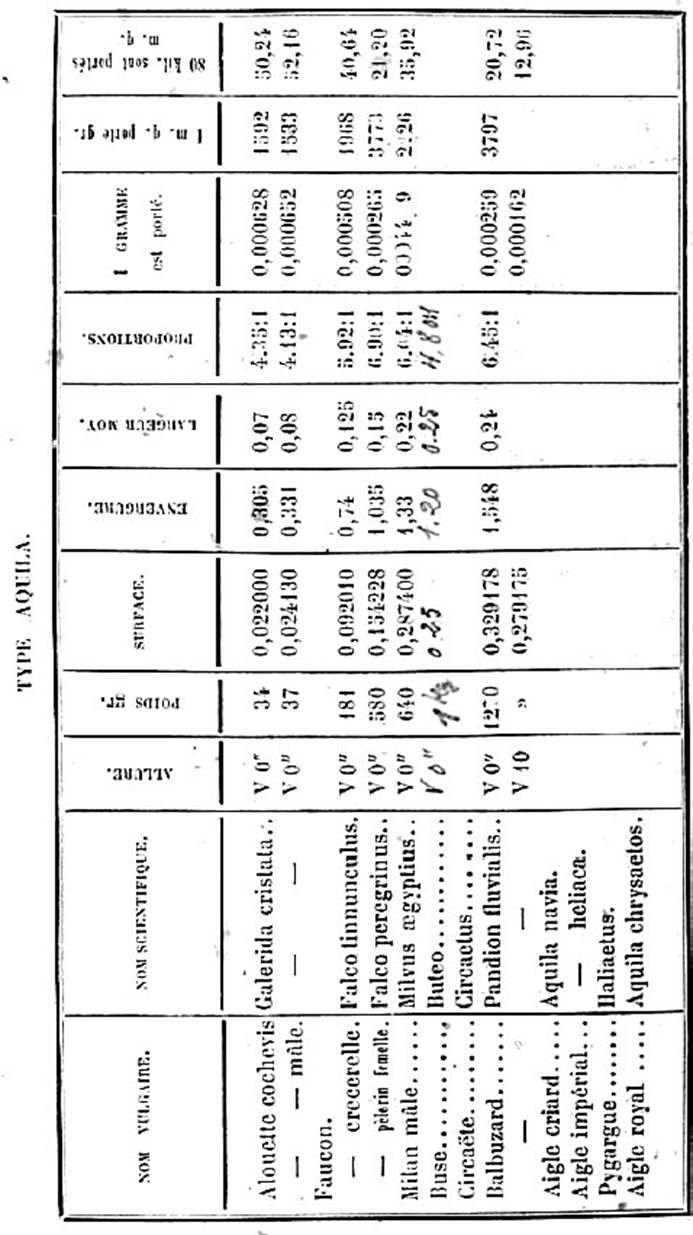
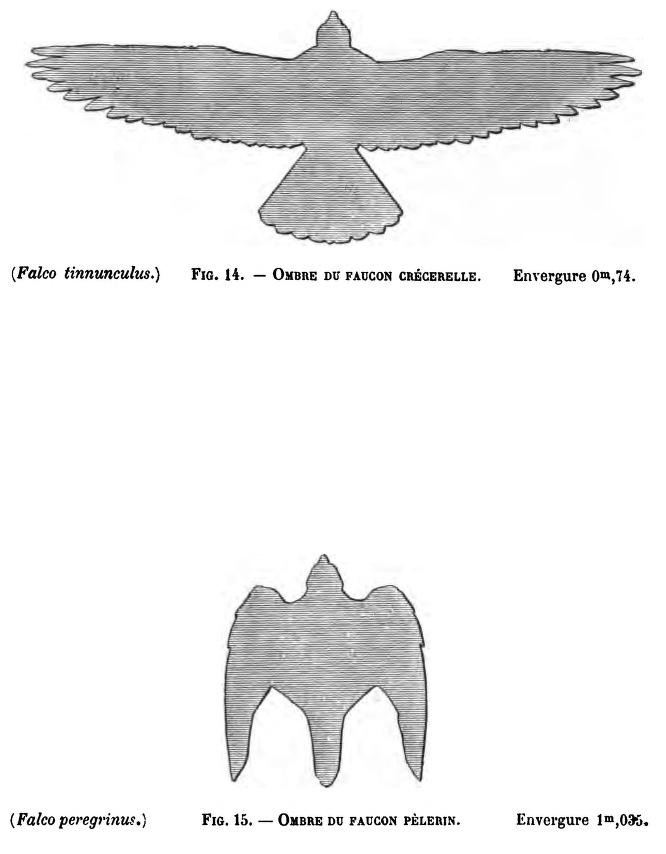
TYPE AQUILA
Beaucoup de science, mais trop de force, telles sont les qualités de ce
groupe, étudiées à notre point de vue. Par moment ce sont des modèles
remarquables, et à d'autres instants, quand ils se servent de leur puissance
qui est très grande, ils n'ont plus rien d'intéressant pour nous qui étudions
le vol sans battement.
ALOUETTE (Alauda)
Cet oiseau est en tête du groupe des accipitres diurnes parce que sa
conformation et son vol l'y placent forcément. Elle est exactement un faucon
comme tournure, ou pour mieux dire a parfaitement en petit l'aspect d'un aigle.
FAUCON CRÉCERELLE
La crécerelle est commune en France, elle habite nos grandes villes ;
tous les observateurs la connaissent et font assurément sur cet oiseau leurs
meilleures remarques. — Sa puissance est grande, elle rame toujours en chassant
; mais, quand le temps change, quand le vent du sud cherche à s'établir, elle
monte très haut en planant, et développe alors ses talents de voilier, qui sont
aussi complets que sa masse permet de le supposer.
FAUCON PÈLERIN
Oiseau rare, par cela même difficile à étudier. Rameur étonnant,
parvenant par instants à une vitesse qui semble unique : le pigeon, le canard
sont distancés de beaucoup.
Il m'en passa un jour un à 10 mètres à cette vitesse ; je ne le voyais
pas venir : je crus que c'était un boulet.
Cette énorme vélocité est produite par la puissance du coup de fouet,
dans lequel la force est uniquement employée à lancer l'animal en avant ; sa
sustention étant fournie par la vitesse et la direction imprimée.
Il plane bien, seulement quand il a le temps. Son poids est 600 grammes,
et sa surface de 16 décimètres carrés.
BUSE
La buse est très connue de nos chasseurs français. On la voit
ordinairement passer en ramant lourdement, puis faire 50 mètres en planant.
C'est en somme un assez piètre modèle. — Quelquefois, au printemps, elles
remontent par paire assez haut en tournant ; mais elles sont sobres de cet
exercice. Il faut les avoir constamment sous les yeux pour pouvoir en faire une
étude fructueuse.
MILAN
Le milan est bien plus intéressant, ses ailes sont bien plus longues, sa
queue plus vaste. C'est aussi le planeur par excellence pour exécuter les
difficultés. Sa queue fourchue très puissante est toujours en mouvement. Il
faut qu'il voie tout, étudie tout ; les moindres accidents de terrain sont vus
: et, pour exercer ce métier-là, il faut énormément d'adresse. Aussi son vol
est-il aussi varié que l'exige la nature du sol sur lequel il chasse.
C'est, malgré de nombreux coups d'ailes, un spécimen rare de la
perfection du vol des voiliers.
MILAN DU CAIRE (Milvus
ægyptius)
Cet oiseau, assez rare en Europe, est commun en Afrique, surtout en
Égypte. On l'aperçoit à Tunis, en Algérie, en Asie Mineure, isolément dans la
campagne ; il suit ordinairement les percnoptères, et mène la même vie qu'eux.
— En Egypte, et surtout au Caire, il habite la ville à résidence fixe ; a
ordinairement un minaret ou une corniche de mosquée comme perchoir de jour, et
couche sur les grands arbres qui croissent dans les cours des maisons.
Ils vivent par paire, se quittent rarement, sont presque toujours en vue
l'un de l'autre, soit en chasse, soit au repos. — Le vol de cet oiseau est
exactement celui du milan royal. Il rame presque autant qu'il plane, quoique
ses grandes ailes puissent le dispenser de se donner tant de mouvement. — Il
passe sa vie à vérifier toutes les terrasses et il enlever les débris de viande
qu'il aperçoit. Il le fait en plongeant et enlevant sa proie au vol d'un coup
de serres. Si son butin n'est pas trop gros, il le mange très souvent sans se
reposer. Quand cet acte se fait par un fort vent, il donne le spectacle du vol
inconscient : l'oiseau est tellement occupé qu'il va presque où le vent le
pousse.
Sa hardiesse passe toutes les bornes. Il ose aller partout, même plonger
entre les passants, dans les rues les plus fréquentées. Il n'est pas rare de
lui voir enlever un objet entre les mains des fellahs : il arrive toujours par
derrière, fond sur ce qu'il convoite avec un sang-froid imperturbable, et
l'emporte au grand ébahissement du volé.
Il est le commensal des camps : de peur de n'y pas voire assez, il se
tient à 5 ou 6 mètres seulement en l'air, et fond sur tout ce qui fait ventre,
même souvent dans le plat, au milieu de l'assemblée.
Il a pour concurrent, moins hardi que lui cependant, les corneilles
mantelées, qui sont aussi communes que lui en Egypte. Quand il a une proie,
s'il ne se dépêche pas de la manger, les corneilles lui donnent une poursuite
acharnée, et lui font souvent lâcher prise.
Cet oiseau est inoffensif. Il ne dérobe jamais ni poule ni pigeon ; les
poules, au reste, ne font aucune attention à lui.
Au milieu de la journée il s'élève très haut, et de là se rend aux
abords de la ville, sur le point où la curée lui paraît la plus abondante. Les
abattoirs en sont encombrés ; ils sont là par centaines, perchés sur les murs,
et fondant hardiment entre les bouchers arabes pour venir prendre à tout vol
une bribe de chair.
On ne les gêne guère dans leurs évolutions ; les gens du pays ne
feraient pas un mouvement pour les regarder : il n'y a que les chasseurs
novices qui leur adressent quelques coups de fusil par curiosité. — Aussi leur
hardiesse est sans limite. Je me souviens un jour d'avoir assisté à un curieux
spectacle : mon domestique passait avec une couffe sur la tête, pleine de
provisions : un grand manche de gigot pointait triomphalement
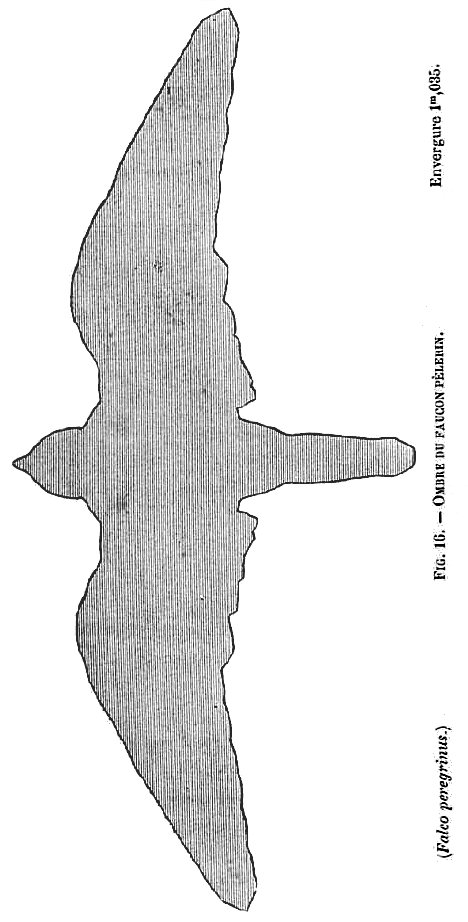
en l'air. Trois milans
s'acharnaient il plonger dessus, et ma femme qui suivait s'escrimait contre eux
à grands coups de parasol. — Comme je n'étais pas parfaitement édifié sur la
valeur de la défense, je fus obligé de me mettre de la partie et de porter
secours à mon pot-au-feu.
AIGLES
Avec le Pandion fluvialis
nous arrivons dans les oiseaux lourds ; nous trouvons encore des battements
nombreux, mais déjà se prononcent les effets de l'inertie qui, arrivée à une
masse de 1 kilogramme, permet une constance dans la direction qui ne se trouve
pas dans les oiseaux du poids de 500 grammes.
Les petits aigles d'Europe, d'Afrique, l'aigle impérial à dos blanc (A.
heliaca), et le grand aigle (A. chrysaêtos), dont les beaux types
se trouvent dans les Alpes, ont tous le même vol. Les qualités comme voiliers
croissent comme leurs poids.
Leurs besoins exigent beaucoup de qualités différentes : d'abord, ils
doivent pouvoir se soutenir facilement pour étudier le terrain, guetter une
proie souvent des heures entières ; il leur faut donc pouvoir bien planer : ce
qu'ils font dans la perfection. — La proie une fois trouvée, il faut, pour
l'attaquer, une grande vitesse, car c'est un canard qu'il faut capturer, et
cela vole vite un canard, ou un lièvre à prendre à la course, ce qui n'est pas
du tout facile. — Pour obtenir cette vitesse, ils emploient la chute ; ils se
laissent tomber de 200 ou 300 mètres de hauteur, et se servent de cette grande
vélocité bien dirigée pour atteindre le gibier. — Ces exercices violents de la
chasse à des animaux à fuite rapide exigent une puis sance
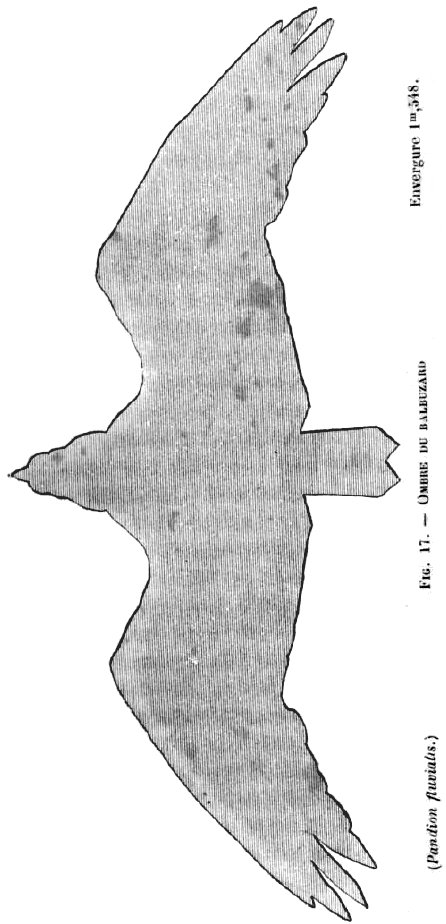
musculaire énorme de la part de ces
oiseaux.
On aperçoit quelques aigles en Savoie, ce sont les beaux, mais ils sont
rares. En Egypte il y en a aussi quelques-uns : de temps en temps on voit
passer un oiseau à tournure insolite ; quand il est loin, on se souvient que
c'est l'aigle. — C'est en Algérie que j’ai pu étudier de très près cet animal. En
hiver il y en avait toujours trois ou quatre à poste fixe à 200 mètres de ma
ferme. Ils chassaient les canards sauvages qui se tenaient sur une prairie
noyée. Quelquefois ils venaient passer une revue de la basse-cour, mais de
loin, parce qu'ils étaient mal reçus. — Ils se tenaient en résumé à la bonne
distance qu'on doit désirer pour ses poulets. — C'est que ce n’est pas long
pour eux que d'enlever une volaille : on entend les coqs crier, puis un
sifflement terrible, et on voit remonter dans les airs une malheureuse pondeuse
qui sème ses plumes au vent pendant cette ascension vertigineuse.
Ce que l'on raconte de l'aigle lâchant sa proie lorsqu'on lui tire un
coup de fusil, même hors de portée, est parfaitement exact : mais seulement, là
comme dans tout, il faut savoir prendre son temps. Je fis expérimenter le fait
à un chasseur qui en doutait : il se pressa tellement que l'aigle n'avait pas
eu le temps de tuer le canard lorsqu'il le lâcha ; il partit donc d'un côté et
sa victime de l'autre. Comme c'était à triple portée, on dut se contenter de le
regarder fuir.
Non loin de là se trouvaient deux immenses frênes sur lesquels, au
printemps, il y en avait souvent une paire. C'est là que fut fait ce célèbre
tour de force de s'élever en avançant contre le vent : observation d’une
importance capitale, qui est décrite dans un chapitre précédent.
GRAND AIGLE FAUVE
(A. chrysaëtos)
Voici sans conteste le roi des oiseaux, il a la puissance et le courage.
N'ayant pas d'ennemi de sa force, il passe en paix de longs jours dans la
béatitude que peut donner l'autocratie incontestée. — L'aigle n'a peur que de
l'homme, encore le craint-il très peu. Cerné, il n'hésite pas à se précipiter
sur lui. — En captivité il est d'un abord excessivement dangereux : son humeur
féroce en fait un animal indomptable. — Il faut beaucoup d'adresse pour arriver
à lui inspirer de la crainte, encore ne faut-il pas l'exciter, sans cela il se
défend jusqu'à la mort.
La nature l'a créé pour dépeupler, comme les felis, les squales
et les esox.
Ce tyran des airs est supérieurement pourvu de tous les organes
nécessaires à cette vie de meurtre. Ses armes sont huit serres de la longueur
d'un doigt, recourbées, pointues et mues par des muscles terribles. Son bec
très crochu lui sert à dépecer les animaux qu'il a perforés avec ses griffes.
Ses ailes sont très grandes et excessivement robustes, elles ont la
forme des 'ailes de voilier par excellence. Il frappe rarement l'air, à moins
qu'il ne fasse aucun vent, ou qu'il soit chargé d'une proie. — La plume est
impuissante à dépeindre la majesté de son allure, l'amplitude des immenses
cercles qu'il décrit dans les airs. Par moments son immobilité est exacte : il
étudie un terrain ou surveille une proie ; puis, soudain, de plusieurs
centaines de mètres, il se laisse tomber comme un météore, avec la vitesse de
la chute des corps dans l'espace.
Cette vitesse est telle, qu'en tombant il produit un bruit assez
difficile à expliquer : ce n'est pas le boulet, ce n'est pas la balle ; il faut
l'avoir entendu pour en avoir une idée juste ; puis, arrivé à une dizaine de
pieds de la terre, il a assez de force dans les ailes pour détruire la vitesse
de sa chute, et cela en une demi-seconde, en les étendant seulement.
Son adresse est remarquable, jamais il ne commet d'erreur ; au reste,
ses yeux sont excellents : de trois cents mètres en l'air il épie le lapin dans
le fourré ou le canard dans les joncs. — Il se sert de ses griffes, qui sont
les armes avec lesquelles il tue, d'une manière remarquable ; en captivité,
lorsqu'il a faim, il attrape les morceaux de viande qu'on lui jette, avec une
seule serre, et ne les manque jamais s'ils passent à sa portée.
Ses mouvements ont la précision des mouvements des petits oiseaux : il
est net, sec, puissant dans ses allures ; son coup d'œil surtout est
remarquable. — Comme il a les muscles moteurs du globe de l'œil très peu développés,
il est obligé, toutes les fois qu'il veut voir nettement quelque chose, de
faire un mouvement. Sa tête prend alors des poses splendides : cette prunelle
brillante, logée sous une profonde arcade sourcilière, jette des éclairs ; son
bec crochu, son air féroce, les plumes acuminées de l'occiput qu'il hérisse et
lui forment un diadème ; tout cet ensemble d'un galbe véhément fait de l'aigle
un merveilleux modèle de puissance et d'audace.
Il est roi d'un territoire qu'il choisit toujours très vaste. — Tous les
petits mammifères le redoutent ; les jeunes des grands animaux ont peur d'être
vus de lui : le jeune chamois se blottit contre sa mère, les vieux boucs
rassemblent le troupeau et frappent du pied avec fureur. L'homme même, enfant,
a été l'objet de ses attaques.
Son intelligence n'est développée qu'au point de vue de la chasse. C'est
un spectacle très intéressant que celui d'une famille d'aigles faisant une
battue pour pourvoir le nid de provisions.
Le mâle est à une centaine de mètres en l'air, immobile dans l'espace,
la femelle bat les fourrés ; son vol, dans ce cas, a une mollesse d'une grande
élégance, elle suit les ondulations du terrain sans efforts, passe d’une
colline à l'autre, descend et remonte les pentes des montagnes : puis, quand
une proie apparaît, les deux époux lui sont presque en même temps dessus. Il
arrive souvent qu'un lièvre qui est levé à 10 mètres de la femelle est pris par
le mâle qui est à 100 mètres dans les airs. Il fond, la tête la première, lui
est dessus en quatre ou cinq secondes, le prend au vol, et, s'il est dans la
montagne, plonge dans la vallée avec sa charge, et la remonte ensuite il tire
d'aile à son aire.
Là se fait la curée, qui n'a jamais lieu sans discussion, malgré les
charmes des liens matrimoniaux.
A part cependant ce vieux levain de férocité, qui perce constamment, la
famille est parfaitement élevée, et surtout abondamment pourvue de nourriture.
Les aigles font pendant le temps de l'éducation de leurs petits une
énorme consommation de gibier : les aiglons ont à un certain moment besoin de
beaucoup manger, pour pouvoir fournir à la croissance des grandes plumes. La
nature donne alors au père et à la mère une activité, qui heureusement pour les
lièvres et les lapins du voisinage n'a rien de commun avec leur paresse habituelle.
A ce moment, ce coup de feu qui dure un mois, ils n'ont pas de répit, les
abords de l’aire sont ordinairement encombrés d'animaux en putréfaction :
heureusement que les corbeaux ont l'œil à tout ce qui se gâte et l'audace
d'aller le chercher jusque dans le nid de l'aigle.
Tout bien considéré, ils risquent très peu ; ils sont si adroits que,
même dans un très petit espace, ils sauraient s'échapper. Le grand aigle fauve
que j'ai possédé de nombreuses années avait toujours une pie avec lui, et il n'y
a sorte de méchancetés que cette malicieuse petite bête n 'ait faites à son
terrible et taciturne compagnon. Ils ne s'en occupent pas plus que des mésanges
qu'on peut voir à la lunette rôder jusque dans les branches qui forment
l'extérieur du nid.
Les aiglons, à un mois et demi, sont gros comme père et mère. Leurs
premiers vols sont assez timides. Les parents les suivent à ce moment avec une
sollicitude toute particulière ; puis, petit il petit, quand le savoir du vol
et de la chasse augmente, l'amour de la famille diminue, l'aire est abandonnée
et chacun, peu à peu, finit par chasser pour son propre compte.
L'accouplement de ces oiseaux n'a rien de particulier : la femelle est
toujours posée sur un arbre ou sur un rocher : le mâle arrive au grand vol,
l'acte dure assez longtemps, puis le mâle repart toujours. — Ce qui attire
l'attention, ce sont les cris stridents qu'ils poussent : ces animaux sont
féroces en tout, même en amour.
Il est bien rare de voir deux aigles ensemble, excepté dans la saison où
ils ont des petits. Ceux qu'on enferme dans des cages périssent tous de la même
manière : un coup de serre qui leur traverse le cerveau.

VAUTOURS
Arrêtons-nous longuement à l'étude de ce type de vol, il est plein
d'enseignements utiles : c'est lui qui apprendra à l'humanité à conquérir
l'immensité des airs.
Cette grande famille d'oiseaux résout le problème de la station dans
l'air avec le moins de dépense de force ; on pourrait même dire autrement, que
c'est celle qui vole avec le plus de science.
Les besoins sont, là comme partout, les dispensateurs des facultés. Il
faut au vautour, pour vivre, qu'il puisse s'élever à une grande hauteur pour
avoir un vaste champ d'observation, puis, qu'il puisse y rester longtemps sans
se fatiguer.
Aussi voyez sa construction :
Poids très grand, ailes immenses comme longueur et comme largeur : sa
grande surface le soutient, et sa masse lui permet une grande vitesse acquise.
— Aussi nous le voyons, après quelques battements d'ailes, se mettre de suite à
planer, s'élever dans les airs et s'y soutenir, n'ayant comme force vive
dépensée que le départ et la direction. — Certaines espèces, surtout les
grosses, peuvent exactement, par un jour de vent, ne donner aucun coup d'ailes.
La vitesse chez cette famille n'est utile qu'aux petites espèces, qui
sont les pourvoyeuses des grosses : aussi, les percnoptères, les auras, les
urubus, ayant à produire des mouvements plus divers, dépensent beaucoup plus de
force.
Voici au reste l'emploi d'une journée de vautour sur l'un ou l'autre
continent :
La nuit s'est passée, pour les grosses espèces, dans les anfractuosités
de rochers inaccessibles, où ils se réunissent à l'abri du vent, s'ils n'ont ni
œufs ni petits. — Les cathartes, les percnoptères sont restés dans le bas pays
; ils sont moins farouches et beaucoup plus intelligents.
Le soleil vient sécher la rosée qui mouille leurs plumes ; les
vautours-étendent les ailes, font fonctionner les jointures, cultivent les
canons naissants avec le soin qu'on apporte au bon entretien d'un organe
essentiel.
A sept heures, nombreux battements d'ailes, sans quitter le perchoir,
puis ils remettent la tête entre les épaules et reprennent leur air sinistre et
abruti.
Entre huit et neuf heures la brise commence ordinairement à se lever, le
vautour plonge de temps en temps dans la vallée des regards de ses yeux uniques
comme puissance dans la création ; puis frappe quatre ou cinq fois l'air et
s'élance dans l'espace. — Il s’abaisse sans battre des ailes d'une cinquantaine
de mètres et est ensuite en plein vol.
Les petites espèces, un peu plus matinales, sont déjà à la besogne ou en
quête.
Les grands vautours se tiennent à des hauteurs à variables suivant les
espèces : les vautours fauves, les sarcoramphes papa sont ordinairement
à 5 ou 600 mètres en l'air ; ils sont à peine visibles de la terre. — Les
arrians, les otogyps, les condors, se tiennent ordinairement beaucoup plus haut
; on peut estimer cette hauteur à 2 ou 3,000 mètres ; ils sont tout à fait
invisibles.
Les arrians étudient les vautours fauves, qui, eux, surveillent les
percnoptères, et les percnoptères soignent les mouvements des milans et surtout
des corneilles.
En Amérique, les urubus sont surveillés par les aura, les aura
par les papa, et ces derniers par les condors.
Comme tous ces grands rapaces établissent une sorte de réseau
d'observation sur la terre, par cela même qu'ils se surveillent les uns les
autres, sitôt qu'un repas est signalé, les voisins d'alentour se mettent de
suite en route dans cette direction, et ainsi de suite des autres, ce qui fait
qu'on les voit réunis très rapidement.
Ils sentent les cadavres, dit-on vulgairement.
Ceci est un fait parfaitement inexact, impossible d'ailleurs lorsqu'ils
se trouvent sur le vent d'une bête morte. Au reste, leur appareil olfactif est
tellement peu développé, qu'il est insuffisant pour les guider, même de près.
Pour s'en assurer, il y a une expérience très facile à faire, c'est de cacher
de la viande, et faire venir un vautour ; il restera à côté sans la trouver,
son odorat ne la lui révélera pas.
La tournure de ces oiseaux a quelque chose de particulier qui mérite
d'attirer l'attention.
Chez les vautours, en action de vol sans battement, par un vent de 5
mètres à la seconde, vitesse où ils peuvent le mieux développer leurs facultés,
leur aspect, quand on les voit en l'air, devient intéressant à étudier.
Il est clair que, pour pouvoir s'élever avec ce faible courant d'air, il
leur faut déployer toute leur surface. A cette vitesse de 5 mètres, le
percnoptère a les ailes parfaitement rectilignes, le gypoierax cathartoïde
commence il faire passer ses pointes légèrement en avant, le gyps fulvus
les avance tellement, (que, si on prend la mesure de l'angle en avant qu'il
produit, on trouve qu'il est de 165 degrés. L'otogyps oricou va plus loin :
pour faire un croquis satisfaisant de sa tournure au vol, il faut arriver
jusqu'à 140 degrés.
NÉOPHRON
PERCNOPTÈR
Poids 1750 gram., en moyenne. Surface 1mq, 40dq.
Vautour hardi, ne craignant rien. Sa chair est une infection : l'auteur
en a goûté par force, et peut certifier qu'il faut avoir bien faim pour en
ingurgiter deux bouchées.
Comme il est persuadé qu'il ne vaut pas le coup de fusil, il est très
peu craintif, se laisse approcher à dix pas, surtout si on n'a pas les yeux
fixés sur lui.
C'est le vautour chercheur.
Il plane bien, rame médiocrement ; mais a surtout dans le vol une
particularité à remarquer, qui au reste est inhérente à sa construction : c'est
le peu de fixité dans la direction. — Cela tient à ce que sa queue est faible
et que ses ailes sont étroites.
Tous les oiseaux qui n'ont pas de queue importante, qui ont peu de
largeur d'aile, et surtout qui ont l'habitude de voler les ailes très étendues,
présentent cet effet. Leur vol change de direction à chaque instant. Les
mouettes, goélands, sternes, font exception cela n'infirme pas cette règle,
parce qu'ils ont l'habitude de tenir leurs ailes très repliées, ce qui compense
leur étroitesse en produisant un traînement. — Les types du vol rectiligne sont
d'abord les oiseaux qui possèdent peu de surface : chez eux la ligne droite,
comme marche, est forcée ; puis, tous les oiseaux il queue longue et faible et
à ailes larges : pie, paon, argus, etc.
Le percnoptère est, dans les oiseaux de haut vol, le type de la
variation dans la direction. On sent, en le regardant, qu'il fait des efforts
constants pour se maintenir dans une ligne fixe.
En captivité c'est un animal très doux, très familier, charmant même,
cherchant toujours quelque chose.
Il serait certainement un des amis de l’homme s'il n’avait un vice rédhibitoire
qui force il l'exclure du voisinage des habitations : c'est son odeur affreuse.
VAUTOUR FAUVE (Gyps
fulvus)
Nous sommes en face de notre desideratum.
Attention au bec ! on peut négliger les griffes ; mais le bec est
terrible, d'une force dont on ne se doute pas ; les vêtements sont
insuffisants, et ne protègent pas le corps d'une manière efficace.
Une fois mort, gare les vomissements ; c'est horrible d'odeur. Ce parfum
n'est nullement fugace, il tient pire que le musc : tout le corps de l'animal
en est imprégné. La chambre dans laquelle il restera seulement quelques heures
conservera cette odeur nauséabonde pendant des mois entiers.
Puis gare aux poux, ils sont de belle taille.
Le premier de ces énormes parasites qu'on voit errer sur ses vêtements
cause un étonnement indicible. Le plus bel exemplaire de la production arabe
(et il y en a de bien beaux) n'est qu'un nain à côté de celui du vautour.
Cependant, malgré ses énormes proportions, il n'est pas dangereux et ne
s'acclimate pas sur l'homme.
Mais, si on passe par-dessus ces petits ennuis, quel bel animal on a
devant les yeux !
Cette fois c'est 2m,50 d'envergure, ce sont 7kil,500 que pèse cet
admirable aéroplane animé ; il n'y a
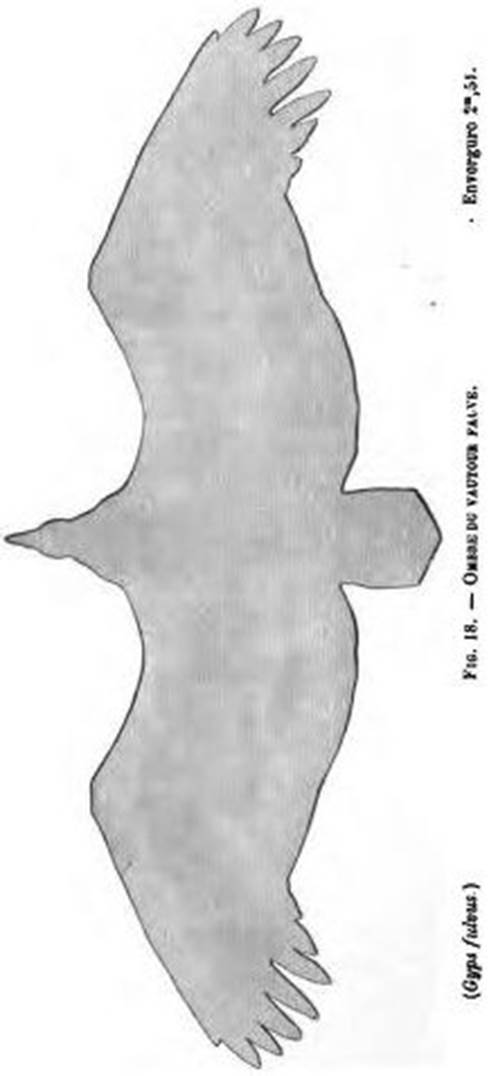
après lui que trois ou quatre
exceptions qui le surpassent, sans cependant le faire oublier. Il est bien, en
tous cas, leur frère comme similitude de vol.
Il y a peu de choses à dire des otogyps, si ce n'est qu'il faut la plus
grande attention pour les reconnaître dans un groupe.
Quant aux condors, comme leur conformation est la même que celle des
vautours de l’ancien continent, on peut sans rien hasarder, dire que leur
manière d'être dans l’air est sensiblement la même.
Comme chaque chapitre de cette étude contient quelque aperçu sur le gyps
fulvus, nous y renvoyons le lecteur, et lui recommandons l'étude spéciale
de cet oiseau ; il fait mieux comprendre en cinq minutes le vol sans battement,
qu'une longue étude de toutes les autres familles d'oiseaux ensemble.
La note dominante de ce vol, ce qu'il a de remarquable, c'est la
tendance très marquée à produire toutes les manœuvres par le planement et
d'éviter tout ce qui rappelle le rameur. Les otogyps et les arrians sont dans
le même cas, ils exagèrent même cette tendance. Tous ces gros oiseaux ne
frappent l'air nue quand le vent est absolument calme : circonstance
atmosphérique très rare ; et, comme le moindre souffle d'air leur suffi pour
obtenir la suspension, c'est rarement la tranquillité de l'air qui les force au
repos. L’humidité les gêne infiniment plus que le calme ; il semble, à les
observer, qu'ils redoutent beaucoup d'avoir les ailes mouillées. Les très
grands courants d'air déroutent aussi l'économie de leur genre de vol : ils
sont organisés pour bien voler par un vent moyen ; aussi, quand le vent
fraîchit trop, ils commencent à éprouver des difficultés ; et par la tempête,
ils n'y sont plus, ils regagnent un abri et ne bougent plus. Cela vient de la
grande largeur de leurs ailes, largeur qui par le fort traînement qu’elle
procure, dérange complètement leurs aptitudes de locomotion.
Pour résister aux grands courants d'air, il faut absolument les ailes
étroites : aussi observez les goélands, les pétrels, les albatros ; par un vent
à tout carguer, vous les voyez en pleine action chasser avec ardeur, se mouvoir
avec facilité ; on comprend qu'ils sont dans leur élément : plus de battements
; ils sont alors plantés sur deux baguettes rigides, très arquées en dessous,
effleurant la vague avec une précision étonnante ; la palpant même du bout des
rémiges; s'élevant et s'abaissant avec elle sans jamais se laisser atteindre.
Ces mêmes oiseaux, par un vent de 5 mètres, une légère brise, sont obligés de
rester sur l'eau, occupés à barbotter comme de vulgaires canards ; pendant que
par ce même vent les grands voiliers décrivent avec succès leurs immenses
cercles qui les transportent sans fatigue à d'énormes hauteurs.
Le vautour est donc l'oiseau qui peut accepter comme sustention
suffisante le plus faible courant d'air ; il est l'exagération de ce que nous
pourrions dénommer le type de la station absolue.
Je l'ai déjà dit et je le répète, un grand vautour peut voler sans fournir
un seul battement. J'ai vu le fait suivant, non pas une fois, mais des
centaines de fois : aux abattoirs des villes d'Orient, les vautours sont là en
grand nombre, attendant le moment propice pour se jeter sur leur pâture en se
soutenant dans les airs sans battre une seule fois. Ils montent à perte de vue,
ils redescendent à 200 mètres du sol, vont au vent,
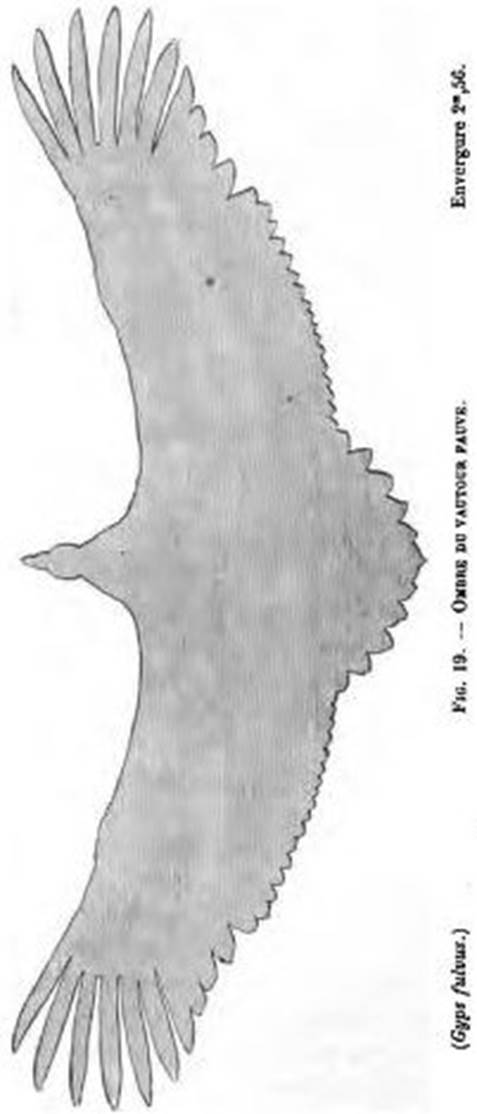
avec le vent, à droite, à gauche,
parcourent en une heure toute la contrée environnante pour voir s'il n'y a pas
de bête morte plus facile a aborder, et font ce manège la journée entière;
produisent 20 ascensions de 1,000 mètres chacune, 100 lieues de parcours ; et
tout cela sans avoir frappé l'air une seule fois.
Quand vous chasserez le grand vautour à l’affût, regardez-le venir dans
les airs : il n'apparaît pas comme un gros oiseau ; à la hauteur où il voyage
d'habitude, il a exactement la même grosseur que les milans et les percnoptères
; il ne fait pas plus d'effet qu'eux.
Vous le distinguerez cependant très vite à l’angle en avant formé par
ses ailes, à l'absence de battement, et surtout à la lenteur et à la régularité
avec lesquelles il se meut dans l'espace : c'est là un signe infallible pour le
reconnaître à perte de vue. Sa grandeur ne se comprendra que bien plus tard,
lorsqu'il ne sera plus qu'à 2 ou 300 mètres ; et, à partir de cette distance,
il croîtra avec le rapprochement beaucoup plus que les autres oiseaux.
Vous le distinguerez encore à la forme particulière des bouts de ses
ailes. — On peut dire que c'est l'oiseau qui a les rémiges les plus écartées
les unes des autres : il y a à l'extrémité, entre chaque plume, un espace vide
de cinq largeurs de plume.
Puis encore à une autre particularité : la rémige, au lieu d'aller en
s'effilant vers la pointe, est construite d'une manière inverse ; elle semble
implantée dans le corps de l'aile par le bout mince ; la pointe se trouvant
sensiblement plus large que la partie qui semble s'attacher à l'aile et qui
précède juste le grand élargissement des barbes.
Ces grandes plumes larges du bout, espacées hors de coutume, ont un
galbe curieux qui ferait le bonheur des peintres s'ils connaissaient cet animal
en liberté.
A cette construction particulière viennent se joindre des effets de
torsion de rémiges qu'on ne voit que chez ces gros oiseaux. Il faut que les
canons de ces plumes soient bien élastiques, car l'oiseau les soumet à de
terribles épreuves. Dans les efforts qu'il fait en cherchant à s'enlever, dans
certains coups de pectoraux bien appuyés, les pointes se dirigent juste au zénith
: au reste, au point de vue de l'aspect, de la ligne, tous ces gros oiseaux en
liberté sont excessivement intéressants. Il y a, rien que dans la reproduction
de leurs allures inconnues des personnes qui ne les ont vus qu'en captivité,
des motifs qui feraient le succès d'un peintre animalier.
Mais il faut la liberté ; autrement on n'a sous les yeux qu'un aigle
immobile comme une borne, ou un vautour puant, qui s'ennuie il mourir, la tête
engoncée entre les deux épaules : aspects qui n'ont rien de commun avec celui
de ces deux rois des airs parcourant fièrement l'immensité des cieux.
Ce qui prive souvent l'observateur de ces évolutions intéressantes,
c'est la peur. A la moindre appréhension ces gros oiseaux deviennent rameurs ;
ils veulent rapidement se mettre hors de la portée du danger, et alors,
développant toute leur puissance, c'est au plus vite et à grands coups d'ailes
qu'ils se mettent à fuir.
La puissance de leur vue doit être énorme ; et il est rationnel de
l'admettre, parce que ces oiseaux sont, de tous les volateurs, ceux que leur
genre de vie force à avoir la vue la plus longue.
Un passereau n'a pour champ de vision nécessaire que quelques centaines
de mètres ; un organe plus puissant serait sans emploi, et par conséquent
atrophié au bout de quelques générations ; les oiseaux de mer étudient la
surface de l'onde de quelques dizaines de mètres seulement ; ce n'est pas là
non plus qu'il faut chercher ces lentilles parfaites, capables d'éteindre tous
les rayons divergents.
Les oiseaux de proie chasseurs, tels que les faucons et les aigles, se
permettent l'étude du sol souvent de fort haut ; ces derniers surtout chassent
quelquefois de 4 à 500 mètres de hauteur. Mais qu'est-ce que cette distance
comparée aux 5 ou 6 kilomètres et plus qu'il faut aux vautours pour étudier
leur champ de recherche !
Il est judicieux de penser que le besoin constant de voir plus loin que
les autres oiseaux leur a fait acquérir dans l'organe de la vue une perfection
que les autres ne possèdent pas. Il faut donc absolument être invisible pour
leur voir faire leurs évolutions extraordinaires, ou bien se trouver dans les
pays sauvages où ils n'ont pas peur de l'homme ; et encore, là, avoir un
costume qui soit couleur locale, sans cela ils ne descendent pas.
Pour les voir, les observateurs français doivent se déplacer ; il n'y a
à proximité d'eux que les hauts plateaux de l'Auvergne centrale, les Alpes et
les Pyrénées où on rencontre, mais très rarement, le gyps occidentalis,
qui est en plus petit le sosie du fulvus.
Si le hasard n'intervient pas pour faire voir ce roi des planeurs, il
faut lui venir en aide : la bête morte dans un endroit très isolé est le moyen
suprême pour l'attirer. En traversant la Méditerranée et se rendant en Algérie,
on est sûr, avec un appât, de le voir surtout en automne ; car, le chercher
dans le nord de l'Afrique, dans des mois autres que septembre, octobre et
novembre, est chanceux. Il y en a certainement quelques-uns à toutes les
époques de l'année, mais c'est seulement dans ces trois mois que, soit par
suite d'une émigration qui aurait lieu annuellement du sud au nord, soit pour
d'autres causes ils sont en plus grand nombre. En tous cas, même dans les pays
où il y en a beaucoup, ils ne sont pas abondants ; on peut rencontrer par hasard
un vol d'une centaine, puis rester des années sans en revoir de près.
C'est malheureusement l'oiseau
inconnu de ceux qui étudient, car certainement 99 personnes sur 100 ne l'ont
jamais vu au vol. En Algérie, au Caire même, où pendant trois mois de l'année il
y en a tous les jours au-dessus de la ville, la plupart des Européens ignorent
son existence.
Mais, lorsqu'on se dérange pour aller où on le rencontre, lorsqu'on voit
cet énorme animal, gros comme un mouton, s'élever d'abord péniblement, avec des
battements dont les sifflements s'entendent de 300 mètres dans le silence du
désert ; lorsqu'on le voit ensuite décrire ses cercles sans fin, on a sous les
yeux un spectacle intéressant : tout être humain est cloué sur place, l'Arabe
lui-même est émotionné. On a rencontré en lui le mouvement sous un aspect dont
on n'avait pas d'idée : c'est quelque chose de ressemblant comme majesté et
curiosité à l'effet produit par une locomotive en marche.
Quand on voit voler un martinet, on
songe à une mécanique ; quand c'est une bécassine ou une perdrix qu'on a sous
les yeux, on éprouve l'impression d'un ressort qui se détend ; une mouette
rappelle le mouvement perpétuel ou le balancier d'une horloge ; mais la vue du
grand vautour amène tout de suite une idée d'imitation : c'est le parachute
dirigeable qu'on s’ingénie à reproduire. — Ce que nous allons essayer de faire
dans la troisième partie de cette étude.
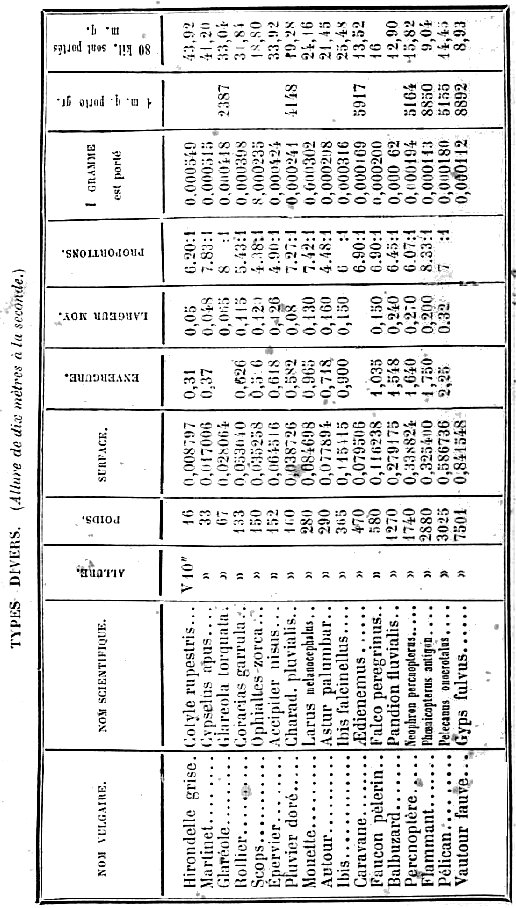
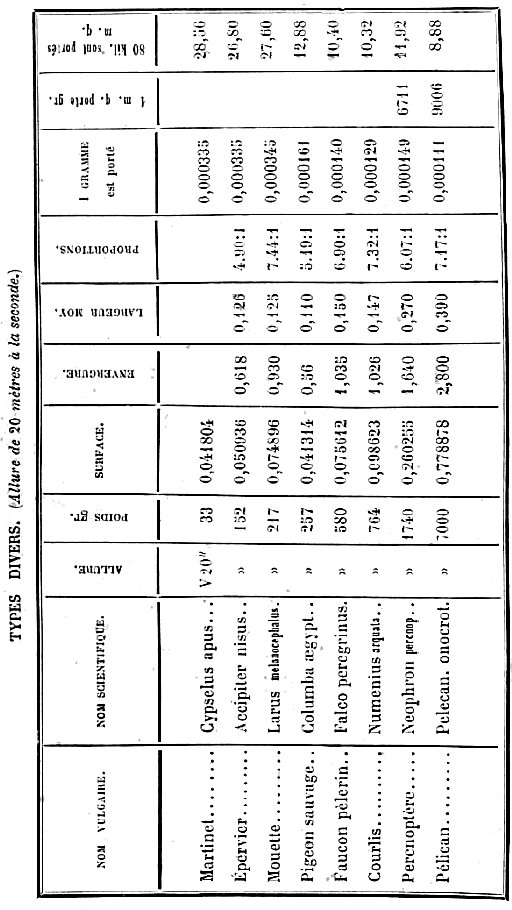
THÉORIE DE
L'AÉROPLANE
Maintenant que nous sommes au courant des mouvements des oiseaux, que
nous avons pour ainsi dire vécu de leur vie, que nous sommes édifiés en un mot,
cherchons à comprendre la base du vol des voiliers, c'est-à-dire la sustention
de l'aéroplane animé, ou de son imitation l'aéroplane mécanique.
Avant d'aller plus loin, je suis forcé d'énoncer une propriété de
l'attraction sur les corps en mouvement : propriété qui est connue ou inconnue,
je ne sais ; mais qui en tout cas existe, c'est celle-ci :
Quand un corps se meut, son centre de gravité
se déplace, et se transporte en arrière du sens du mouvement.
Pour démontrer cette propriété de l'attraction, il faut s'adresser à un
corps de forme régulière. Prenons donc une surface rigide, une feuille de
carton ayant la forme d'un parallélogramme rectangulaire, d'un carré long : par
exemple une feuille de bristol, de la forme ci-dessous (fig. 20).
Son centre de gravité doit sensiblement correspondre avec son centre de
figure ; il doit être en C, si le carton est bien homogène.
Si nous prenons l'appareil par le
point P, que nous le tournions la tranche en bas, et que nous l'abandonnions à
sa chute, pourquoi se produira-t-il un mouvement de révolution régulier du
carton sur lui-même ? et dans quel sens se produira ce mouvement de rotation ?
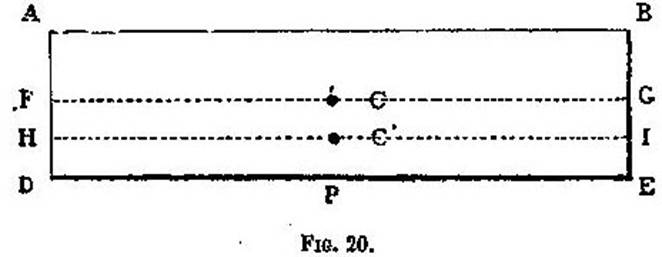 Dans le cas de la chute d'un corps présentant
une grande surface, nous devons écarter la chute perpendiculaire, qui est
impossible pratiquement, parce qu'il se trouvera toujours quelque imperfection
qui déséquilibrera l'action des surfaces sur la résistance de l'air, et donnera
de suite naissance à un mouvement, soit dans un sens, soit dans un autre.
Dans le cas de la chute d'un corps présentant
une grande surface, nous devons écarter la chute perpendiculaire, qui est
impossible pratiquement, parce qu'il se trouvera toujours quelque imperfection
qui déséquilibrera l'action des surfaces sur la résistance de l'air, et donnera
de suite naissance à un mouvement, soit dans un sens, soit dans un autre.
Ce cas éliminé, faisons intervenir une force qui le décide à aller dans
une direction : soit une imperfection quelconque.
Sous l'action du
mouvement donné par la chute, le centre de gravité qui était en C s'est déplacé
; il s'est transporté sur la ligne CP (d'une quantité que je crois proportionnelle
à la vitesse), et est venu se fixer en C'.
Les résistances que présentent les parties du carton séparées par ce
nouveau centre de gravité ne sont plus les mêmes qu'auparavant ; elles
s'équilibraient sensiblement avec le centre en C, maintenant avec le centre en
C' ; il est clair que la surface HABI est beaucoup plus grande que la surface
HDIE ; par conséquent elles ne se font plus équilibre comme résistance.
Qu'arrive-t-il alors ?
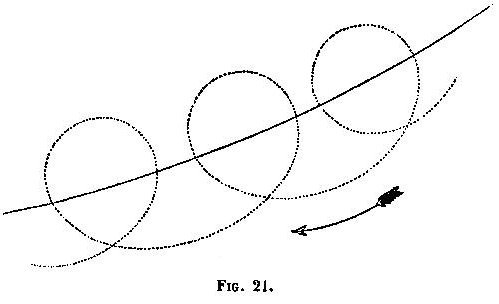 Il arrive forcément que la plus grande
surface restera en arrière de la petite, puisqu'elle sera plus retenue par
l'air ; la tranche AB se soulèvera, la tranche DPE prendra l'avance, le carton
finira par faire une révolution entière. Sous l'action du mouvement donné par
la chute il y aura déplacement constant du centre de gravité, et production
d'un mouvement de rotation. — Ce mouvement une fois produit se répétera ; c'est
un véritable élancé de révolution, qui se poursuivra, entretenu qu'il est par
chaque poussée produite par le déséquilibrement.
Il arrive forcément que la plus grande
surface restera en arrière de la petite, puisqu'elle sera plus retenue par
l'air ; la tranche AB se soulèvera, la tranche DPE prendra l'avance, le carton
finira par faire une révolution entière. Sous l'action du mouvement donné par
la chute il y aura déplacement constant du centre de gravité, et production
d'un mouvement de rotation. — Ce mouvement une fois produit se répétera ; c'est
un véritable élancé de révolution, qui se poursuivra, entretenu qu'il est par
chaque poussée produite par le déséquilibrement.
Il s'accélérera même jusqu'au point
où il sera équilibré par la résistance de l'air.
Nous avons remarqué que la chute du carton tournant sur lui-même n'est
jamais verticale, mais qu'il se produit au contraire un écart constant de la
perpendiculaire, soit dans un sens, soit dans un autre : ce sens est déterminé
par l'accident quelconque qui en décide ; mais ce sens de tournement a cela de
particulier qu'il se produit toujours de la même manière.
Étant donné le grand sens de
direction, le mouvement rotatoire a toujours lieu d'arrière en avant, comme
dans la figure 21.
Le grand sens de mouvement qui est produit par l'accident peut l'être
encore par une autre cause : il peut être fourni par l'inclinaison du carton au
départ. Dans ce cas, la direction générale de la chute sera toujours la même
que celle du carton. La rotation aura lieu ensuite, forcément et toujours, de
dessous en dessus de ce sens, et jamais de dessus en dessous.
Si cependant nous prenons ce carton, et que nous le lancions fortement
dans une direction, devant nous par exemple ; mais en ayant soin de lui
communiquer un mouvement de révolution dans lequel le haut doit passer en
avant, c'est-à-dire une révolution contraire à celle que prendrait ce corps
plat si nous n'intervenions pas, et que nous lui laissions choisir son sens de
torsion : il arrive que le mouvement imprimé se continue ; mais, ce qu'il y a
de particulier, c'est que c'est aux dépens du sens de direction. —Ainsi, on a
lancé violemment la carte devant soi ; si on l'avait abandonnée à elle-même, en
tournant d'arrière en avant, elle serait allée tomber à environ 2 mètres,
tandis qu'elle revient sur elle-même, en décrivant une courbe, et tombe aux
pieds de l'expérimentateur.
Dans les expériences qui précèdent nous avons admis que le corps plat a
un centre de gravité qui correspond sensiblement à son centre de figure.
Examinons maintenant l'effet produit par le cas contraire, c'est-à-dire,
par un corps à grande surface dont le centre de gravité s'éloigne fortement du
centre de figure. — Qu'arrive-t-il à notre surface rigide de carton si nous
reportons le centre de gravité de A en B, au moyen d'un chargement qui l'amène
environ à ce point (fig. 22) ?
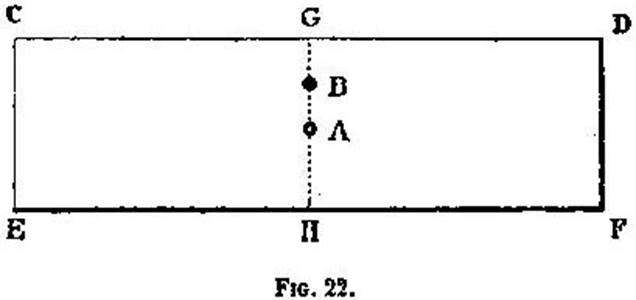 En l'abandonnant à l'action d'une chute, la
tranche CD, en vertu de la résistance de l'air sur cette surface inégalement
chargée, tendra à tenir le devant ; mais, sous l'action de la vitesse produite
par la chute, le centre de gravité abandonnera le point B, il viendra environ
en A; si le poids n'est pas trop lourd et que la vitesse soit suffisante, il
reculera même au- delà, et le carton tournera encore sur lui-même, de dessous
en dessus : le dessous se dirigeant, bien entendu, toujours en avant, dans le
sens du mouvement qui se produit, autre que la verticale.
En l'abandonnant à l'action d'une chute, la
tranche CD, en vertu de la résistance de l'air sur cette surface inégalement
chargée, tendra à tenir le devant ; mais, sous l'action de la vitesse produite
par la chute, le centre de gravité abandonnera le point B, il viendra environ
en A; si le poids n'est pas trop lourd et que la vitesse soit suffisante, il
reculera même au- delà, et le carton tournera encore sur lui-même, de dessous
en dessus : le dessous se dirigeant, bien entendu, toujours en avant, dans le
sens du mouvement qui se produit, autre que la verticale.
Si le poids est trop fort, s'il ne permet pas au centre de gravité de se
porter assez loin du côté de H sur la ligne GH, le carton cherchera bien à se
retourner, mais il ne pourra y parvenir. Au lieu de faire une série de
évolutions sur lui-même, il produira une série de ressauts.
A chacun de ces ressauts il y a arrêt de vitesse de chute et de
translation, car elle s'est consommée à faire d'abord changer de direction le
carton, puis à le faire remonter. A ce moment d'arrêt, le centre de gravité
retourne à sa place normale. Il se produit donc une nouvelle chute qui procure
une vitesse nouvelle, le centre de gravité recule de nouveau, la tranche CGD se
relève jusqu'à équilibre, le carton s'arrête et retombe ; et ainsi de suite.
Le graphique de la marche est donc (fig. 23).
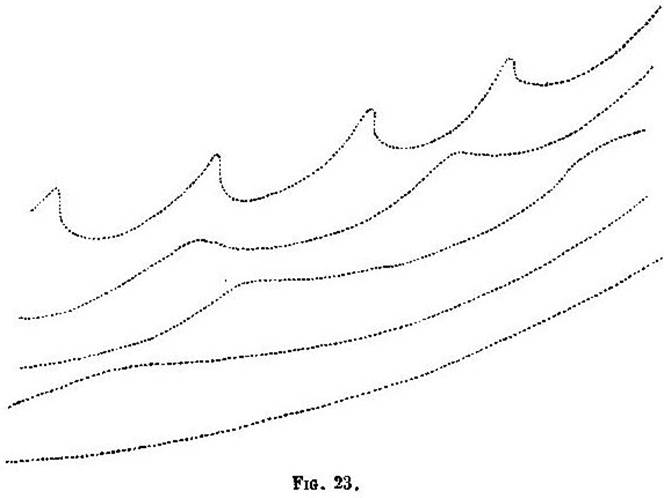
A-t-on jamais vu un corps possédant une grande surface par rapport à sa
masse suivre dans une chute une direction rectiligne, n'avoir pas de temps
d'arrêt ou même de remontée ? ce genre de marche d'un corps ne peut se
rencontrer ; cette loi de l'attraction s'y oppose. Ainsi, expérimentons avec la
plaque de carton : nous aurons beau nous y prendre de toutes les manières
possibles, nous n'arriverons pas à la faire tomber verticalement, pas plus que
nous ne l'empêcherons de tourner sur elle-même ; dans les deux cas elle prendra
le mouvement de torsion dont nous avons déjà parlé.
On peut cependant y parvenir, mais pour cela il faut détruire l'effet de
cette loi en communiquant à la plaque un mouvement de rotation dans le sens de
sa surface. Dans ce cas l'action du déplacement du centre de gravité n'a plus
le temps de se faire sentir, et la loi semble détruite : elle n'est cependant
qu'esquivée, paralysée.
Les ricochets que l'on fait faire aux pierres plates en les lançant
horizontalement sur l'eau offrent une démonstration de ce phénomène. On ne
parvient il maintenir la face plate de la pierre parallèle à la surface de
l'eau qu'en lui communiquant un mouvement de rotation qui empêche le
déplacement du centre de gravité. En lançant la pierre sans la faire tourner
horizontalement, au moyen d'un coup violent par exemple, elle se met tout de
suite à tourner verticalement ; ce qui rend le ricochet impossible.
Il resterait à parler, à propos de ces surfaces lancées avec un
mouvement de révolution sur elles-mêmes, d'un autre mouvement lent de torsion
qui se produit dans la marche de ces surfaces. Cette étude ne va pas jusque-là
; puis, ce fait n'intéresse qu'incidemment la question qui nous occupe.
Cet effet produit par le déplacement du centre de gravité, qui est très
facilement appréciable sur une feuille de carton, est beaucoup moins facile à
saisir sur les corps qui s'éloignent de la forme plate. Cependant, cette loi
une fois bien comprise, avec un peu d'attention on la voit se produire dans
tous les corps en mouvement d'autant moins qu'ils approchent davantage de la
forme sphérique, et cependant la sphère elle-même y est soumise.
Ne serait-ce pas cette force qui communiquerait aux astres leur
mouvement de révolution sur eux-mêmes ? Si l'éther est pondérable, s'il est
matériel, cela pourrait devenir une explication de ce phénomène.
Question aux astronomes. —Y a-t-il des exceptions ? Y a-t-il des astres
qui tournent à contre-sens du mouvement indiqué par cette loi ?
Si maintenant, dans la chute de cette surface trop chargée à l'avant
pour pouvoir se retourner sur elle-même, nous faisons intervenir une force
corrective, qui ait pour action de faire remonter le carton : comme par exemple
un pli que nous ferons sur la tranche EHF, nous arrivons à produire un mouvement
qui a une tendance à l'horizontalité, et cela d'autant plus exactement que la
coupe de l'appareil sera plus parfaite et qu'il sera mieux équilibré.
Nous sommes donc arrivés à l'aréoplane.
Le vol des oiseaux voiliers repose exactement sur les faits que nous
venons d'étudier : les plans de leurs ailes représentent la surface du carton,
et leur queue exerce la-même action que le pli que nous venons de faire à
l'arrière.
La marche de l'aréoplane est donc devenue, grâce à l'action de ce pli
correcteur, une série de chutes et de relèvements, tellement minuscules que la
marche de l'appareil peut être représentée par une droite. C'est le même ordre
d'idées que celui de la ligne courbe qui composée d'une série de droites, que
la circonférence qui est un polygone, etc.
Très souvent un aréoplane produit, à part ces mouvements imperceptibles,
on pourrait dire théoriques, d'autres grands mouvements de chutes et de
relèvements : cela tient à ce que la correction du gouvernail n'est pas
parfaite.
ANGLE DE LA CHUTE
De quelle quantité l'aréoplane tombe-t-il ? Quel est l'angle de cette
chute ?
Cet angle est variable, suivant : la
perfection de la coupe, la surface et la masse de l'oiseau. — Il semble,
d’après l'observation, qu'il puisse arriver jusqu'à n'être plus en grand qu'un
angle de 10 degrés. — Un oiseau planeur parcourt ordinairement, dans le sens
horizontal, cinq fois la longueur de sa chute.
Comme on le voit, il y a de la ressource dans un parcours pareil. On
comprend comment avec le moindre secours du vent on peut réparer le déficit
occasionné par la chute. On ne pense généralement pas à cette perfection dans
le glissement ; un parfait planeur, bien lancé, par un temps calme où il ne
trouve aucune branche pour se raccrocher, pas la moindre brise pour s'aider
dans la sustention, ne tombe cependant pas d'une quantité appréciable, surtout
si on le voit de bas en haut ; il semble pouvoir tourner indéfiniment.
C'est cette faculté de ne presque pas perdre de terrain comme chute, qui
permet, en utilisant bien les propriétés de l'aéroplane et les accidents du
vent, de produire le bénéfice dans le vol à la voile.
Ce problème posé ainsi : Par un vent régulier et un aéroplane fixe,
serait un contre-sens, quelque chose de semblable au bénéfice de force que certaines
personnes cherchent dans le mouvement perpétuel.
Je ne sais si je me suis bien fait comprendre à l'article Explication du
vol des voiliers ? — Il est bien entendu que l'aéroplane, oiseau ou machine,
est placé à un point d'équilibre qui lui permet de tomber d'une quantité telle,
que son centre de gravité en se portant à l'arrière arrive à relever l'appareil
de la quantité nécessaire pour produire le glissement le plus horizontal
possible. Qu'en d'autres termes la chute est réduite à son minimum.
Si maintenant, sous l'action de ce mouvement de translation, nous
transportons rapidement très à l'arrière le centre de gravité en portant les
pointes des ailes en avant, l'aéroplane sera donc forcé de monter : c'est la
manœuvre de l'oiseau qui monte brusquement.
Si les pointes sont transportées en arrière, le centre de gravité porté
en avant amènera la chute : c'est alors celle de l'oiseau qui plonge ; il le
fait, au reste, toujours ayant les pointes des ailes très en arrière. Il n'y a
pas d'oiseau qui plonge les ailes étendues, parce que le fait est impossible :
c'est le cas du carton qui ne peut pas choir verticalement. S'il l'essayait,
arrivé à une certaine vitesse, il serait forcé par le déplacement de son centre
de gravité, par le déséquilibrement des surfaces, de remonter forcément. —
Aussi, à quelque type qu'il appartienne, l'oiseau pique-t-il toujours les
pointes très en arrière.
Les vieux fauconniers avaient remarqué que le faucon qui cherche à lier
sa proie ne dépensait pas de force dans cet exercice, qui semble à première vue
en exiger beaucoup. Ils s'en étaient assurés en étudiant la respiration de
l'animal qui n'est presque pas accélérée ; qui en tous cas l'est infiniment
moins qu'elle ne l'est par des exercices bien moins rudes, tels que par un
battement consécutif de quelques minutes. — L'explication qu'ils en ont donnée
est naïve ; ils attribuaient au violent courant d'air le pouvoir de rafraîchir
l'oiseau.
Nous comprenons maintenant que ce calme de l'animal est naturel : il ne
dépense, dans cet exercice épouvantable, exactement que la force nécessaire
pour se porter sur ses deux ailes déployées ; le retournement est produit, aux
9/10, par le déplacement du centre de gravité sous l'action de la vitesse.
Cette faculté de déformation possédée par l'aéroplane, qui permet de
présenter des surfaces de grandeurs différentes, au lieu de compliquer ce
problème, en facilite au contraire la compréhension. — Dans la partie où il
doit acquérir de la vitesse, l'oiseau ne présente que la surface nécessaire au
parfait glissement. Dans la remontée, il peut offrir à ce parcours toute sa
surface, ce qui aidera singulièrement cette opération. — Si maintenant nous
nous remémorons ce qui a été dit de la brièveté de cette remontée comparée à la
longueur de la carrière où s'acquiert la vitesse, de l'action génératrice du
coup de vent, il sera facile de comprendre que, si on a l'adresse de choisir
l'accalmie pour se procurer de la rapidité, et le coup de vent pour heurter
cette vitesse acquise contre l'air animé, on aura rencontré une source de force
capable de remonter l'aéroplane plus haut que le point d'où il est parti.
Cette périodicité du coup de vent est indéniable. Il n'y a pas encore,
que nous sachions, d'appareils pour l'enregistrer : ils seraient cependant bien
simples à construire ; mais, en leur absence, pour se pénétrer de ce fait, on
n'a qu'à se souvenir des hurlements successifs de la bise d'hiver dans nos
cheminées : cette harmonie lamentable est la meilleure démonstration qu'on en
puisse donner.
Tout vent se meut par à-coup et non par une marche régulière, depuis la
modeste brise, presque insensible, jusqu'au khamsine rouge du désert et au
tourbillon du cyclone.
DE LA RÉSISTANCE
DE L'AIR
A L'AVANCEMENT
La résistance opposée par l'air, la difficulté que l'aéroplane oiseau ou
machine éprouve à pénétrer ce gaz, et en raison de la perfection de sa coupe ;
exemple :
Il est clair qu'une chouette-effraie (strix flammea), qui a pour
avant un vaste disque plat qui est sa laide figure, aura beaucoup plus de
difficulté à pénétrer l'atmosphère que l'imbrim (colymbus glacialis),
qu'on peut citer comme un modèle de coupe. — L'imbrim commence par un bec
pointu comme une aiguille, l’ensemble de la tête est conique, elle s'emmanche
sur un cou conique qui se lie à un corps conique. Quant à son arrière, il
présente des surfaces d'effacement parfaites ; la contre-pression, l'effet des
remous pourra s'employer d'une manière utile. Aucune force ne viendra se perdre
ou se briser, soit contre de longues pattes, soit contre une longue queue à
traîner : chez lui tout s'emmanche bien, glisse bien l'un dans l'autre, rien
n'accroche l'air ; tout passe bien l'un après l'autre. Mais, une fois lancé,
quelle vélocité possède ce palmipède : c'est un boulet qui rase la mer, qui
peut pénétrer des courants aériens qui font reculer tous les autres oiseaux.
C'est quelque chose de semblable à ce qui se produit dans la marche des
bateaux. Il est clair qu'une gabare de la Seine, avec son avant carré, a bien
plus de difficulté à trouer l'élément liquide qu'un bateau il vapeur de rivière
dont l'avant est tranchant comme une lame de couteau.
Quant à la résistance que l'aile éprouve pour pénétrer l'air, et la
résistance présentée au maître-bau pour le corps, nous remarquerons que,
quoique les ailes aient des formes bien variables comme longueur et largeur,
elles ont toutes une forme creuse, très accentuée chez les oiseaux à vol
faible, et s'atténuant comme convexité à mesure qu'on arrive aux oiseaux à vol
paradoxal tels que : duc, frégate et martinet.
Cependant, comme ensemble, cette forme creuse est générale.
Elle est indispensable, pour pouvoir dans l'acte de sustention arriver
sous l'action de la pression à la forme plate.
Puis, même en conservant une courbure, c'est pour elle un faible
obstacle à l'avancement dans le fluide. — tout le monde a remarqué le peu
d'efforts qu'il faut pour maintenir un parapluie contre le vent ; cet effort
est infiniment moindre que celui qu'il faudrait pour maintenir une surface
plate égale à la tranche qu'il présente au courant d'air.
Il y a certainement une pression de l'air sur la surface de l'avant,
mais il faut qu'il y ait une pression contraire fournie par un remous. — Cette
contrepression ne semble pas égale à la pression directe, mais son infériorité
n'est pas bien grande ; elle est produite, peut-être, par les imperfections de
la construction, et à coup sûr par le trainement.
Une surface d'une courbure parfaite recevrait une poussée égale au
trainement. (Ce théorème est purement intuitif.)
L'oiseau de grand vol, bien construit par dame nature, doit éprouver peu
de résistance pour pénétrer l'air. — Nous n'irons pas jusqu'à l'aspiration ;
non, mais d'après ce que nous avons observé des milliers de fois, la résistance
est presque négligeable.
A mesure que la construction de l'oiseau diminue comme perfection, la
résistance s'accentue davantage.
Pour que l'aéroplane machine jouisse de cette propriété de pénétration,
il faut apporter à sa construction une foule de conditions dont on ne doit pas
se départir, sous peine de produire un appareil à chute rapide, lequel, au lieu
de pouvoir produire par un temps calme l'angle minimum de 10 degrés, ne
fournira qu'une carrière représentant un angle plus fort ; ce qui gênera de
plus en plus l'ascension, et finira, en s'exagérant, par la rendre impossible.
Nous avons vu que l'avant doit être bien chargé et l'arrière aussi léger
que possible. Que le redressement produit par la résistance de l'air, sous
l'action de la vitesse, contre ce pli correcteur qui peut être une queue, doit
être parfaitement juste ; enfin que les surfaces gauches, surfaces difficiles à
décrire, soient bien comprises.
La résistance de l'air est presque nulle si les courbes présentées par
l'aéroplane sont bonnes. — Dans la nature ces courbes sont diverses, et leurs
effets sont meilleurs en raison de leurs perfections. Il y a dans leur
confection un point spécieux, difficile à expliquer, tout à fait sympathique.
L'intuition est pour beaucoup, on pourrait dire tout dans leur compréhension.
C'est en somme exactement le même problème que : produire des courbes d’un
boumerang, un dessous de navire heureux comme vitesse, un projectile dont la
forme lui permet d'aller plus loin qu'un autre à charge égale ; toutes
questions sur lesquelles les calculs ne pourront rien tant que les bases
manqueront.
On en est donc réduit à l'intuition pure ; la preuve en est, qu'on voit
des mathématiciens remarquables, en fait de constructions navales, faire des
caisses, et des ignorants inspirés construire des bijoux, comme par exemple les
embarcations de l'Océanie, ou, sans aller si loin, les biadés de Constantinople
et les palangriés d'Alger.
Il y aura dons toujours des appareilles réussis et des constructeurs qui
réussiront mieux que d’autres ; tout comme il y a des constructeurs de
canots et de navires qui font de meilleurs marcheurs que leurs confrères.
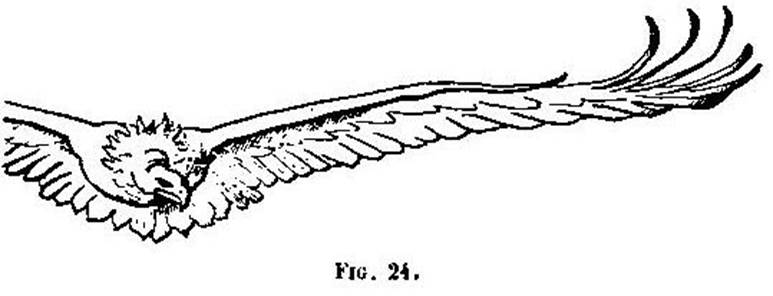 La nature, au
reste, n’est pas parfaitement explicite sur ce point délicat : ainsi,
étudions-la seulement sur deux grands oiseaux, d’environ même masse, l’aigle et
le vautour ; nous la voyons arriver à la perfection, à la réussite
parfaite, par deux moyens différents. L’aile de l’aigle est sensiblement semblable
dans sa partie d’avant à celle des autres gros oiseaux. La partie qui fend
l’air possède son plan de relèvement, formé par les deux premières plumes, et
ce plan n’a de remarquable que sa rigidité. — Chez le grand vautour, le procédé
employé est totalement différent ; dame nature n’a pas attaqué la
difficulté en bloc, elle l’a tournée. L’avant de l’aile quand l’oiseau est en
marche, offre le spectacle suivant : toutes les plumes se recourbent et
s’étagent sous l’action de la pression du poids de l’animal et du courant
d'air. Toute action d'ensemble des rémiges est supprimée : leur grand
écartement les unes des autres empêche au reste toute solidarité. Chaque plume
a donc sa torsion, qui fait de chacune un plan particulier de relèvement.
La nature, au
reste, n’est pas parfaitement explicite sur ce point délicat : ainsi,
étudions-la seulement sur deux grands oiseaux, d’environ même masse, l’aigle et
le vautour ; nous la voyons arriver à la perfection, à la réussite
parfaite, par deux moyens différents. L’aile de l’aigle est sensiblement semblable
dans sa partie d’avant à celle des autres gros oiseaux. La partie qui fend
l’air possède son plan de relèvement, formé par les deux premières plumes, et
ce plan n’a de remarquable que sa rigidité. — Chez le grand vautour, le procédé
employé est totalement différent ; dame nature n’a pas attaqué la
difficulté en bloc, elle l’a tournée. L’avant de l’aile quand l’oiseau est en
marche, offre le spectacle suivant : toutes les plumes se recourbent et
s’étagent sous l’action de la pression du poids de l’animal et du courant
d'air. Toute action d'ensemble des rémiges est supprimée : leur grand
écartement les unes des autres empêche au reste toute solidarité. Chaque plume
a donc sa torsion, qui fait de chacune un plan particulier de relèvement.
Le type Je ce genre d'aile est l'oricou (otogyps auricularis,
fig. 24).
ÉQUILIBRE VERTICAL
ET HORIZONTAL
Pour déséquilibrer son aéroplane dans le sens vertical, le voilier se
sert de sa queue, qui sous l'action du vent donne des directions tout comme un
gouvernail ; mais il a un autre moyen bien plus énergique de déplacer son
centre de gravité, c'est en changeant son centre de figure, c'est-à-dire en
variant la forme de sa surface et en la déplaçant par rapport il son corps.
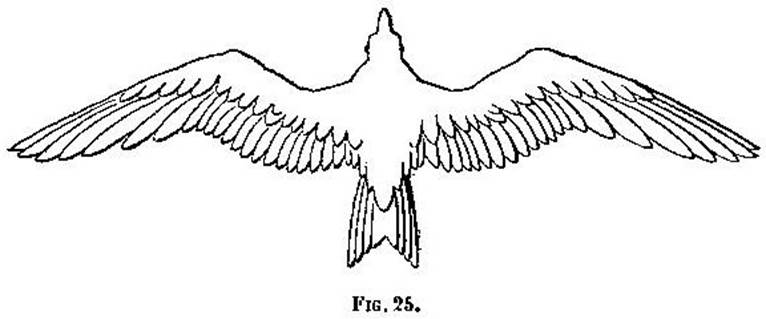 Quand l'oiseau a disposé sa voilure de
manière à avoir un équilibre pratique, que son aéroplane est réglé pour bien
marcher, comme par exemple dans la figure ci-dessous (fig. 25) ; si un besoin
quelconque l'oblige à monter brusquement, il n'emploiera pas sa queue surtout
si elle est faible, parce qu'elle n'aurait pas une action suffisante, mais il
étend ses ailes en avant (fig. 26).
Quand l'oiseau a disposé sa voilure de
manière à avoir un équilibre pratique, que son aéroplane est réglé pour bien
marcher, comme par exemple dans la figure ci-dessous (fig. 25) ; si un besoin
quelconque l'oblige à monter brusquement, il n'emploiera pas sa queue surtout
si elle est faible, parce qu'elle n'aurait pas une action suffisante, mais il
étend ses ailes en avant (fig. 26).
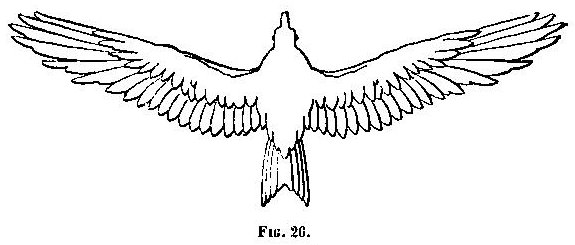 Le centre de gravité et le centre de figure
sont donc énergiquement portés en arrière ; l'ascension et le relèvement sont
donc forcés.
Le centre de gravité et le centre de figure
sont donc énergiquement portés en arrière ; l'ascension et le relèvement sont
donc forcés.
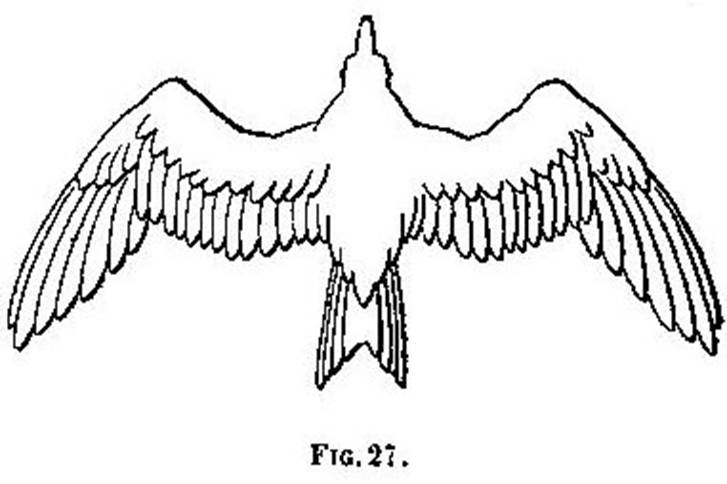 Si, au contraire, il prend l'allure suivante
(fig. 27) :
Si, au contraire, il prend l'allure suivante
(fig. 27) :
le centre de gravité porté en avant
sollicite la chute.
Ces déplacements produits par la position variable à volonté des ailes,
et la direction procurée par l'action du vent sur la queue, font la direction
dans le sens vertical.
Quant à la direction dans le sens horizontal, elle, est très simple.
Elle est aussi presque toujours donnée par le déséquilibrement de l'aéroplane,
excepté chez les oiseaux à queue très ample, possédant un organe capable de le
diriger ; ils s'en servent alors constamment : type naucler, milan.
Quand un oiseau décrit un rond, l'aile du côté du centre est toujours
moins étendue que celle dont la pointe décrit la circonférence ; de sorte que,
en voyant un voilier ployer légèrement une aile, on sait qu'il va tourner de ce
côté.
Le corps tout entier se prête à ce mouvement : l'oiseau se porte de ce
côté, la queue, même rudimentaire, bien qu'elle agisse peu, apporte aussi son
concours à l'exécution de cette manœuvre. — C'est chez les volateurs une action
instinctive, absolument, comme chez l'homme, de se servir des bras pour
équilibrer les jambes.
L'équilibre exact dans le sens de l'envergure n'existe jamais
complètement ; un côté est toujours plus lourd que l'autre, les surfaces, ne
sont pas exactement réparties. Les différences de poids et de surface ont pour
effet de faire pencher le côté le plus chargé ou le plus petit, ce qui revient
au même ; de là viennent ces ronds qui sont toujours décrits par les
aéroplanes, soit machine, soit oiseau.
Pour obtenir la marche rectiligne, il faut faire intervenir une force
corrective, qui dans l'aéroplane animé est la vie. Dans la direction aérienne
ce sera l'homme qui sera chargé de ce soin.
On pourrait produire la marche rectiligne automatiquement dans les
grands aéroplanes au moyen d'appareils électriques. Il suffirait pour cela de
faire produire les contacts par du mercure qui chercherait son niveau.
Quand on regarde attentivement un voilier se mouvoir dans un grand
courant d'air irrégulier, une chose qui frappe le regard, c'est la rapidité
avec laquelle le centre de gravité est déplacé pour satisfaire aux besoins de
la station et à la continuité de la direction. — Une bouffée de vent correspond
instantanément à une flexion des ailes, les pointes sont portées de suite en
arrière, le centre de gravité est par cette disposition nouvelle transporté à
l'avant, et neutralise par conséquent l'effet de déplacement à l'arrière que
produirait cette accélération de vitesse du courant d'air.
Cette manœuvre adroite, ponctuelle surtout, qui au premier abord semble
faire partie de l'action instinctive de l'animal, n'est cependant probablement
au fond qu'un effet de mécanique simple. On peut assurer que ce changement de
surface, ce transport d'équilibre, n'est nullement produit par un acte de la
vie des nerfs d'action, mais est tout simplement un phénomène d'élasticité des
muscles. — L'oiseau reçoit le choc du vent sans y prendre garde, son attention
est portée ailleurs, ses ailes sont étendues avec une force moyenne habituelle.
Si elles reçoivent une pression dépassant la tension des muscles, les pointes
cèdent, reculent à l'arrière, et font automatiquement la manœuvre nécessaire.
Dans les machines aéroplanes, il sera indispensable et très facile d'imiter
la nature dans cet acte : deux ressorts, d'une force calculée, maintenant les
ailes dans une position de stabilité pratique, rempliraient très bien l'emploi.
D'après ce que nous venons de voir, les oiseaux voiliers voleraient
souvent d'une manière inconsciente. — C'est au reste à quoi l'observation
attentive amène. Pour qui a bien étudié les planeurs, les trois quarts du temps
il n'y a chez eux ni force, ni volonté dépensée ; l'action directe de l'animal
se montre dans toute prise de décision, comme changement d'allure et de
direction.
Cet ordre d'idée porte à penser au sommeil en plein vol. — Assurément
aucun oiseau ne dort exactement en volant, mais cependant ceux d'entre eux qui
sont assez bien organisés comme surface pour passer six ou huit heures en
l'air, sans autre but que celui de se procurer de la fraîcheur, doivent arriver
à un état qui en approche beaucoup ; qui en tous cas est certainement,
quoiqu’en pleine action, un repos très réel. Cela doit être quelque chose de
comparable au sommeil debout du cheval, qui conserve assez d'action pour
satisfaire aux besoins de l'équilibre de la station sur ses quatre jambes.
Jusqu'où la mécanique automatique mènera-t-elle les aéroplanes ? Il est
facile d'entrevoir à première vue que l'homme n'aura guère à intervenir que
comme mise en marche, décision et arrêt, le reste du temps ses facultés
pourront se porter à autre chose, et certainement toutes les questions de
station se feront sans qu'il ait besoin d'intervenir à chaque instant.
DU
VOL THÉORIQUE
Serait-ce à croire que l'auteur a osé rêver la possibilité de dépasser
la nature dans les évolutions aériennes ?...
Assurément qu'avant de parler de faire mieux qu'elle, il conviendrait
d'essayer de l’imiter ; non pas comme ses maîtres dans l'art, mais seulement
comme les intimes. — Mais enfin, puisque sérieusement il y a pensé, et que
malgré la non-expérimentation il peut y avoir du bon dans ces réflexions, nous
oserons aborder la question du vol adapté à des combinaisons humaines.
Nous sommes poussés à l'envisager ainsi par la nature elle-même : elle
nous soulève par moment quelque coin du voile, dans certains exercices de ses
enfants chéris. Effectivement, quand on s'obstine à regarder l'oiseau, quand on
dépense à cette étude une somme importante de temps, d'action et de réflexions,
on est, rarement il est vrai, mais enfin quelquefois, de loin en loin,
récompensé par la vue d'une manœuvre qui vous fait rêver.
On se dit en la voyant : mais pourquoi l'oiseau, au lieu de se fatiguer
à tourner, à ramer, à se démener d'une manière impossible, comme il le fait
généralement, n'emploie-t-il pas toujours ce procédé si économique de force,
qu'il vient d'utiliser devant nos yeux ?
La réponse est simple : s'il y a un être pour qui, une fois en l'air,
temps est, nous n'oserions dire l’argent, mais vie, c'est bien l'oiseau. Ce
sentiment est chez lui irréfléchi ; il est provoqué ordinairement par le grand
excès de puissance qu'il possède, et comme rien n'est volontaire comme lui, il
ne sait résister au désir et y court au détriment de sa force.
La simple comparaison des différents genres de vol est déjà un pas fait
dans cette voie ; nous sommes arrivés à en choisir un comme plus abordable pour
nous, et plus à portée de nos moyens d'imitation. Avançons encore d'un autre
pas, et voyons dans les nombreuses manœuvres que fait notre type choisi, le
grand vautour, quelles sont celles qui sont les plus faciles à reproduire et
les plus avantageuses à notre individualité. Puis, tout en faisant ce choix, si
nous rencontrons quelque bonne idée, analysons-la froidement et sans timidité ;
en l'exagérant, nous arriverons peut-être à quelque chose de nouveau.
Assurément que, lorsque l'homme sera arrivé à se mesurer avec les
courants d'air, il apportera dans cet art son ingéniosité, qui lui permettra,
non seulement d'imiter la nature, mais même de la dépasser. — Ainsi, il ne lui
sera pas impossible de faire un voilier plus lent que le condor et l'oricou, et
un rameur plus véloce que la sarcelle : il le fera en exagérant les qu'alites
de ces vols différents. — Mais, où il brillera davantage, c'est dans l'étude
approfondie de la science du vol. Il ne sera pas distrait comme l'oiseau par le
besoin et la peur ; comme chez lui tout mouvement sera prévu et calculé, tout
obstacle à la vie vaincu d'avance, il n'aura à s'occuper que de sa manœuvre, et
il le fera résolument avec la science qui le caractérise.
Comme mode de locomotion, sans parler du chemin de fer, du bateau à
vapeur et du ballon, il a inventé deux procédés nouveaux, de toutes pièces, qui
n'ont aucune racine dans la nature : nous voulons parler du patin et du
vélocipède ; pourquoi alors ne perfectionnerait-il pas un sujet tout trouvé, et
que rien ne garantit être arrivé à sa dernière limite ?
Lorsque la première frayeur aura été surmontée, lorsque l'horreur du
vide sera maîtrisée par l'habitude, l'intelligence humaine, après avoir essayé
toutes les allures des oiseaux, voudra les perfectionner. L'homme alors se dira
: voyons s'il n'y a rien au-delà. — Alors, muni de surfaces excessivement
variables, il essayera l'ascension vent debout, il produira l'ascension vent
arrière, sans décrire de cercles, et surtout la marche en arrière.
Pour le vent debout, il y aura à étudier si l'ascension directe, même en
avançant sur le vent, comme cette manœuvre d'aigle déjà décrite, est plus
avantageuse par les bons vents que l'ascension en ronds en perdant du terrain
pour le regagner ensuite. Ce dernier procédé est celui employé ordinairement
par les oiseaux, mais comme nous savons qu'ils peuvent faire mieux, il faudrait
peut-être expérimenter. Les oiseaux sont comme tous les êtres inférieurs : ils
n'aiment pas travailler longtemps de la tête, et les ronds leur permettent de
se distraire à l'étude de la recherche de la pâture ; comme nous n'aurons à
nous occuper que d'aller le mieux possible, et que nos facultés de combinaisons
sont autrement puissantes que les leurs, cette attention ne sera pour nous
qu'un jeu.
Pour le vent largue, rien n'est plus simple, il n'y a pour ainsi dire
qu'à se laisser porter. Les voiliers dans l'exécution de cet exercice ont l'air
heureux ; on sent qu'ils ne travaillent ni de corps ni d'esprit, surtout si le
vent est assez actif pour bien porter. S'il est faible, il faut en venir aux
ronds de temps en temps ; mais quand il est suffisant, c'est certainement le
système de marche le plus commode et celui qui sera le premier réussi par
l'homme. — Ce sera en tous cas l'ordre de marche qui suscitera le moins
d'embarras, et que l'homme utilisera autant que l'oiseau s'en sert peu, étant
toujours trop pressé d'arriver.
Un vent vif doit pouvoir permettre l'ascension directe, vent arrière, en
présentant la tête et se laissant enlever et reculer ; et même en présentant la
queue, c'est-à-dire filant avec le vent par l'accalmie et offrant un angle en
piquant légèrement de la tête par le coup de vent. — Ces deux procédés nous
sont indiqués par les voiliers, mais si rarement qu'on peut dire qu'ils ne sont
pas dans leurs cordes. — Par les bons vents, lorsqu'on aura à aller où le
courant d'air mène, l'ascension et la marche ne se feront pas autrement.
En somme, en admettant qu'on ne trouve rien d'exactement nouveau, il
n'en restera pas moins un choix de manœuvres, exécutées spécialement par
l'homme, qui constitueront ce qu'on devra nommer le vol type humain.
Résumons-nous donc, et disons :
Quand un corps entre en mouvement, son centre
de gravité se déplace dans le sens du mouvement d'une quantité qui est
proportionnelle à la vitesse.
La direction aérienne peut être obtenue de deux manières dans l'ordre
d'idées du plus lourd que l'air :
1° Par des machines à propulseurs ;
2° Par
des aéroplanes sans propulseurs.
La première série est tout à fait hors de ce cadre ; la mécanique, en se
perfectionnant, arrivera à une foule de solutions différentes telles que :
ailes de rameurs, hélices, fusées, etc.
La deuxième manière, c'est-à-dire l'aéroplane sans propulseur, est
l'objet de la présente étude. Ce qui est démontré dans le courant de cet
ouvrage permet d'affirmer :
Que dans le vol des oiseaux voiliers (vautours, aigles, oiseaux
qui volent sans frapper l'air) l’exhaussement est produit par l'emploi
adroit de la force du vent, et la direction par l'adresse ; de sorte qu'avec un
vent moyen, on peut avec un aéroplane qui n'est pourvu d'aucun appareil pour s
'exhausser, s'élever dans les airs et se diriger, même contre le vent.
L'homme peut donc avec une surface rigide, bien organisée pour
pouvoir être dirigée, répéter les exercices d'ascension et de direction que
font les oiseaux planeurs, et n 'aura à dépenser en fait de force que celle
nécessaire à la direction.
Quant à la forme de ces aéroplanes, nous n'en parlerons pas à ce
chapitre parce que le problème peut être résolu, comme on le verra, par une
foule de formes et moyens différents. Cependant tous ces appareils, quoique
très dissemblables, sont tous basés sur cette idée :
L'ascension est produite par l’utilisation adroite de la puissance du
vent, et nulle force autre n'est nécessaire pour s'élever.
Certainement qu'il sera bien difficile, pour beaucoup de gens,
d'admettre qu'un oiseau, par un vent moyen, peut rester une journée entière
dans les airs sans dépense de force. On essayera de faire intervenir des
pressions indiscernables, des battements imperceptibles. — Il est de fait que
l'esprit humain ne se prête pas facilement à admettre cette affirmation ; elle
l'étonné ; il cherche à s’en défendre au moyen de toutes les échappatoires
qu'il pourra trouver. — Tous ceux qui n'ont pas vu, lorsqu'on leur parle de
l'ascension sans dépense de force, ont de suite à la pensée la phrase suivante
: il y a des mouvements qui vous ont échappé.
Il arrive même que l'observateur superficiel ou d'occasion, qui s'est
trouvé de par le hasard en face cette évolution bien exécutée, en y repensant
plus tard, sent le doute envahir son entendement ; le fait lui semble si
insolite, et un tel contre-sens, qu'il se demande s'il a bien vu.
Cette observation, pour être indéniable, demande à être faite, et cela
absolument, sur les très grands vautours seulement ; et voici pourquoi : c'est
parce que les autres oiseaux qui s'élèvent par ce procédé dans les airs
n'exécutent pas ce problème de décomposition de force dans toute sa simplicité.
Si nous étudions les petits oiseaux, nous voyons des volateurs de 50 grammes,
martinets, guêpiers, par certains temps d'orage, se livrer à cette manœuvre
lorsqu'ils sont très haut. Mai, les aurait-on étudiés à la lunette, avec toute
la précision désirable, comment ne pourrait-il pas rester de doute, lorsqu'on
songe à la puissance du martinet, qui, d'une simple pression de ses pectoraux,
peut dans certains cas se projeter à plus d'un mètre.
Les milans, buses, busards, lorsqu'ils se haussent en tournant, ont un
vol assez compliqué pour permettre au doute de venir ; cette manière
particulière de présenter le plan d'une aile sous un angle différent de celui
de l'autre embrouille l'analyse et prête à toutes sortes d'échappatoires.
Le percnoptère, le petit aigle, ont des irrégularités dans l'ascension
qui autorisent presque la discussion, surtout lorsqu'on ne les a
qu'accidentellement sous les yeux.
Les cigognes, les grands oiseaux de mer ne sont pas concluants.
Il faut, pour arriver à la démonstration rigoureuse, indéniable,
dépasser le grand aigle, qui se prête peu à ce genre d'étude, et arriver
absolument aux vautours.
La théorie n'ouvrait pas cette voie ; puis, on peut considérer comme
lettre morte son dire, lorsqu'il s'agit d'un fait aussi grave que celui de lui
confier son existence. L'observation a une action morale infiniment plus
persuasive ; seulement, hélas ! elle est impossible dans la plupart des
cas. — Ce n'est assurément pas à Paris qu'on se convaincra ; ce n'est même pas
en Europe, où les modèles sont si rares, qu'on peut passer des mois sans les
rencontrer.
C'est en résumé une voie nouvelle tracée à l'étude ; c'est celle par
laquelle nous sommes arrivé, et que devront suivre absolument tous ceux qui
voudront persuader. En s 'y livrant, on verra se reproduire tous les faits que
nous avons relatés sur le vol des oiseaux, et probablement encore d'autres qui
nous ont échappé.
Il faut absolument avoir vu ; car voir, seulement une fois, vaut mieux
que tout un volume d'explications. Alors, dans ce cas, lecteur qui vous
intéressez à cette recherche, allez voir, faites ce qu'il faut pour vous
édifier. Cherchez les pays où se rencontrent les modèles qui produisent ces
démonstrations ; et quand vous les aurez vus quelques instants, étant déjà
initie, la compréhension viendra tout de suite.
APPLICATION
Nous voici arrivés à l'application.
Il s'agit d'imiter ce que nous avons vu et ce qui nous a été démontré.
Pour bien imiter, il n'y a qu'à se laisser aller tout simplement ; les
modèles sont là, prenons le meilleur, celui qui s'adapte le mieux à nos désirs,
à nos aptitudes, et reproduisons-le.
Faisons donc notre choix dans cette série d'êtres.
La première question à se poser est celle-ci : Quels sont nos besoins ?
que voulons-nous être ? que voulons- nous pouvoir faire ?
Les rameurs sont nécessairement mis de côté, puisque nous n'avons pas la
puissance ; la question est donc de suite simplifiée de moitié.
Mais ensuite, dans cette série de types de voiliers, lequel devons-nous
prendre ?
A coup sûr celui qui dépense le moins de force, car nous n'en avons que juste
ce qu'il faut pour la direction.
Les vautours sont donc tout indiqués comme modèles : en effet, que
désirons-nous ? pouvoir monter sans fatigue, par un vent ordinaire, et de là
nous diriger où nous voulons.
Si nous avions à braver l'orage, il faudrait prendre les voiliers à
ailes étroites, mais nous n 'en sommes pas encore là, nous voulons nous
contenter de stationner aisément dans l'atmosphère ; et si le vent devient trop
fort, fuir sans honte devant lui et nous mettre à l'abri.
Nous n'avons ni à faire des manœuvres difficiles comme les autours ou
les oiseaux de nuit, ni à reproduire des exercices de lutte comme l'aigle, mais
tout simplement à aller comme nous pourrons, le plus simplement possible, par
un temps de choix.
II est donc rationnel que pour les premiers essais nous prenions pour
objectif les grands voiliers, que nous exagérerons pour augmenter la
sustention, afin de pouvoir être de suite en plein vol, et surtout pour n'avoir
pas à craindre, lorsque nous voudrons nous poser, ces chocs qui sont la
répulsion de l'instinct humain.
L’appareil y perdra certainement comme maniabilité ; il ira moins bien
contre les vents un peu accentués ; mais pour commencer, c'est bien suffisant.
—Plus tard, lorsque nous serons habitués à avoir le vide au- dessous de nous,
nous corrigerons ces petits défauts.
Voici un résumé de mes essais. — Ils aideront à faire comprendre les
difficultés qu'il y a à créer une machine simple, quand on est constamment tenu
en lisière par deux questions de base, dont il faut à chaque instant tenir
compte : je veux parler du poids et de la résistance des matériaux.
Je laisse le côté anecdotique, qui a cependant eu une importance énorme
; mais ces peines et ces écœurements importent peu à 1’humanité ; elle ne
demande à connaître que les résultats.
Voici les principaux essais que j'ai faits ; je les juge bien
froidement, étant à vingt-cinq années de distance du premier.
PREMIER ESSAI
Un bâti léger, en perches souples et fortes de châtaignier, ayant la
forme du corps d'un oiseau.
J'étais placé horizontalement, le torse supporté par une toile. Les
jambes manœuvraient des cordes qui passaient sur des poulies et faisaient
mouvoir les ailes. Cet appareil n'a pas été fini ; il était mal conçu ; les
bois pliaient, les poulies coupaient les cordes ; c'était une ébauche.
J'étais trop influencé par les rameurs, c'était un mélange du planeur et
du rameur. J'ai abandonné.
DEUXIÈME ESSAI
Poussé beaucoup plus loin que le premier.
Un bâti en bois, remarquablement
fait comme légèreté et puissance, recouvert d'une feuille de caoutchouc afin de
pouvoir l'essayer sur l'eau.
J’étais debout, actionnant les
ailes par un mécanisme assez défectueux que je passe.
Les proportions de l'appareil étaient assez grandes.
Là, j 'ai commencé à me heurter contre un écueil terrible, qui m'a causé
alors et depuis bien des déconvenues ; je veux parler du fléautement.
Lorsque j'ai mis en mouvement les bâtis des ailes, il y a eu des
ruptures ; ils n'ont pas pu résister. Abandonné.
Lorsqu’on s’attaque au fléautement, on a toujours des déconvenues, parce
qu'on est retenu par le poids, et qu'il est difficile de faire fort sans faire
lourd.
Ces échecs font reporter les yeux sur les de œuvres la nature ; on
étudie alors les moyens qu'elle emploie pour trancher cés difficultés.
Elle est comme toujours miraculeuse ! il ne reste qu'à se prosterner
devant ses merveilles.
Je me bornerai à appeler l'attention sur quelques-unes, sur une rémige
de martinet par exemple, qui, brisée, éraillée, se redresse, se répare toute
seule, par son élasticité, sa vie propre, et qui au premier frottement se remet
en place.
Un humérus de pélican est un gros os qui a un poids négatif, si
j'oserais m'exprimer ainsi. Quand on le prend, son poids surprend comme le fait
une masse d'aluminium qu'on soulève. Il n'a pas la pesanteur naturelle ; et
cependant sa résistance est étonnante ; elle est due à une série d'aiguilles en
os, qui le traversent dans tous les sens et font autant d’arcs boutants.
Et lorsqu'elle se mêle de faire des tissus et des ressorts, quelle
perfection ! — Les oiseaux ont un tendon élastique, qui part de la tête de
l'humérus et va s'attacher à l'emmanchement de la main ; ce qui fait pour un
pélican une longueur de 60 centimètres. C'est une corde élastique à tension
égale ; chose rare.
Quant aux tissus, c'est la feuille de caoutchouc vivante : voir et
palper, pour s'en faire une idée, les ailes des grandes chauves-souris, ou
seulement la poche d'un pélican.
Cet essai était un progrès, il y avait bien toujours l'influence du
rameur, mais, par la position debout, j'attaquais sérieusement la question du
déplacement du centre de gravité. — Les articulations des ailes étaient bien
pensées ; cependant j'avoue que c'était autant l'instinct qui m'avait poussé à
les faire que le raisonnement. — Le fruit n'était pas exactement mûr.
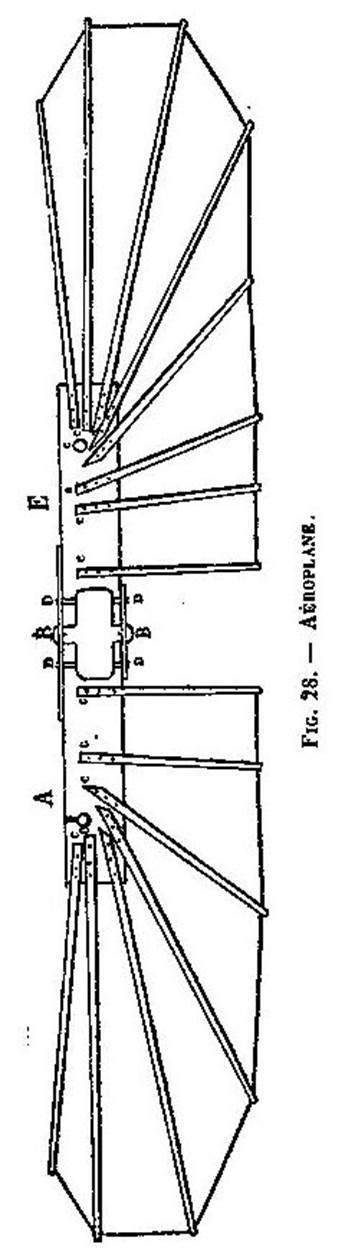
TROISIÈME ESSAI
Influencé par la déconvenue du deuxième essai, je combinai l'aéroplane
suivant :
Deux ailes parfaitement réussies comme légèreté.
Elles étaient construites en hampe de fleur de grand agave ; bois très
léger, fibreux et résistant. Il n'y a pas en Europe des matériaux de cette
qualité : je ne connais que le nambag du haut Nil qui soit plus léger. —
La densité du premier est environ quatre fois celle de la moelle du sureau, et
celle du second deux fois seulement.
Voici les détails de l'appareil (fig. 28) : AE, humérus, radius et
cubitus, figurés par deux planches évidées et renforcées, sur lesquelles
venaient se fixer c,c,c,c... les hampes d'agave ayant une bonne
courbure, amincies, remplissant parfaitement l'emploi.
Les deux ailes étaient reliées entre elles en BB par deux charnières,
malheureusement trop élémentaires. Je me plaçais dans l'espace C, suspendu par
des courroies fixées en D. Deux courroies me passaient sur les épaules et deux
autres entre les jambes.
Aux points EE venaient se fixer deux barres de bois qui s'attachaient à
mes pieds et servaient à actionner les ailes.
Étant debout, muni de cet appareil, j'avais la charnière de devant à la
hauteur du creux de l'estomac, les deux bras appuyant sur chaque planche et
fixés par des courroies.
Le transport du centre de gravité se faisait en me déplaçant à la force
des bras dans l'espace C.
L'appareil pesait 15 kilog. : c'était trop léger, les bois étaient un
peu faibles ; ils avaient craqué sous l'action d'essais violents de la force de
mes jambes.
Il y avait du bon dans cet aéroplane, mais il avait été fait trop
précipitamment. — L'essai fut fait par un vent trop fort ; je ne voulais pas me
montrer, je fus obligé de saisir un moment où j'étais seul. — Je me mis donc
dehors avec mon appareil, je courus contre le vent : la sustention était très
forte.
Je n'avais pas confiance, je l'ai dit, en la solidité de mon aéroplane.
— Un coup de vent violent survint : il m'enleva ; je pris peur, je cédai devant
lui et me laissai renverser. — J'eus une épaule luxée par la pression des deux
ailes, qui avaient été ramenées l'une contre l'autre comme celles d'un papillon
au repos.
Des circonstances, qu'il est inutile de relater, firent que je ne pus
renouveler ces essais.
Il y avait du bon dans cette expérience. — Si j'avais été libre de
recommencer avec le même appareil, renforcé, j'aurais repris confiance, surtout
en essayant sur l'eau, afin de ne pas craindre la chute ; et je crois que, tout
imparfait qu'il était, j'en aurais tiré quelque chose d'intéressant, malgré
l'insuffisance des déplacements, et par cela même de la direction.
QUATRIÈME ESSAI
10 mars 1878. — Je vais le mettre sur chantier.
Je crains que ma mauvaise santé ne me permette de le mener à bien.
A six mois.
Août 1879. — Une année et plus est passée, et je n'ai rien pu produire.
Je renonce. Je me rends.
Voici ce que je voulais faire ; c'est le même appareil que le troisième
essai, mais perfectionné.
Je remplace les planches renforcées qui faisaient fonction de bras, par
une espèce d'échelle double ; ces planches étaient trop légères, pliaient,
n'avaient pas une tenue suffisante (voir fig. 30). Elles sont à angle plus
prononcé que ne l'étaient les planches précédentes ; c'est pour donner plus de
base à l'appareil.
Les points d'attache des ailes et de suspension du corps sont réunis,
simplifiés, et offrent plus de sécurité.
Les attaches des bretelles et des courroies de suspension, qui étaient
fixées aux bois, aussi près que possible de l'axe de flexion, sont maintenant
fixées à l'âme même de la charnière ; il n'y a donc plus de force perdue.
Ces attaches sont multiples pour pouvoir offrir toute la sécurité
désirable (fig. 29).
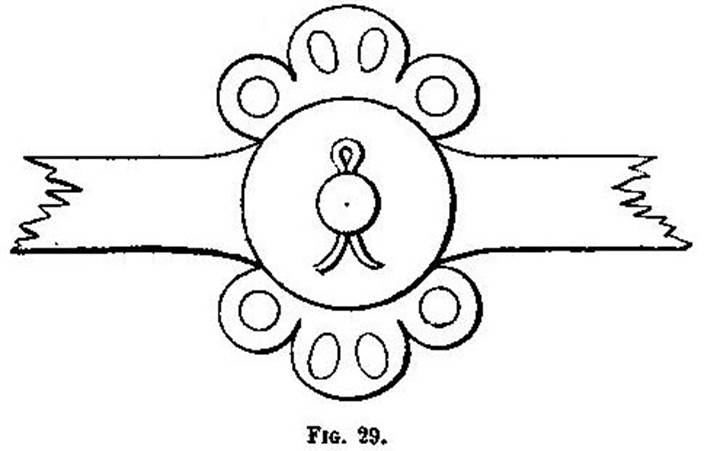 L'espace destiné à recevoir le corps est
toujours vaste, de manière à pouvoir permettre, sous l'action des bras, les
déplacements du centre de gravité.
L'espace destiné à recevoir le corps est
toujours vaste, de manière à pouvoir permettre, sous l'action des bras, les
déplacements du centre de gravité.
Après mûre réflexion je suis arrivé à trouver ce moyen de direction
insuffisant, surtout pour les changements brusques de direction verticale. J'ai
cru obligatoire de lui joindre la flexion des ailes, pour pouvoir manœuvrer
sérieusement, et n'être pas à chaque instant en perdition et obligé de mettre
l'appareil en V.
Le point difficile, l'écueil est la charnière. — J'en ai trouvé
plusieurs très bonnes, mais trop compliquées.
Tout bien réfléchi, une charnière simple peut suffire, à la condition
d'y joindre l'appendice A qui fait levier et la fixe (voir fig. 30).
Cette planchette fait l'office de main, les rémiges y sont fixées. Je
les fais cette fois en gros joncs de 3 centirn. de diamètre et longs de 2
mètres : on en colle deux ensemble et on les taille dans la forme désirable.
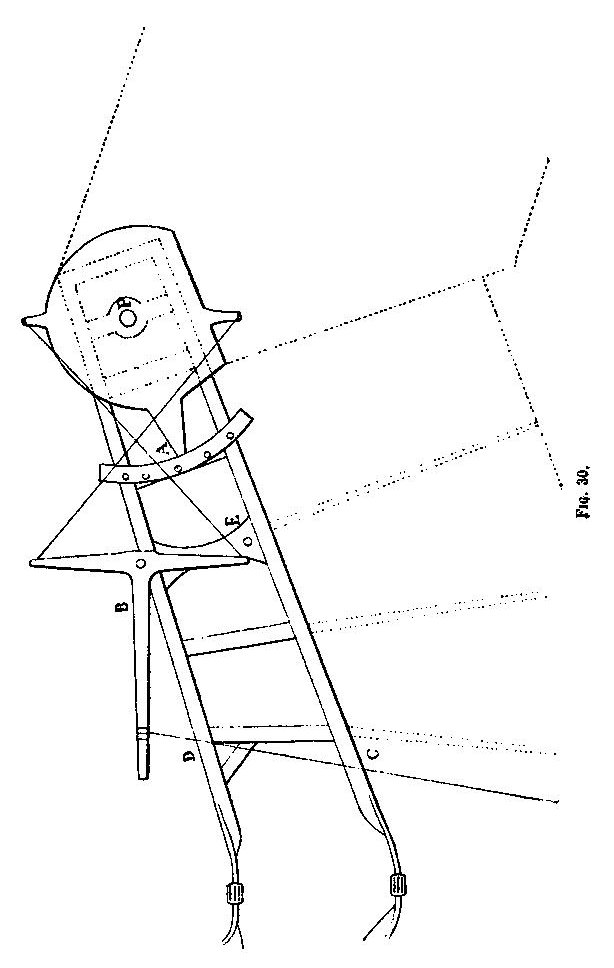
Ces joncs sont bon marché, ils ne valent aux Indes que 50 cent. l'un.
Pour actionner la main, on peut se servir de ce système qui est tout à
fait simple (B, fig. 30).
Effectivement, en repoussant les manettes, on commence par se repousser
soi-même contre la charnière d'arrière, ce qui fait reculer un peu le centre de
gravité ; puis, en forçant, l'aile est obligée de tourner sur son pivot P et le
bout de l'aile est amené en avant, ce qui reporte encore en arrière le centre
de gravité.
Ces deux mouvements se complètent, ils commandent même la queue, comme
on peut le voir sur la figure d'ensemble. Cette queue a pour point d'attache
les bouts des barres c,c'. Elles n'existaient pas dans l'essai précédent, je
les ai ajoutées pour donner plus de stabilité à l'appareil. Les ailes sont
actionnées par les bras qui ont des attaches en C pour les coudes, et en D pour
les mains ; ils feront plutôt leur partie dans la direction que dans les
courtes ascensions qu'on pourra se permettre.
Comme il faut tirer parti de tout, qu'on peut avoir besoin, pour partir,
de s'aider de quelques battements, j'ai pensé que les jambes et les reins, qui
sont si puissants, pourraient donner la sustention pendant quelques instants :
comme, par exemple, donner quelques coups d'ailes pour le départ ou l'arrivée,
ou encore, pour accélérer la marche ou la soutenir au besoin, de manière à
permettre un abordage commode.
Elles sont donc actionnées par les jambes, voici comment :
A la chaussure sont fixés des étriers portant une boucle. A celte boucle
viennent se fixer deux joncs par des pitons, qui ont leur attache à une partie
résistante de l'aile, au point E (fig. 30). Comme, en les tirant, les pieds
tendent à s'écarter, on les réunit au moyen d'un crochet et d'une boucle fixés
à la hauteur de la malléole interne. D'un mouvement on peut les déclencher, ce
qui alors rend la marche possible.
Ces deux joncs, qui sont réunis comme le serait un bâton qui serait
fendu dans le sens de sa longueur, transmettent la tension d'abaissement de
l'aile sans difficulté ; ils font alors l'effet de cordes. Quant à la pression
de relèvement qu'ils ont à communiquer à l'aile, il se présente là une
difficulté : il faut qu'ils remplissent l'office de barres rigides dans tous
les cas autres que celui de l'abordage, où ils doivent alors remplir le rôle de
ressorts.
Pour obtenir ces deux effets divers et contraires, il faut pouvoir lier
rapidement ces deux joncs : on y parvient en faisant glisser un anneau qui
vient les unir. — Dans le cas d'abordage, on relève l'anneau au moyen d'une
corde, et alors les deux joncs, pouvant s'écarter, esquivent ainsi les
secousses terribles des atterrissements qui briseraient l'appareil.
Il y aurait encore à décrire une foule d'accessoires, tels que : engin
pour éviter le trop grand écartement des ailes, moyen de les fixer dans une
position de marche pratique, de manière à pouvoir prendre une position plus
commode et plus rationnelle pour le vol,
etc., etc.
Le cadre de cette étude ne comporte pas tous ces développements, il faut
nous restreindre ; et cependant, qu'il y aurait encore à dire !...
Je me suis bien rendu, c'est vrai, mais comment s'y résoudre ?
Comme je vais mieux, je vais me remettre à l'ouvrage.
Je fais quelques changements de détails que voici : après avoir bien
raisonné, pesé toutes les difficultés, vérifié tous les écueils, j'en suis
arrivé à penser que, pour éviter les chocs, il faut posséder une très grande
surface : témoin les échassiers.
Cette grande surface doit être expérimentée par un temps calme, parce
qu'elle est difficile à manier, surtout lorsqu'on n'en a pas l'habitude. Elle
doit être essayée sur l'eau, afin d'avoir son sang-froid ; car il est essentiel
de ne pas le perdre dans ces moments, et il n'y a rien de tel, pour le
conserver, que d'être sûr de ne se faire aucun mal.
Pour la produire, je remplace les joncs qui ne permettent pas de
construire des rémiges bien longues, par des bambous avec lesquels je pourrai
en obtenir de légères et solides de 5 ou 6 mètres.
Nous aurons donc : bras 2 mètres ;
mains 6 mètres ; soit donc : 6+2=8x2=16. Admettons 3 mètres de largeur moyenne
de l'aile ; qui donnera une proportion de 5.03 : 1, représentant à très peu
près celles : de l'étourneau 5.05, du
biboreau 5.20, du corbeau 5. 37. Nous aurons donc pour surface x 163=48.
L'appareil pèse 25 kilog. ; mon individu 60 ; soit 85.
Le mètre carré est donc chargé de 1770 grammes, charge excessivement
minime, qui correspond au rollier, 1766 grammes ; à la roussette 1748 : c'est
moins que le martinet 2073, que les mouettes 2000 à 3000 grammes, que le
vanneau 2024, et par conséquent que tous les oiseaux moyens. Quant aux gros,
leur charge par mètre carré varie de 4 à 7 kilogrammes et plus.
Nous sommes donc sûr d'être supporté avec beaucoup d'aisance par cette
surface, et déposé à terre ou à l'eau sans une trop forte secousse. Au reste,
rien n’est plus facile que de faire d'abord l'essai avec une pièce de bois de
85 kilog., densité 1, et d'étudier sa marche.
Je pendrai l'aéroplane chargé à une grande vergue de bateau ; on le
hissera aussi haut que possible, et de là-haut on l'abandonnera à sa chute. —
Lorsqu'il se sera bien retourné, qu'il sera réglé de manière à produire une
course horizontale satisfaisante, je me mettrai il la place du poids d'essai et
je me livrerai à mon tour à la chute.
S'il y a le moindre vent, sa force, la mienne, et surtout une bonne
présentation des surfaces utiles, me permettront, j'en suis sûr, d'aller plus
loin.
Il est plus que probable que la première fois je serai surpris, j'irai
peut-être moins loin que le tronc d'arbre mon prédécesseur ; mais on s'habitue
à tout, même à une descente précipitée, et petit à petit, l'habitude aidant, un
coup de vent un peu plus fort arrivant, je dois finir par me lancer
complètement. Une fois au grand vol, bien parti, ayant l'espace devant moi et
l'eau au-dessous, je crois que cela ira si bien que le difficile sera de
s'arrêter.
On ne peut douter de la possibilité du départ. Pour le forcer, pour le
rendre inéluctable, il n'y a qu'à partir par un grand vent ; on est sûr d'être
emporté : j'en sais quelque chose !...
Mais, autre est d'être emporté comme un chiffon, que le vent roule et
retourne, autre chose est de se mouvoir consciemment dans ce courant d'air ; le
fait n'est même peut-être pas possible avec cette grande surface. Pour résister
il ce vent violent, il faudra des appareils plus solides, moins vastes, et par
conséquent plus maniables ; et enfin, une habitude donnée par une longue
pratique.
Avec cet appareil plus rationnel, il est clair que si on porte
rapidement les pointes en avant, et que le vent ait assez de force, on doit
être enlevé.
Une fois parti, le reste est une question de savoir. Le vent soulèvera
l'aéroplane, lui fera faire un saut assez haut, et il ira retomber en arrière
si les pointes restent en avant. Mais si, au plus haut de ce saut, les pointes
sont reportées en arrière, d'une quantité à chercher par le tâtonnement, la
course en arrière sera finie, et l'aéroplane restera ou stationnaire ou ira
tomber en avant.
Là est le tour d'adresse à bien exécuter : il faut se pénétrer de cette
manœuvre et la faire en maître. Sur l'eau, — elle sera peu dangereuse ; on en
sera quitte pour un bain si on la manque, mais sur terre elle ne doit être
employée que quand on sera complètement maître de son appareil.
Les oiseaux se servent souvent de ce procédé : on voit alors d'énormes
masses s'élever sans le moindre effort tout comme le ferait un ballon. Ils sont
là, quelquefois pour aborder une pointe, obligés de monter et de descendre, de
se poser, de se réenlever plusieurs fois avant de se sentir bien en position de
station ; mais, nous le répétons, il faut absolument une grande surface et un
grand vent.
Cependant, en observant bien, on voit quelquefois les grands voiliers
employer ce procédé de départ par un vent moyen ; ils ont alors le soin de
développer tout ce qu’ils peuvent produire de surface.
AÉROPLANE A MOTEUR
Pour éviter cette gymnastique qui n'est acceptable que par un certain
âge et une certaine puissance musculaire, il faut songer à un appareil
demandant des exercices moins violents. Il faut aussi penser aux dames, car
l'aviation sans elles serait une œuvre boiteuse.
Il faut donc nous adresser aux machines, qui seules pourront procurer la
force nécessaire au départ et à l'abordage.
Le désideratum de la direction aérienne est, nous l'avons dit, une
machine pouvant partir par un temps calme de la surface de l'eau. Nous disons
temps calme, parce que plus il y aura de vent, plus il y aura de facilité à
s'enlever.
Sur l'eau toutes les conditions pratiques sont réunies. L'abordage est
facile, il s'opère presque sans précaution, le sommier est ample. Il n'y a pas
de pays au monde où dans cinquante lieues carrées il n'y ait de mer, de lac ou
de fleuve. Un simple étang de 300 mètres suffit. On est à l'abri des surprises,
et toujours en bonne position pour partir.
Comme écueil, il y a la tempête et le requin sur mer, encore son attaque
est-elle problématique ; il n'est pas sûr du tout qu'il ose entreprendre de
s'assimiler un appareil aussi grand.
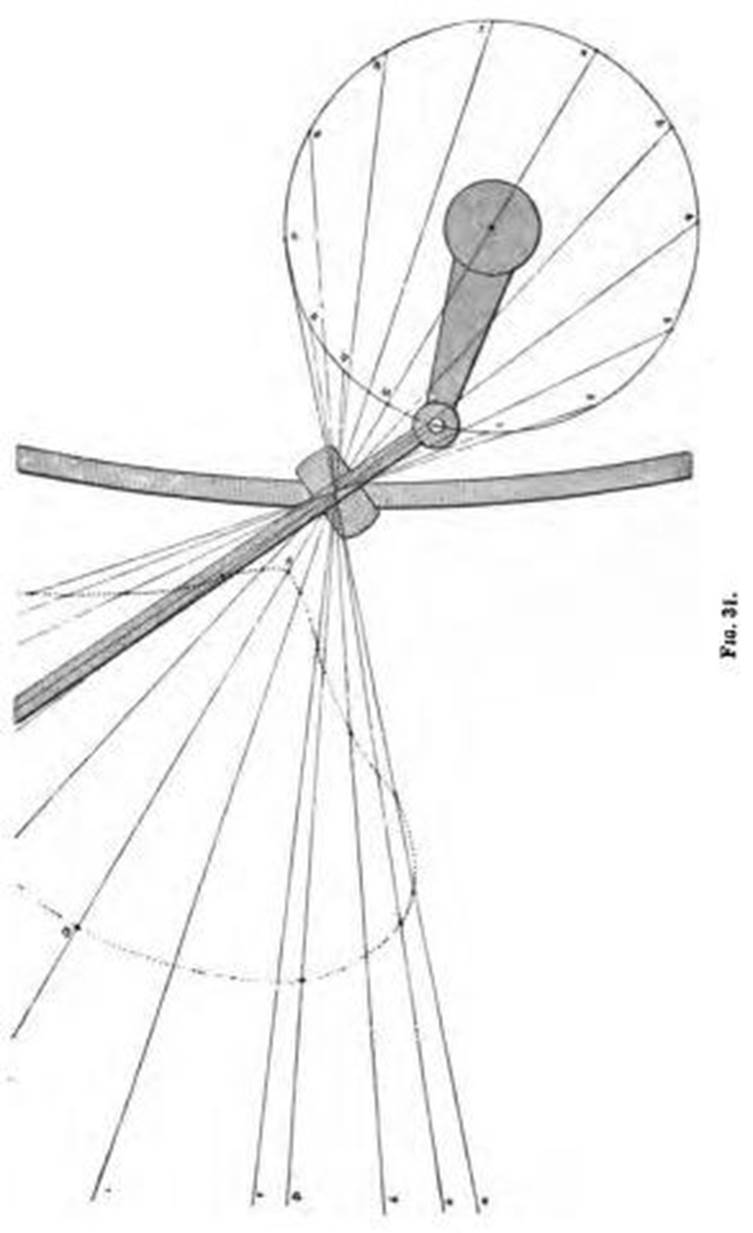
Quant à la tempête, comme elle a toujours de grands vents, elle
transporte vite ; et ensuite, dans ces grandes machines, il sera possible de se
relayer et d'aller jour et nuit, par conséquent voir beaucoup de pays et de
points où l'abordage est possible.
Voici, au reste, l'appareil que je construirais si j'avais le temps et
les moyens de le faire.
Sur un bâti puissant, en ormeau, châtaignier ou bambou, le plus
résistant possible, je fixerais une enveloppe légère en osier, ayant la forme
du corps d'un oiseau.
Cette forme d'osier serait recouverte d'une feuille d'aluminium, de
manière à faire bateau.
Sur le bâti solide je fixerais une de ces petites chaudières
américaines, à surface de chauffe énorme, de Herreshoff, qui serait destinée,
par son piston, à actionner :
Un propulseur construit de la
manière suivante (fig. 31) :
Il est facile de voir, par le graphique de chaque position de marche,
que cette machine produit les mêmes effets que ceux produits par la patte du
palmipède : c'est la patte de l'oie simplifiée.
En même temps, le piston actionnera les ailes, et procurera ainsi le
battement.
Par l'emploi d'un débrayage simple, il sera facile de mettre toute la
force sur le propulseur ou sur les ailes, ou sur les deux appareils à la fois.
On peut donc maintenant saisir la marche de cette machine.
Lorsque la pression est suffisante, les pattes agissent de manière à
donner une marche en avant et en même temps soulever l'appareil. Ce soulèvement
est augmenté par l'action des ailes qui battent ensemble : il doit y avoir
course au bout de sept ou huit coups de ces rames-support, et finalement
l'appareil doit reproduire ce que les oiseaux d'eau font lorsqu'ils s'envolent
de la surface de l'onde.
A propos de ces chaudières Herreshoff, on pourrait craindre de ne pas
pouvoir, ce qu'on appelle en termes de mécanicien s'alimenter. — Cela est vrai,
surtout si on considère que le piston est énorme, hors de toute proportion avec
la chaudière qui lui fournit la vapeur, et que par conséquent il doit user
beaucoup plus de vapeur qu'elle ne pourra lui en fournir. — Mais ce qui semble un
danger n'en est pas un. Le piston est ainsi volumineux pour pouvoir dépenser le
plus de force possible en peu de temps. — Il faut qu'il puisse fournir
cinquante battements. — Après cet effort, si on n'est pas en route, on ne le
sera jamais. — Une fois ces cinquante battements fournis, et probablement il
n'y en aura besoin que de vingt ou vingt-cinq, mais très énergétiques, la
machine n'a plus besoin de tant d'activité : le jeu des rames est supprimé, les
ailes fonctionnent plus ou moins longtemps suivant les besoins ; mais il faut
penser que cent battements doivent mettre l'appareil en pleine course, et par
conséquent en position de pouvoir planer ; sinon, c'est qu'il ne fait pas assez
de vent pour se tenir en l'air; il faut alors faire comme les grands voiliers
par le temps calme, c'est-à-dire rester à terre.
Une fois les manœuvres de planement attaquées, la pression remonte vite
dans la chaudière, et si le temps est bon, elle peut être tenue sous ses feux,
car les battements ne doivent plus être utiles et doivent être remplacés par la
direction intelligente.
Ces considérations font comprendre la possibilité de marcher avec une
aussi faible chaudière.
La provision de combustible n'aura pas besoin d'être énorme pour un
voyage ordinaire.
Quant à l'eau, il n'y a aucune difficulté à en faire en marche, au moyen
d'un tube recourbé en avant qu'on fera plonger dans l'eau d'un fleuve, d'un lac
ou de la mer au-dessus duquel on passe : la vitesse excessive de la marche fait
remonter l'eau jusque dans la caisse destinée à la contenir. Au reste, ces
grandes machines auront une puissance de sustention très grande, qui permettra
de faire des provisions d'une certaine importance.
Quant aux ailes, ce serait toujours le même système : humérus, radius et
cubitus d'une seule pièce, et main mobile, mue par le procédé des cordes, qui
est assurément le plus pratique de tous ceux que j'ai rêvés. — Il y a cependant
une petite difficulté à tourner, qui est celle de faire concorder cette action
de direction avec le mouvement des ailes : on y arrive facilement, avec un peu
d'adresse.
Avec un pareil aéroplane à moteur on peut attaquer de bien grands
voyages.
La question d'alimentation de la machine et la question de l'eau sont
élucidées ; reste celle des provisions de bouche. Elles peuvent se réduire à
des extraits de viande, coca, café : enfin, vivres sous une forme réduite. Il
faudra, pour se procurer des vivres sérieux, se livrer à la chasse, ce qui
devra être très facile lorsqu'on peut embrasser comme on le pourra une immense
surface où il sera facile de choisir un territoire de chasse giboyeux.
Avec un véhicule pareil on doit pouvoir fournir les plus grandes
excursions que notre globe peut présenter sans se fatiguer et sans dépasser les
bornes de la prudence : ainsi, le continent africain, les deux pôles, dans la
saison favorable, les grandes mers, tout cela peut être franchi en peu de
temps. — On trouvera très souvent des vents d'une durée de trois jours complets
: soit 4,320 minutes, qui, s'il n'est pas trop contraire, permettront de faire
au bas mot de 2,500 à 5,000 kilomètres, soit le 1/8 du tour de la terre.
Un pareil parcours est plus long que toutes les expéditions qui
actuellement demandent des années de fatigue et une énergie qui n'est pas
toujours suffisante pour préserver les voyageurs de la mort.
Les passagers de cette machine aérienne ne seront pas bien nombreux ;
deux ou trois seront certainement la quantité qu'elle pourra contenir. — Ils
seront tenus à une immobilité assez précise, afin de ne pas troubler par leurs
mouvements les manœuvres de celui qui a la direction.
On ne sera assurément pas là-dedans comme dans un salon, mais ces
voyageurs auront cependant infiniment plus de confortable que les pauvres
malheureux qui par amour de la science ou de la renommée vont se faire geler
dans les glaces du pôle ou se faire manger par les cannibales de l'équateur de
l'Afrique.
Certainement qu'on peut aspirer à faire encore mieux que cette machine
mal commode, on peut aller jusqu'à penser au salon et à la couchette tout comme
dans les bateaux. On peut même aspirer à la direction presque exactement
automatique. Mais, cependant, il faut reconnaître qu'il y aura toujours une
difficulté qui entravera d'une façon absolue la construction des très grands
appareils, et finira par leur tracer une limite : c'est la résistance des
matériaux qui sera la barrière qu'on ne pourra franchir. — Cependant, en
employant les tubes d'aluminium et les jeunes bambous géants, on peut entrevoir
la possibilité de la construction d'aéroplanes de 20 mètres d'envergure, qui
dans la proportion de 5 : 1 donneront environ 80 mètres carrés de surface, et
pourront supporter 750 kilogrammes.
Avec une pareille marge on peut faire beaucoup de choses très curieuses
comme construction et installation.
Comme on le voit, c'est toujours le même principe et ce sont les mêmes
moyens employés : c'est toujours sur le déplacement du centre de gravité que
repose cette machine, tout comme chez nos maîtres les oiseaux. — Quant au
moteur, il peut changer ; on peut employer une machine à acide carbonique, à
poudre, à ce qu'on trouvera de meilleur : cela ne change en rien le principe de
base sur lequel elle repose.
Assurément, le moteur à poudre deviendra un jour le moteur spécial de
l'aviation. Il s'agit seulement de trouver une poudre lente à combustion
complète : c'est-à-dire, ne laissant théoriquement aucun résidu, et
pratiquement en laissant le moins possible. Problème simple ! c'est de la
chimie pyrotechnique pure. Mais pour s'y livrer, cependant, il faut d'autres
ressources que celles que possède un modeste chercheur, qui est entravé à
chaque instant par les besoins de la vie matérielle.
A ce propos, à quoi donc s'occupent les heureux de ce monde ?
dorment-ils ? ou n'ont-ils rien dans le cerveau ? Qu'ils doivent être
malheureux !...
L'aéroplane bien construit aura de grands avantages sur l'oiseau ; le
volateur est organisé d'une manière immuable : il est voilier ou rameur ; il a
des ailes longues et larges, longues et étroites, moyennes, courtes, aiguës ou
rondes ; mais il ne peut changer sa conformation. — Tandis que l'aéroplane bien
fait devra pouvoir se transformer suivant les besoins du moment, du temps qu'il
fera, et quelquefois de la marche qu'on voudra obtenir.
Il devra donc pouvoir passer de la forme du voilier excessif à celle du
rameur à ailes aiguës et étroites.
C'est surtout dans les très grands appareils que ces combinaisons
pourront être utilisées avec facilité. La complication pourra s'ajouter sans
augmenter de beaucoup le poids proportionnel, ou ces augmentations deviendront
peu sensibles comparées à la masse totale de l'appareil. Les surfaces croissant
comme le carré des mesures linéaires, un allongement insignifiant correspond à
une surface importante qui pourra soutenir un poids dont l'utilisation
permettra beaucoup de perfectionnements.
Avec un système à coulisse, il sera possible, en marche, de diminuer de
beaucoup l'envergure, surtout dans la partie représentant l’humérus, le radius
et le, cubitus. — Par cette diminution on ferait passer l'appareil type vautour
au type passereau ; ce qui donnerait beaucoup de facilité pour braver les grands
vents. — Il sera même possible de diminuer la largeur de l'aile pour éviter le
traînement et procurer par cela de la vélocité.
Avec le temps, les perfectionnements arriveront en quantité : chaque
constructeur adroit, bien pénétré de la théorie, apportera son contingent de
trouvailles, et les grands appareils surtout arriveront à une perfection de
mécanique qui laissera peu à désirer.
Cependant on ne peut nier que ce sont les machines type rameur excessif
qui donneront les plus grandes vitesses. Elles seront d'accord en cela avec les
principes exposés dans l'étude du vol des oiseaux.
Elles seraient, d'après les revues qui se publient sur cette matière, le
point par où l'humanité aborderait ce problème. — Le fait est rationnel au
reste. — La presque totalité des chercheurs n'a pour sujet d'étude que des
rameurs ; il est donc naturel qu'elle s'inspire d'eux et non des grands
voiliers qu'elle n'a pas eu le bonheur d'étudier.
Mais, machine type rameur ou machine type voilier, doivent toutes deux
être basées sur cette question d'équilibre instable qui se résume en la loi du
déplacement du centre de gravité sous l'action de la vitesse.
Pour faire une machine type rameur, il faut d'abord trouver une machine
puissante et légère, qu'on puisse alimenter presque sans provision : c'est
affaire aux mécaniciens et non aux chercheurs de la direction aérienne (1) ;
puis ensuite construire des ailes très résistantes et de peu de surface : ce
qui est un problème bien plus facile à résoudre que le premier. — Avec cet appareil
on aura certainement
(1)
La
machine Herreshoff de la force de 4 chevaux-vapeur et du poids de 22,750
grammes est parfaitement ce qu'il faut.
des vitesses plus grandes, et une
bien plus grande ponctualité dans la marches qu'avec l'appareil voilier ; mais,
ce qui lui manquera toujours, c'est la séduction du planement, de cette
manœuvre qui procure le mouvement sans dépense de force et sans secousse.
Dans l'aéroplane rameur, qui sera
certainement très employé un jour pour franchir par tous les temps de petites
distances, il y aura toujours le jeu du moteur qui viendra par son cliquetis
troubler les rêveries de l'ascension ; et surtout la crainte du dérangement de
la machine où du manque de provisions qui mettraient les voyageurs sinon en
péril, au moins dans un grand embarras.
C'est bien le même problème, c'est vrai, que ces deux aéroplanes ;
je ne dis même pas ne pas construire le type rameur le premier, quand je
pourrai construire ; mais, j'avoue sans honte que je ne le ferai que dans
l’espoir de construire le second après.
Il se présente ici une série de considérations à établir : d'abord, sur
la meilleure forme à donner au-dessous métallique de l'appareil pour pouvoir
réunir les qualités de pénétration dans l'air et de glissement sur l'eau ; considérations
très intéressantes sans doute pour mettre cette idée en pratique, mais qui, à
cause de leur étendue, ne sont pas à leur place ici.
La direction rectiligne automatique pourra être obtenue au moyen d'une
boussole puissante qui donnerait des contacts utiles comme direction, actionnée
par une machine dynamo-électrique, — Si la boussole est insuffisante on
pourrait se servir d'un gyroscope.
L'effort moyen utile pour pouvoir tenir les pointes dans une position
juste par rapport à la force du vent pourra probablement être en rapport exact
avec les effets produits par un ressort, qui tendra à ramener les pointes en
avant : et cela d'autant plus et avec d'autant plus de force qu'il sera plus
étiré et que par conséquent les pointes seront plus portées en arrière. — Il
doit être possible d'équilibrer son effort avec l'effort du vent.
A ce compte, une grande partie des manœuvres seraient supprimées. Il
doit en être ainsi pour les voiliers : nous avons déjà vu qu'il est fortement à
croire que très souvent ils se meuvent dans l'air d'une manière inconsciente.
Naturellement qu'au départ et à l'abordage ces deux ressorts seront commandés
par la direction humaine, et leur action comptée comme nulle ; mais, une fois
en marche, surtout par le vent debout, ils doivent produire une bonne part de
la besogne. Un simple déséquilibrement produit par le changement de place du
conducteur pourra suffire alors pour apporter les corrections suffisantes à la
bonne marche de l'aéroplane.
Comme on le voit, cette direction se réduirait comme force dépensée,
comme fatigue occasionnée, à bien peu de chose.
Cependant il n'en faudra pas moins toujours surveiller l'appareil, être
constamment prêt à intervenir, surtout pour éviter une chute : cas dans lequel
l'action de la vitesse se joignant à celle du vent agirait de concert pour
forcer les pointes à se porter en arrière.
Pour parer à cet accident, qui n'aurait rien d'agréable, il faut, si on
veut à toute force se dispenser de la surveillance, munir les ailes d'un arrêt,
tel que : deux cordes permettant seulement un mouvement de.... en arrière, ou
tout autre système équivalent.
A quelle perfection l'étude amènera-t-elle cet appareil ?
Il y aurait même encore quelque chose d'infiniment mieux à faire que
tout cela : ce serait de le construire enfin...
On a beau aimer l'aviation, il ne faut pas moins, malgré cela, admettre
que les grandes vitesses seront toujours fournies par les chemins de fer,
surtout lorsqu'ils seront étudiés et construits pour aller vite.
— Mais, malgré cet avantage, ils
n'en resteront pas moins dans leurs rails (du moins il faut l'espérer).
— Ils seront toujours l'esclave de
l'heure et de la direction ; tandis que la direction aérienne sera l'antithèse
de la voie ferrée : irrégularité, oui ! mais liberté absolue ! — tel sera son
lot.
MACHINES
IMPARFAITES
I1 est malheureux que l'espace nous manque pour placer ici un petit
cours sur les flèches en papier. — Ce jouet d'écolier, tout innocent qu'il
semble être au premier abord, est cependant, quand on l'étudié à fond, plein
d'enseignements de la plus grande utilité.
La flèche peut se construire depuis la forme aiguë, qui est le type de
la rapidité, jusqu'au type aéroplane procellaria dans lequel la longueur
devenue nulle a été remplacée par la largeur.
Au reste, ne voit-on pas que la nature n'a pas construit les voiliers
sur le même modèle : qu'on compare l'aspect du gyps fulvus à celui du procellaria,
qui est voilier lui aussi à ses heures, avec celui de la sterne, ou encore
celui du fou et de la frégate, quand ils prennent leur allure de flèche, et on
verra quelle diversité de modèles, on pourrait même dire quelles oppositions dans
ces modèles ; car nous avons vu qu'ils sont tous la perfection dans le vol en
relation avec leurs besoins.
Mais, malgré ces diversités, le vol, pour les uns comme pour les autres,
pour les baguettes comme pour les carrés, est toujours fixé à la même base ;
c'est toujours cette faculté de pouvoir maîtriser le déplacement du centre de
gravité par le changement de forme des surfaces, qui leur procure la faculté de
pouvoir s'équilibrer dans l'air. — Les aéroplanes qui auront et la surface
nécessaire, et cette faculté, seront donc dans des conditions suffisantes pour
reproduire cet exercice.
Nous arrivons à remarquer qu'une forme spéciale, particulière, n'est pas
indispensable pour produire la direction aérienne ; les formes les plus
curieuses pourront, à la rigueur, être utilisées : elles produiront la
décomposition utile des forces en raison de leurs perfections.
On peut réussir avec des surfaces rondes, triangulaires, carrées, avec
des radeaux aériens en forme de flèche, avec même des formes irrégulières ;
pourvu qu'on puisse transporter à volonté le centre de gravité où le besoin
l'exige, que la surface soit suffisante et qu'on ait une vitesse de vent ou une
vitesse personnelle de 10 mètres à la seconde.
Le problème ainsi exposé ne manque pas de curiosité.
Plus tard, nous serons tout surpris de voir circuler dans l'atmosphère
des appareils rien moins que confortables, des aéroplanes troués, rapiécés,
perdus, se tenant par la grâce de Dieu ; et cependant fonctionnant tant bien
que mal. Ce ne seront pas ceux qui résisteront le mieux au vent, mais ils iront
tout de même.
— Au reste, voyons l'expérience.
J'ai donné la liberté à des milans et à des percnoptères, qui étaient comme
surface dans un état déplorable ; les uns avec des ailes réduites à l'état de
baguettes, d'autres avec une aile et demie (ce manque d'équilibre dans les
surfaces les gêne énormément). Je me souviens d'un pélican, qui volait avec des
ailes incroyables ; il lui manquait au moins six ou sept rémiges, et le reste
était loin d'être au complet. — Par les bons vents il s'élançait il s’élançait
sur un terrain en pente, et finissait quelquefois par s’enlever. Une fois en
1'air, il devenait surprenant : porté sur ses deux loques d’ailes il passait à
un mètre des spectateurs, le coup replié, la tête sur les épaules avec un air
souverainement impertinent. Il allait faire un tour en mer, revenait inspecter
le marché, et finissait ses pérégrinations en se posant sur les vagues. Une
chose curieuse était de voir, de très près, cet animal, parfaitement familier
du reste, passer à grande vitesse près des spectateurs ; on éprouvait une
sensation étrange en le voyant glisser sans peine et sans fatigue ; c'était un
véritable avant-goût des voluptés de la vitesse qu'il vous faisait percevoir :
on se trouvait tout à fait devant le vol en chambre, l'oiseau professeur
enseignant l'art de voler.
La question qui se pose après ces digressions est celle-ci : quelle est
la surface minimum suffisante pour soutenir 80 kilogrammes ?
La réponse sera donnée par l'expérience ; mais déjà nous pouvons dire
qu'il est plus que probable qu'elle étonnera par son exiguïté. — Cependant, ce
que nous pensons est ceci : 7mq 60dq peuvent suffire, à la rigueur, pour
soutenir 80 kilogrammes.
CONSIDÉRATIONS
GÉNÉRALES
L'homme transporté subitement du sol qui est son habitat dans les grands
courants d'air de l'atmosphère ne pourra y vivre qu'en prenant beaucoup de
précautions. Il aura à lutter contre les vents violents, le froid subit d'une
intensité destructive, contre le soleil qui sera souvent d'une ardeur
dangereuse ; contre enfin tous les éléments dont l'action néfaste sur
l'organisme sera exagérée par la grande vitesse de translation avec laquelle il
circulera dans le milieu aérien.
Pour pouvoir résister à toutes ces causes de destruction, pour n'être
pas fourbu au premier voyage, pour ne gagner ni insolation, ni phtisie
galopante, ni congélation, il faut être vêtu d'une manière particulière.
— L'isolement, comme déperdition de
chaleur, doit être aussi exact que possible. La laine, ou plutôt le poil de
lapin, qui est si chaud et si léger, semble tout indiqué. — Ce costume doit
pouvoir s'ouvrir et se fermer très facilement.
Pour préserver la poitrine, la respiration et les yeux, un coupe-vent
est indispensable. On peut le faire ainsi : un voile de coton, auquel est fixée
une plaque de mica pour pouvoir se conduire.
Les coups de soleil seront évités au moyen de l'appareil suivant : en
partant de ce principe, qui semble au reste parfaitement logique, qu'il n'y a
que les maladroits qui se cassent la tête, il serait très simple de se
fabriquer une espèce de coiffure ainsi construite. Faire en soie, trame et
chaîne de grège la plus fine et la plus résistante qu'on trouvera, un parachute
de 8 mètres de diamètre ; soit un peu plus de 50 mètres carrés de surface. Les
cordes seraient remplacées par des ficelles de soie d'une solidité à toute
épreuve. Ce parachute expérimenté en ballon avec des poids doubles et triples
de celui qu'il a à porter, et d'une légèreté telle que son poids ne dépasse pas
2,500 grammes, sera disposé de telle manière qu'il formera coiffure. Si
l'occasion de s'en servir se présentait, d'un seul mouvement on le mettrait en
pleine action.
Voici donc une source de courage et de sang-froid toute trouvée ; et c'est
quelque chose qu'un appareil qui a le pouvoir de remonter le moral et de
permettre la réflexion. La peur du vide est amoindrie de toute la confiance
qu'il donne.
Les aéroplanes n'auront pas à faire de grandes ascensions comme les
ballons. Leur course, à eux, est en longueur et non en hauteur. L'altitude
pratique à laquelle ils devront se tenir semble devoir être 1000 mètres
environ. Cependant, dans les cas de grand vent ou de grand parcours, il est
possible qu'ils aient intérêt à s'élever davantage. Le passage des contrées
montagneuses, surtout des grandes chaînes, nécessitera en effet de véritables
ascensions ; mais en somme, comme hauteur généralement utilisée, il n'y aura
pas à dépasser le point où se gagne le mal des montagnes.
Les déserts seront sans danger avec ce mode de locomotion ; de 1000
mètres en l'air on voit toujours une oasis. — La mer elle-même n'engloutira pas
ce grand volatile de l'avenir très prochain, qui s'appelle l'homme. Il se
jouera de son étendue, car sa science géographique sera bien plus grande que
celle des oiseaux. Avec la boussole, le baromètre anéroïde, et tous ses
instruments de précision, il se moquera du brouillard et de la nuit, il évitera
les orages, et, grâce à sa science, maîtrisera l'élément aérien.
Aussi le globe n'aura plus de secret pour lui. Les pics inaccessibles
seront foulés, les aiguilles abruptes seront visitées, le repaire de l'aigle
arrivera à être à portée de sa main ; le Sahara, les grands lacs, et les pôles
surtout seront déflorés. Figurez-vous donc, lecteurs, le pôle Sud et ses
horreurs : les cétacés doivent grouiller là-bas, les terres doivent être une
immense rokerie. Que de beaux spectacles ! que de richesses !
Et pour avoir tout cela, pour voir toutes ces belles choses, que faut-il
? étudier, comprendre, et se persuader. Puis, quand on aura compris, il faudra
vouloir énergiquement— Il ne suffira pas alors d'avoir une de ces croyances
platoniques qui laissent aux brouillards de l'avenir le soin de se dissiper
quand bon leur semble, mais une foi robuste, active, s'acharnant contre la
difficulté, la prenant violemment à bras le corps et la terrassant. Et cela, en
jouant tout, sa vie, sa fortune, et même, ce qui est plus que tout cela, sa
considération. Combien, hélas ! sont forcés par la nécessité, par les
relations, de refouler au plus profond de leur cœur tout énoncé ayant trait à
l'invention qui donnera la liberté à l'univers ; car il faut bien remarquer que
la direction aérienne dotera la race humaine de plus de liberté individuelle
que toutes les inventions réunies qui ont paru jusqu'à ce jour.
En avant donc les heureux, les bien portants ; à l'ouvrage ! il n'y a
qu'à construire ; la besogne est toute mâchée. Le problème est simple, et se
réduit à ceci : appareil quelconque, permettant seulement la sustention et le
déplacement à volonté du centre de gravité ; et avec de la hardiesse,
maintenant que vous m'avez bien compris, vous réussirez, soyez-en sûrs.
LA DIRECTION
AÉRIENNE AU POINT DE VUE
ÉCONOMIQUE
Après avoir parlé des bienfaits de la direction aérienne, étudions les
perturbations qu'elle causera. Voyons si sur le revers de la médaille il n'y
aurait pas quelque point noir ; car un fait aussi capital que celui de ce
nouveau mode de locomotion ne peut s'établir sans produire des déchirements.
Admettons pour un instant l'exécution de ce problème, et envisageons les
effets qu'il produira sur la société.
Commençons par la propriété.
Il va se produire là une lacune énorme, qui sera l'insuffisance patente
de la clôture, du home. — Les haies, les murs, n'auront plus de
signification ; la fermeture des toits sera incomplète et il revoir. C'est une
diminution importante du privilège de la possession ; car, en y réfléchissant
un peu, on arrive de suite à saisir l'amoindrissement de toutes ces barrières.
On ne sera plus chez soi comme auparavant : il n'y a pas besoin de s'étendre
sur ce fait, à première vue on en comprend la portée.
Que pourra faire la police en face de ce nouveau mode de locomotion ? —
Elle est souvent mise en défaut avec les voies actuelles, qui sont cependant
des lignes précises, immuables, par où tout surveillé est obligé de passer ;
que sera-ce donc quand elle aura à étudier l'air, ce chemin immense, qui n'aura
pas moins de 7 ou 8,000 mètres comme limite de volume ? De jour, il est encore
possible de rêver quelque chose de satisfaisant : avec beaucoup de monde, de
bonnes lunettes, des appareils semblables ou même supérieurs ; en remplissant
toutes ces conditions, on peut espérer arriver à une surveillance presque
suffisante : mais de nuit, comment faire ? comment barrer la route de l'air ?
Comment seulement l'étudier quand le brouillard par son opacité vient annihiler
l'effet des réflecteurs électriques ? — Les contrebandiers auront certainement
de telles facilités pour exercer leur industrie, qu'il n'y aura qu'une seule
chose à faire pour les combattre, ce sera la suppression complète de la douane.
Mais alors que devient l'équilibre du budget ?
Ces perturbations causées à la propriété, à la police et à la douane
sont des bagatelles comparées à celles qui seront causées à la politique. —
Effectivement, on arrivera certainement, avec le temps, à trouver des moyens de
surveillance, sinon efficaces, du moins probablement suffisants. On finira par
s'accoutumer à cet amoindrissement de la possession ; mais quant aux questions
politiques, on va se trouver en face de telles facilités de mélange, que depuis
la tour de Babel on n'aura certainement rien vu de pareil.
Que devient l'armée avec cette nouvelle invention ?....
Tout est à recommencer, fortifications, manœuvres, frontières de
défense, stratégie, tout est réduit à néant.
C'est même la suppression, dans un temps très court, des nationalités :
les races seront rapidement mélangées ou détruites, car il n'y aura plus de
barrières possibles, pas même ces barrières mouvantes qui se nomment les
armées.
Plus de frontières !.... plus d'iles !.... plus de forteresses ! où
allons-nous ?
Il faut bien avouer que nous sommes en face de la plus large expression
de l'inconnu.
La société périra-t-elle pour cela ?
Assurément non !
Quant au procédé qu'elle emploiera pour s'accoutumer à cette nouvelle
manière d'exister, nous avouerons n'en avoir aucune idée : mais on peut
affirmer qu'elle sortira victorieuse de cette crise, qu'après la tempête
déchaînée par les intérêts lésés viendra une période d'équilibre, et qu'en fin
de compte l'humanité pour quelque temps d'angoisse aura conquis le royaume de
l'air.
Nous pouvons donc nous rasséréner et contempler ce but avec calme : ce
phare, c'est cette immense loi de la nature qui se nomme le progrès ; et
progrès est synonyme de bien.
Pour terminer, nous conseillerons à ceux qui veulent exécuter ce
problème la prudence la plus grande, le calcul sérieux de tous les accidents
qu'on pourrait prévoir ; mais, une fois cet examen bien fini, cette étude
parfaitement approfondie, nous recommanderons l'énergie, la volonté ; et ne
savons leur dire rien de mieux que le mot qui commençait cette étude :
Osez !....
L.-P. MOUILLARD.
TABLE DES GRAVURES
Fig. 1. Vautour oricou Frontispice.
— 2 Pélican au vol 36
— 3 Ombre du pluvier dore 111
— 4 — de l'épervier 117
— 5 — de la glaréole 125
— 6 — du martin-pêcheur, 133
— 7 — du pélican 130
— 8 — de la roussette d'Egypte
...... 146
— 9 — de la nyctinome 146
— 10 — du canard souchet 140
— 11 — du scops 153
— 12 — du héron gris 159
— 13 — de la cigogne 165
— 14 — du faucon crécerelle 169
— 15 — du faucon pèlerin 169
— 16 — du faucon pèlerin 177
— 17 — du balbuzard 181
— 18 — du vautour fauve 197
— 19 — du vautour fauve 201
— 20 — démonstration 211
— 21 — — 212
— 22 — — 214
— 23 — — 215
— 24 Aile du vautour 226
— 25 — démonstration 227
— 26 — — 228
— 27 — — 228
— 28 Aéoroplane 245
— 29 Charnière 250
— 30 Aéroplane 251
— 31 Propulseur 259
TABLE DES MATIÈRES
Préface
3
Historique
7
Ballons
9
ÉTUDE
DE L'AVIATION PAR LE PLUS LOURD QUE L'AIR 12
De
l'observation 13
ESSAI
D'ORNITHOLOGIE AU POINT DE VUE DU VOL 27
Etude
de l'appareil locomoteur de l'oiseau 32
Variétés
de formes d'ailes 32
De
la queue 34
Vol
des rameurs 38
Vol
des voiliers 41
Vitesse
du vent 51
Vitesse
de l'oiseau 55
Action
de la vitesse 59
Voyages
des oiseaux 64
Effets
produits par la masse 68
Effets
produits par l'agglomération 75
Les
trois supports 78
Manœuvres
diverses 82
ÉTUDES
D'OISEAUX 86
—
Tableau type rallus 90
Type
rallus 91
—
Tableau type gallinacé 94
Type
gallinacé 95
—Tableau
type passereau 96
Corneille
03
—
Tableau type colombidé 108
—
Tableau type scolopax 110
Scolopax
113
Outarde
Houbara 113
—
Tableau type autour 115
Autouridés
116
— Tableau type larus 120
Type larus 121
Oiseau-mouche 121
Hirondelle 122
Martinet
122
Guêpier
123
—
Tableau type anus 131
Sarcelles
et canards 132
Cormoran
132
Pélican
136
Cygnes
142
—
Tableau type chauve-souris 143
Chauves-souris
144
—
Tableau accipitres nocturnes 150
Accipitres
nocturnes 151
Grand-duc
152
—
Tableau type ardea 158
Type
ardea 161
Cigogne
163
–
Tableau type aquila 168
Type
aquila 171
Alouette
171
Faucon
crécerelle 171
Faucon
pèlerin 172
Buse
172
Milan
174
Milan
du Caire 175
Aigles
180
Grand
aigle fauve 184
—
Tableau type vautour 189
Vautours
190
Néophron
percnoptère 194
Vautour
fauve 196
—
Tableau types divers, allure 10 mètres à la seconde ... 208
—
Tableau types divers, allure 10 métrés à la seconde ... 209
THÉORIE
DE L'AÉROPLANE 210
Angle
de la chute 218
De
la résistance de l'air à l'avancement 222
Équilibre
vertical et horizontal 227
Du
vol théorique 232
APPLICATION
240
Premier
essai 242
Deuxième
essai 243
Troisième
essai 247
Quatrième
essai 249
Aéroplane
à moteur 258
Machines
imparfaites 271
Considérations
générales 274
La direction aérienne au point de
vue économique .. 278